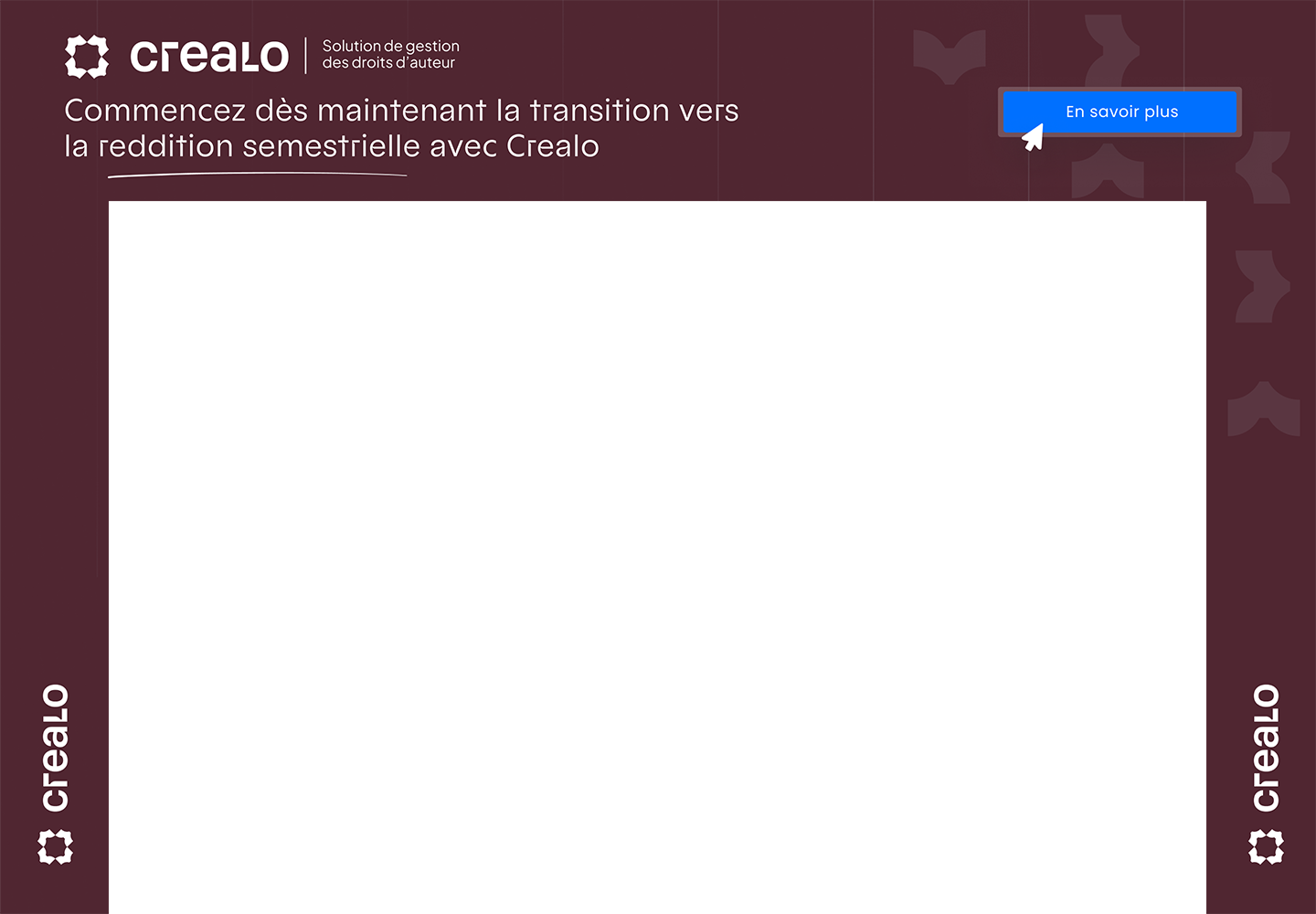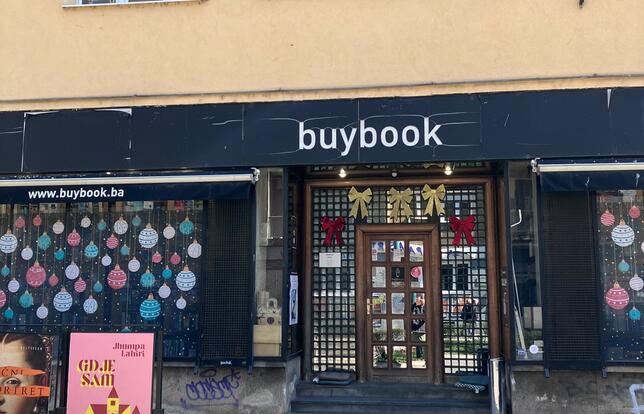À la rencontre des mondes du livre européen. Pendant quatre ans, David Piovesan, chercheur et maître de conférences à l’université Lyon-3, ancien libraire dans le massif du Vercors, a rencontré 250 acteurs de la filière du livre dans 23 pays européens, principalement des libraires, mais aussi des éditeurs, traducteurs, agents, écrivains, responsables d'association.
Son objectif ? Comprendre comment fonctionne le marché du livre dans les zones étudiées et recenser les bonnes pratiques, comme les moins bonnes. Son ouvrage, The European Bookshop Business Model sort le 8 octobre aux éditions Routledge.
Livres Hebdo : Vous étiez libraire à Villard-de-Lans avant de reprendre vos fonctions universitaires. Qu'est-ce qui vous a motivé à lancer cette recherche sur les librairies européennes ?
David Piovesan : En reprenant mon poste à l'université, j'ai voulu sortir du cadre franco-français. J'avais été impliqué dans l'Association des libraires en Auvergne-Rhône-Alpes et l'idée était vraiment d'aller sur le terrain, mais plus loin de chez nous, afin de saisir l'épaisseur de la réalité, rencontrer des gens. C'est la philosophie du voyage : ça ne se passe pas du tout comme vous l'aviez prévu.
« Pour les pays d'Europe centrale et orientale, il est impossible d’imaginer une politique publique du livre avec un prix fixe »
Concrètement, comment avez-vous organisé ce « European Bookshop Tour » ?
J'ai obtenu des financements par petits bouts : bourses de mobilité de mon université, de l'Institut français d'Oslo, bourse européenne pour la Slovénie. J'ai fait 80 % de mes déplacements en train et en bus. Le projet a duré trois ans, de 2022 à début 2025. Cette aventure a démarré lors de mes six mois passés à Prague, en 2022, comme visiting researcher à l’Université VSE. C’était juste au début de la guerre en Ukraine. Et là, c'est le choc : Si Prague est plus proche de Berlin en termes de kilomètres, c’est complètement différent de ce qu’on connaît en France.
Quels sont vos principaux enseignements ?
La notion de librairie indépendante telle qu'on la connaît en France ne se retrouve que dans quelques pays d'Europe de l'Ouest, où les gens ont du pouvoir d'achat, avec des politiques publiques solides et un système de subventions. Il y a un prix unique en Espagne, Italie, France, Allemagne et Autriche, cinq pays avec un système très proche. Dans tous ces pays, il y a aussi un pass Culture qui profite aux librairies, d’ailleurs souvent mis en place avant la France.
La librairie Buybook à Sarajevo, en 2023- Photo DP
Pour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.
Et dans les autres pays européens ?
Dès qu'on sort de ces pays, le monde de la librairie indépendante n'est plus du tout le même. Beaucoup de pays ont des systèmes de prix unique limités dans le temps - un an en Norvège, six mois au Portugal, en Slovénie, en Croatie - avec des régimes d'exception permettant des remises importantes lors des foires du livre. Tous les pays d'Europe centrale et orientale ont plongé dans l'économie libérale après 1989. Pour eux, il est impossible d’imaginer une politique publique du livre avec un prix fixe. Ce serait un retour vers une économie du livre collectivement organisée. C’est le cas de la République tchèque par exemple et de la Pologne qui a refusé par deux fois le prix unique.
« Le seul pays où les librairies vont plutôt bien hors prix unique, c'est le Royaume-Uni »
Comment survivent ces librairies dans des systèmes dépourvus de loi du prix unique ?
Dans ces pays, les librairies indépendantes, il faut les chercher. Au Portugal comme en Slovénie, elles se comptent sur les doigts d’une main. Il y a beaucoup de librairies de chaînes possédées par des groupes éditoriaux. Même chose en Norvège et au Danemark, où les deux principaux groupes éditoriaux ont leurs chaînes de librairies. Et souvent dans ces zones, les éditeurs indépendants qui n'arrivent pas à placer leurs livres ouvrent leurs propres librairies.
Y a-t-il des contre-exemples ?
Paradoxalement, le seul pays où les librairies vont plutôt bien hors prix unique, c'est le Royaume-Uni. Le nombre de librairies indépendantes membres de la Booksellers Association est reparti à la hausse depuis plusieurs années, bien avant le Covid. Là-bas, il existe une vraie volonté de soutenir les commerces indépendants, dont les librairies, considérées comme des lieux sociaux qui animent le territoire, font partie. Les lecteurs ont d’ailleurs une consommation plutôt militante, en réaction à l’impact très fort d’Amazon, installé depuis 1998.
La librairie lisboëte LerDevagar, au Portugal en 2024- Photo DP
Pour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.
Justement, quelle est la présence d'Amazon en Europe ?
Amazon n'est présent qu'en Espagne, Italie, France, Allemagne, Royaume-Uni, Suisse et Belgique. Dans tous les pays d'Europe de l'Est, Amazon est absent. La firme s’est installée en Pologne il y a deux ans, mais le démarrage semble poussif. En revanche, dans tous ces pays, il y a un « Amazon like », c’est-à-dire un acteur similaire qui use des mêmes pratiques.
« La librairie reste un acteur fragile au niveau européen »
On sent votre approche très engagée. Que retenez-vous personnellement de cette étude ?
Ce qui m'a le plus surpris, c'est que notre réalité française n'est finalement pas si partagée en Europe. La librairie reste un acteur fragile au niveau européen, et jusqu'à maintenant, l'Union européenne avait plutôt décidé de laisser à chaque pays le soin d'organiser son système. Il y a peut-être une réflexion politique à faire aujourd'hui au niveau européen, car la librairie constitue un élément du patrimoine et de l'identité européens. Et surtout elle reste un lieu pour repenser le monde de demain. En laissant aux pays la liberté de choisir leur propre modèle, on constate que certains font des choix très différents des nôtres.
Votre étude dresse-t-elle un panorama pessimiste du secteur ?
Pas du tout. Le modèle français est unique et très positif. Il ne faudrait pas y renoncer en raison d’un contexte économique difficile. L'action collective me semble particulièrement intéressante, notamment celle que nous avons développée en France, entre libraires et éditeurs indépendants. Ce n'est pas un hasard si les nouvelles formes d'action collective en Europe vont dans ce sens.
La librairie bruxelloise Tropismes, en 2024- Photo DP
Pour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.
Comment les libraires résistent-ils aux bouleversements du secteur ?
J'identifie quatre axes de résistance que j'appelle les « deux P et deux C ». Les deux P correspondent aux notions de « professionnalisation » et de « performance ». La professionnalisation, c'est l'action collective, les syndicats, les événements, se structurer comme un groupe professionnel avec une identité et des arguments. La performance, c'est optimiser la gestion, mieux maîtriser ses achats et retours, négocier les conditions commerciales. Mais j'ai l'impression qu'après 20 ans de course à la performance, les libraires s’interrogent sur le sens de ces efforts. Ils sont devenus des champions de la gestion, mais cela reste toujours le commerce le moins rentable. L’année 2025 est criante à cet égard.
Et les deux C ?
Curation et communauté. La curation, c'est le filtrage de l'offre pour être acteur de la recommandation face à une offre hyper-abondante. C'est l'enjeu central aujourd'hui. La communauté, c'est faire vivre la librairie sur un territoire. Il y a d'ailleurs une petite voix, encore minoritaire, de libraires qui refusent de développer leur présence sur les réseaux sociaux. Ils disent préférer miser sur l'authenticité et ce qui les différencie d'Amazon, en privilégiant la relation humaine directe avec leurs clients.
Quelles sont vos perspectives de recherche après cette étude ?
Je réfléchis à un projet autour des librairies de la Méditerranée mais aussi à la transition écologique dans le monde du livre et à l’impact de l’intelligence artificielle qui suscite fantasmes et folles promesses.
The European Bookshop Business Model, de David Piovesan avec une préface de Pierre-Jean Benghozi paraît le 8 octobre aux Éditions Routledge.
Un cycle de conférences sur le livre
Avec un collectif de chercheurs sur l’économie du livre, David Piovesan lance un cycle de conférences sur le monde du livre avec des thèmes d’actualité, intitulé Le livre au pluriel. En présentiel ou à distance, les réunions qui proposent aux universitaires d’échanger directement avec les professionnels du livre doivent être lancées le 23 octobre. Outre Olivier Thuillas qui doit évoquer la romance à l’ère du numérique, Olivier Bessard-Banquy, Louis Wiart ou Marie-Pierre Vaslet sont également prévus au programme, à retrouver ici : https://livredurable.hypotheses.org/seminaires
Pour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.