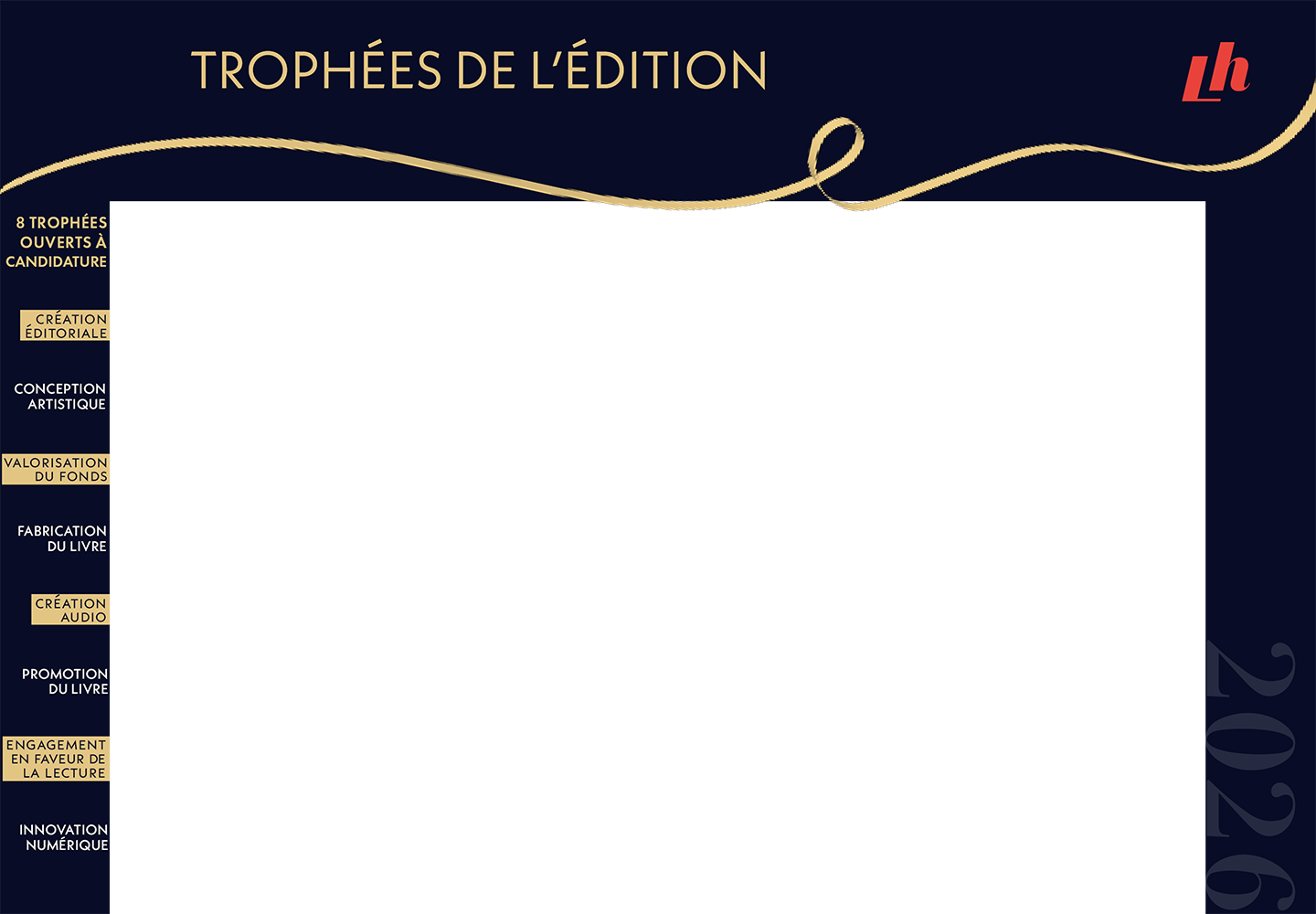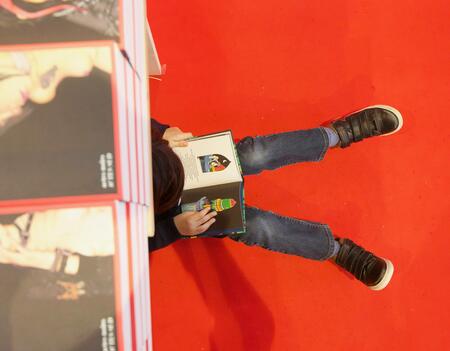La Commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport du Sénat a confié à deux sénatrices, Agnès Evren et Laure Darcos, et un sénateur, Pierre Ouzoulias, une mission de contrôle sur l’intelligence artificielle (IA) et la création avec pour objet de dresser un état des lieux des enjeux posés par le développement de l’IA dans le domaine de la création artistique, d’évaluer le rapport bénéfice-risque de l’usage de l’IA pour les industries culturelles et créatives et d’identifier les leviers d’action en termes de politiques publiques à l’échelle nationale et européenne ; et ce, pour le début de l'été 2025.
En parallèle de cette mission, la Commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport, a auditionné le 7 mai dernier Alexandra Bensamoun, professeure de droit privé à l'Université Paris-Saclay et membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, suite à l'adoption du Règlement européen sur l'intelligence artificielle (RIA) le 13 juin 2024, afin de réfléchir sur les répercussions normatives de ces technologies sur les régimes de la propriété intellectuelle, notamment le droit d'auteur et les droits voisins.
Vers une gouvernance normative de l'intelligence artificielle : conflits de modèles et rationalités juridiques
L'audition d'Alexandra Bensamoun a mis en exergue les clivages entre blocs juridiques dans la construction d'une gouvernance mondiale de l'IA. Tandis que les États-Unis s'appuient sur une logique de soft law, prônant l'autorégulation et l'encouragement à l'innovation, la Chine articule ses choix normatifs autour d'un objectif de contrôle social et de planification centralisée. L'Union européenne, quant à elle, ambitionne de promouvoir un modèle de responsabilité, axé sur la protection des droits fondamentaux, la transparence des systèmes algorithmiques et l'encadrement des usages de l'IA. Ce positionnement réglementaire s'incarne dans le RIA, texte hybride conjuguant logique d'encadrement sectoriel et volonté de créer un espace de confiance pour les innovations numériques.
Le secteur culturel, porteur d'une identité européenne forte et vecteur de souveraineté symbolique, se trouve au cœur de cette tension. L'usage des contenus culturels pour entraîner les IA soulève des problématiques d'exploitation économique, de reconnaissance des droits moraux, mais aussi d'équilibre dans la chaîne de valeur. Pour Alexandra Bensamoun, la préservation d'un modèle européen de création nécessite un droit d'auteur effectif et adapté aux mutations techniques.
L'entraînement des modèles génératifs : exception de fouille et transparence algorithmique
Le corpus entraînant les modèles génératifs repose sur une collecte automatisée de textes, d'images ou de contenus audiovisuels extraits de bases telles que Common Crawl ou LAION. Ces bases agrègent des œuvres relevant du droit d'auteur, sans vérification effective du statut juridique des données. Dans ce cadre, la directive (UE) 2019/790 a introduit deux exceptions à la fouille de textes et de données (text and data mining, TDM) : l'une, à visée scientifique, est réservée aux chercheurs ; l'autre, à visée commerciale, autorise la fouille sous réserve que les titulaires de droits n'ont pas formulé d'opposition expresse via un opt-out. Cette dernière exception, fortement critiquée, repose sur une architecture juridique dérogatoire qui fragilise le droit exclusif des auteurs en inversant la logique du consentement.
Le RIA tente de pallier ces fragilités à travers ses articles 53(1)c et 53(1)d. Le premier impose une politique de respect du droit d'auteur par les fournisseurs d'IA ; le second prescrit la publication d'un résumé suffisamment détaillé des corpus d'entraînement. Or, l'effectivité de ces obligations dépend étroitement de la coopération des opérateurs privés et de la capacité des institutions à définir des standards d'interopérabilité. Le rapport dialectique entre secret des affaires et droit à l'information est au cœur de cette problématique.
Vers une économie de la licence : enjeux de rémunération et modèles contractuels
La construction d'un modèle de rémunération pour l'utilisation des contenus protégés dans le cadre de l'entraînement des IA suppose l'émergence d'une économie de la licence adaptée aux spécificités technologiques de l'intelligence artificielle. Trois instruments sont envisageables : la gestion collective (volontaire ou obligatoire), les licences légales avec mécanisme compensatoire, et les contrats individuels. Pour Mme. Alexandra Bensamoun, le modèle contractuel paraît actuellement le plus opérationnel, dans la mesure où il garantit la liberté contractuelle et favorise la responsabilité des acteurs. Il implique cependant la mise en place d'infrastructures juridiques (bases de données accessibles, dispositifs d'opt-out effectifs) et techniques (systèmes de marquage et d'identification des œuvres).
Ce modèle doit être adossé à une gouvernance inclusive, garantissant la représentation des ayants droit, la transparence des négociations et une équité dans la redistribution des revenus. Le développement de standards contractuels intersectoriels pourrait favoriser cette dynamique.
Production des IA et régime de protection des contenus générés
La question de la protection des contenus générés par l'intelligence artificielle touche au cœur même de la notion d'auteur en droit européen. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, l'originalité est entendue comme l'expression de la personnalité de son auteur. Par conséquent, une création issue uniquement d'un traitement algorithmique autonome est, par principe, exclue de la protection par le droit d'auteur. Toutefois, les créations assistées par IA, dans lesquelles l'humain exerce un contrôle créatif véritable, peuvent être éligibles à la protection.
Cette dualité soulève une difficulté probatoire : comment démontrer l'apport humain dans un processus hybride de production ? Elle implique aussi une interrogation sur les formes alternatives de protection, notamment en matière de concurrence déloyale, de parasitisme ou de responsabilité délicate. En outre, l'usage de styles identifiables ou la reproduction indirecte de l'identité artistique d'un créateur par l'IA interroge les limites de la protection conférée par les droits voisins ou par le droit commun de la responsabilité civile.
Enfin, le RIA introduit des obligations de transparence à l'aval, notamment l'identification des contenus synthétiques (watermarking, disclosure), dans une perspective de lutte contre la désinformation et de protection du public. Cette traçabilité participe d'une responsabilisation accrue des producteurs de systèmes d'IA générative.
L'audition de Mme. Alexandra Bensamoun met en lumière les tensions systémiques entre liberté de création, protection des droits, innovation technologique et souveraineté réglementaire. L'approche européenne, fondée sur la responsabilité et la transparence, se distingue dans un paysage international hétérogène. La refondation du droit d'auteur à l'ère de l'intelligence artificielle passe par une articulation dynamique entre régimes d'exception, outils contractuels, dispositifs techniques et reconnaissance des droits fondamentaux.
Alexandre Duval-Stalla

Olivier Dion - Alexandre Duval-Stalla
Alexandre Duval-Stalla est avocat au barreau de Paris et écrivain. Ancien secrétaire de la Conférence du barreau de Paris (2005) et ancien membre de la commission nationale consultative des droits de l’homme, il est le président fondateur de l’association Lire pour en sortir, qui promeut la réinsertion par la lecture des personnes détenues, et du prix littéraire André Malraux.
Pour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.