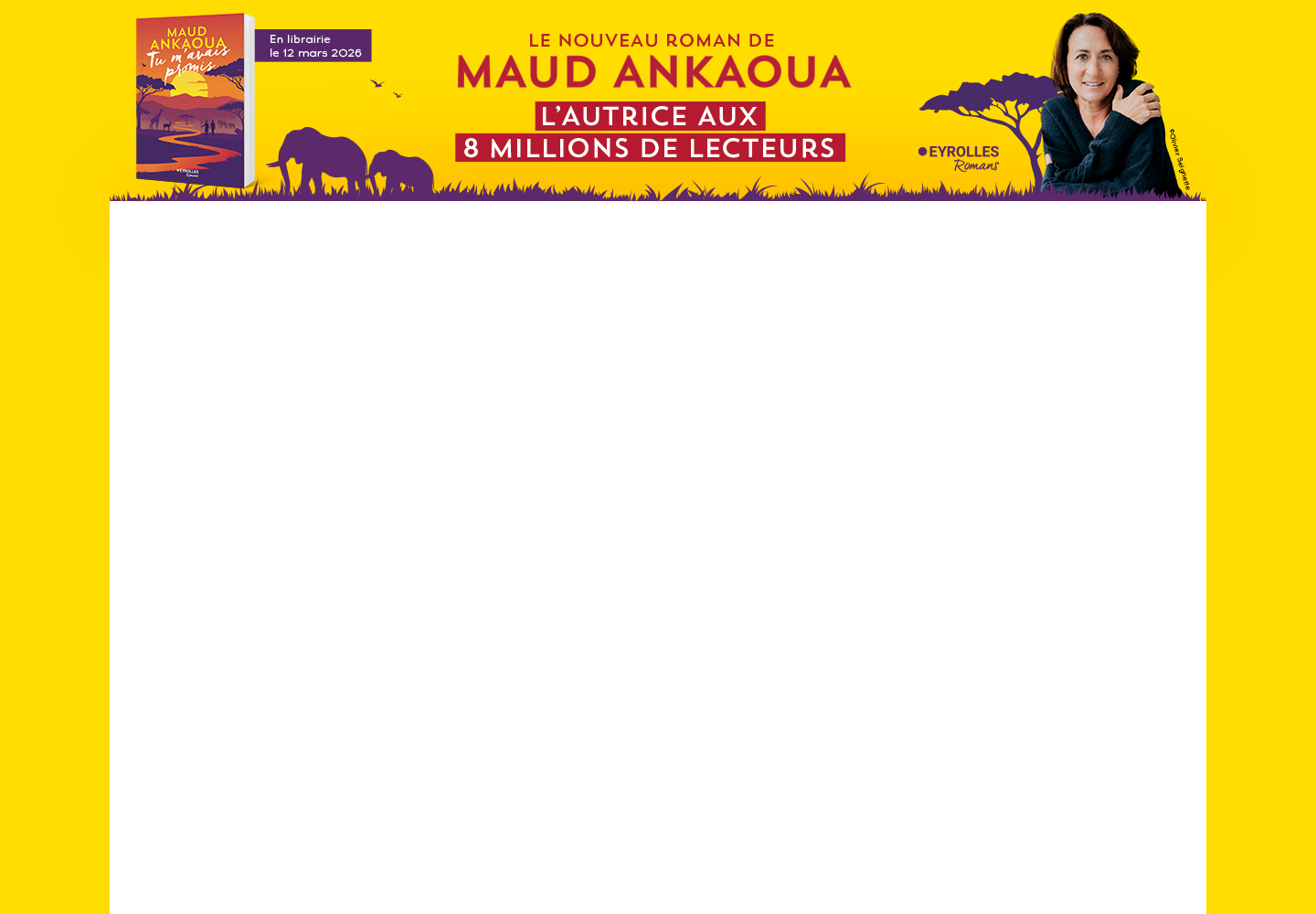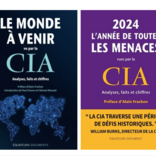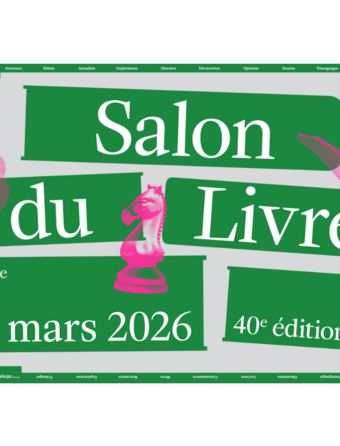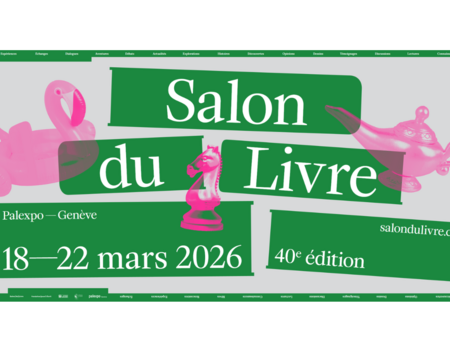«Un des problèmes, c'est d'obtenir les ressources indispensables à la recherche sans s'aliéner et sans sacrifier l'autonomie. » En 1994, sur le plateau de France 2, Pierre Bourdieu se posait déjà la question : quelles peuvent être les conditions optimales de production, d'échange ainsi que de reconnaissance sociale et culturelle des œuvres d'art ? Trente-cinq ans plus tard, les parlementaires se décident. Ils vont tenter de faire bouger les lignes du côté des livres. « Ce sera la plus importante réforme depuis 1957 », se félicite la sénatrice Laure Darcos, membre du groupe Les Indépendants - République et territoires (proche d'Horizon) et ancienne cadre du groupe Hachette.
Si elle se réjouit, c'est qu'avec Sylvie Robert, sénatrice membre du PS, elles ont déposé le 4 avril dernier une proposition de loi pour réformer le code de la propriété intellectuelle avec plusieurs avancées significatives, comme le minimum garanti au contrat d'édition. Ensemble, les deux femmes espèrent valider le tout d'ici la fin de l'année. De quoi remplir le calendrier législatif du livre et offrir une occasion de réfléchir aux différents rapports de force qui sous-tendent la profession.
La sénatrice Laure Darcos.- Photo OLIVIER DIONPour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.
Les prémices
Retour en arrière. Nous sommes en 2017. Comme il l'avait déjà été cinq ans auparavant, le spécialiste du droit d'auteur Pierre Sirinelli est mandaté par le gouvernement. Son objectif : faire le médiateur entre les différentes branches du livre pour que ces dernières trouvent des axes de réforme qui pourraient être ultérieurement portés devant le Parlement et devenir une loi. Mais si le but est clair, le chemin pour arriver à un consensus se révèle plus complexe. « Il y avait une demande forte de la part des auteurs et une volonté d'écoute du côté des éditeurs, mais ils n'arrivaient absolument pas à se mettre d'accord, raconte le professeur émérite. Les auteurs avaient surtout à l'esprit qu'il fallait améliorer leur rémunération et les éditeurs estimaient que cette question ne relevait pas du domaine de la loi. » Malgré les désaccords, le médiateur tient bon. Fin 2022, il présente à l'ancienne ministre de la Culture Rima Abdul-Malak le « fruit de ce travail collaboratif ».
Celui-ci se résume en cinq points. Tout d'abord une reddition de compte semestrielle. Plutôt que d'être payés une fois par an, les auteurs touchent leurs droits tous les six mois. « C'est évident que cela représente une surcharge de travail assez importante pour des sommes qui parfois peuvent être dérisoires, mais nous y sommes prêts si cela peut aider un peu les auteurs », explique Dominique Tourte, directeur de la Fédération des éditions indépendantes. Le second accord concerne les contributions non significatives.
Renaud Lefebvre, directeur général du SNE.- Photo OLIVIER DIONPour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.
Pour celles-ci, la reddition de compte reste annuelle. Les deux suivantes touchent à la cession de droit. L'une engage l'éditeur à tenir informé dans un délai de trois mois l'auteur d'une traduction quand celle-ci arrive à la fin de son exploitation. À ce moment-là, le traducteur peut demander la résiliation du contrat et récupérer son travail. Si l'éditeur ne le prévient pas, le contrat est automatiquement résilié.
L'autre mesure porte sur les livres français vendus à l'étranger. Elle obligerait l'éditeur à informer l'auteur sur le nom du cessionnaire, l'ampleur des droits cédés, la durée du droit cédé, la langue ou encore les pays à partir du moment où un contrat à l'étranger est conclu. L'éditeur est cependant dispensé de cette obligation d'information lorsqu'elle constitue pour lui une charge administrative disproportionnée au regard de l'importance de la contribution. Enfin, le dernier accord touche à l'après fin de contrat. Elle impose aux éditeurs d'adresser à l'auteur un dernier état des comptes à l'arrêt de la commercialisation du livre. « Tous ces accords n'amènent pas de grand bouleversement mais vont contribuer à apaiser l'auteur », synthétise Maïa Bensimon, déléguée générale du Syndicat national des auteurs et des compositeurs (Snac).
Une ligne de crête
« Les discussions ont parfois été âpres et, à l'arrivée, les auteurs se sont proclamés plutôt déçus mais nous avons quand même trouvé des avancées. Désormais, un écrivain va davantage pouvoir suivre le destin de son livre », analyse Pierre Sirinelli. « Ces points vont améliorer l'information et la transparence sur de nombreux éléments relatifs à l'exploitation des œuvres », ajoute Patrice Locmant, directeur général de la SGDL, qui s'estime toutefois déçu du sort réservé à la question de la rémunération. « Ce point est pourtant crucial. Depuis plus de 30 ans, le revenu des auteurs est en baisse et le sentiment de précarisation s'accroît. »
Pour l'endiguer, certaines associations proposaient d'ajouter aux accords la mise en place d'un minimum garanti non amortissable. C'est-à-dire une somme perçue pour le travail d'écriture qui ne soit pas déduite des droits d'auteur une fois l'ouvrage paru mais qui s'y ajouterait. Une proposition inaudible pour les éditeurs. « Penser que le minimum garanti amortissable deviendrait du jour au lendemain un minimum garanti non amortissable accompagné des mêmes taux de droit d'auteur, c'est tout simplement une forme de fiction. Car cela impliquerait un tel bouleversement dans les pratiques de rémunération du côté des éditeurs que je ne pense pas que cela pourrait être véritablement au bénéfice des auteurs », se défend Renaud Lefebvre, directeur général du SNE, avant d'ajouter : « On ne peut pas considérer qu'un éditeur, à partir du moment où il signe un contrat avec un auteur, sera comptable globalement de sa situation personnelle. » Résultat, malgré un second passage par le ministère de la Culture, la proposition ne passe pas.
Minimum garanti
C'est sur cette ligne de crête, parmi des tensions palpables, qu'entrent en scène Sylvie Robert et Laure Darcos pour mettre en place l'étape suivante : faire des accords une proposition de loi. « On a revu toutes les associations d'auteurs et d'éditeurs et à partir de ces rencontres, on a revu notre copie pour trouver un équilibre », développe la sénatrice Laure Darcos. Ce point de convergence, elles le trouvent avec deux mesures qui s'ajouteront aux accords Sirinelli : un minimum de droits d'auteur garanti par l'éditeur et un taux progressif. « Concrètement, un auteur signera un contrat en disant qu'il est en droit de demander un minimum garanti, en droit de demander un taux progressif à partir d'un certain seuil de vente. Ce sera dans la loi. Et donc l'éditeur ne pourra pas faire fi de ça. »
Effectivement, s'il n'y a pas d'outil coercitif adossé à la loi, un comité de médiation auteur-éditeur pourra être saisi et permettra d'attaquer plus facilement dans le cas où l'une des parties ne respecterait pas ses engagements. En attendant, la loi doit encore être débattue au Sénat. Laure Darcos et Sylvie Robert espèrent un créneau fin juin ou bien, peut-être après l'été, en octobre. Tout cela sans compter les questions du livre d'occasion et de l'intelligence artificielle, abordées plus loin dans ces pages.
Pauline Gabinari
L'IA ne paie pas
Que reste-t-il des droits d'auteur à l'heure de l'intelligence artificielle ? Alors que les modèles sont de plus en plus présents dans les pratiques de tous et toutes, retour sur deux ans de débats sous pression au cœur des institutions.
Le 9 septembre prochain se tiendra un procès inédit en France. Le Syndicat national de l'édition (SNE), la Société des gens de lettres (SGDL) et le Syndicat national des auteurs et des compositeurs (Snac) assigneront Meta devant la troisième chambre du tribunal judiciaire de Paris. La raison d'une telle action ? " Contrefaçon " et " parasitisme économique " des œuvres protégées, affirme toute l'interprofession qui s'estime spoliée par le géant technologique.
Comment en est-on arrivé là ? Pour comprendre, reprenons chronologiquement. 20 décembre 2023 : après plusieurs mois de discussions houleuses au sein de la filière, le débat sur droit d'auteur et intelligence artificielle est enfin porté devant le sénat. C'est Alexandra Bensamoun, juriste spécialiste du droit d'auteur, qui est auditionnée. Elle a la lourde tâche de représenter les ayants droit et d'introduire auprès de l'institution les conséquences déjà visibles de l'IA sur le droit d'auteur et le droit voisin.
Rapidement, l'entrée - c'est-à-dire les données qui nourrissent l'IA - pose problème. Effectivement, plusieurs bases de contenu comme Books3 contiennent des œuvres piratées. Autre point névralgique, l'" exception TDM " introduite dans une directive de 2019. Cette dernière autorise tous les usages de contenus sous réserve que le titulaire n'ait pas exprimé son opposition, le fameux opt-out. Au regard du droit d'auteur, l'application de cette réserve peut être contestable dans le cas de l'IA. De fait, pour dépasser le droit d'auteur, un " test en trois étapes " est nécessaire. Son résultat doit prouver qu'aucune atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre, ni aucun préjudice aux titulaires de droits ne sont portés. Deux éléments difficiles à démontrer dans de nombreux cas de spoliation par l'intelligence artificielle.
Un angle mort au point mort
Malgré les multiples dissensions, le 13 juin 2024 est promulgué le Règlement européen sur l'intelligence artificielle. Cette régulation n'entre toutefois pas immédiatement en vigueur. Elle se donne jusqu'à 2026 pour mettre en place les outils nécessaires à la surveillance. En cause, la rédaction d'un code de bonne pratique qui viserait à mettre d'accord les différentes parties autour de la table. Autant dire, mission impossible. Malgré l'écriture d'une troisième version, personne n'est satisfait, les ayants droit trouvant le texte trop permissif, les autres trop contraignant. Second outil, la transposition claire et précise du " modèle de transparence " attendu par le bureau de l'IA. Sauf qu'ici aussi la discorde règne. À l'heure où sont écrites ces lignes (le 20 mai 2025), aucune entente n'a été trouvée alors que le modèle devait être définitif le 2 mai...
Face aux blocages, Alexandra Bensamoun et la spécialiste des industries culturelles et du numérique Joëlle Farchy ont été missionnées par le ministère de la Culture pour proposer des solutions quant à la rémunération des contenus culturels utilisés par les systèmes d'IA. Le rapport a été rendu public le 16 mai dernier. Sur le plan juridique, il propose de poser les bases d'un marché des licences combinant gestion individuelle et collective, avec une modulation des tarifs selon les usages. Pour ce faire, plusieurs outils ont été présentés : médiateur de l'IA, présomption d'utilisation des contenus en cas d'indices concordants, injonction de divulgation de preuves, ou encore action de groupe. Côté économique, c'est la création d'une place de marché permettant la mise en place de contrats basée sur une quantification précise de l'apport des œuvres aux systèmes d'IA qui est surtout mis en évidence.
Pauline Gabinari
La tokenisation, une révolution numérique ?
La tokenisation émerge dans l'univers numérique... Entre nouvelles opportunités économiques et questionnements juridiques, cette technologie peut-elle s'imposer dans le secteur de l'édition ? Explications.
La tokenisation consiste à décomposer un texte en unités plus petites appelées " tokens " (mots, phrases ou caractères), permettant aux machines de traiter le langage humain de manière plus digeste. Dans le domaine financier, elle désigne la conversion d'actifs réels en " jetons numériques " sur blockchain (grande base de données partagée en simultané avec tous les détenteurs, censée offrir de hauts standards de transparence et de sécurité) et peut désormais s'appliquer aux actifs artistiques.
Toute œuvre d'art peut être tokenisée et inscrite " à jamais sur la blockchain ". Un livre pourrait connaître le même procédé. Cette technologie permettrait de représenter des droits d'auteur, des exemplaires limités ou des éditions spéciales sous forme de tokens numériques. La représentation tokenisée d'un livre pourrait faciliter le suivi des droits d'auteur, la rémunération automatique des créateurs et l'accès international aux œuvres. Malgré son potentiel innovant, la tokenisation dans l'édition (et ailleurs) soulève plusieurs défis, relève notamment l'expert en finance numérique Xavier Lavayssière dans une note de blog de la néobanque N26. Trois opérations doivent être menées en parallèle : le tracking technique (création du token via un contrat intelligent sur blockchain), le tracking juridique (attachement de droits légaux au token) et le tracking commercial (distribution aux investisseurs).
La question du lien entre l'œuvre originale, sa version tokenisée et son propriétaire devient cruciale. S'agit-il d'un droit de propriété intellectuelle, d'un droit de lecture, ou d'une part des revenus générés par l'œuvre ? De plus, la tokenisation pourrait comporter des risques pour les auteurs car il n'existe aujourd'hui pas de réglementation claire. Certains systèmes de tokens présentent des vulnérabilités facilitant leur piratage ou leur violation, et la complexité du système pourrait le rendre très coûteux et difficile à maintenir sur le long terme.
À l'instar de ce qu'on observe dans d'autres secteurs, relève Xavier Lavayssière, la tokenisation pourrait " démocratiser l'accès " aux investissements dans l'édition. Elle offrirait la possibilité à un plus grand nombre de personnes de devenir copropriétaires d'œuvres de valeur ou d'investir dans des œuvres émergentes.
Selon l'expert, la tokenisation permet de combiner la solidité des actifs traditionnels et la flexibilité des technologies blockchain. Pour l'édition, c'est peut-être l'opportunité de réconcilier patrimoine littéraire et innovation numérique dans un modèle économique renouvelé.
Éric Dupuy