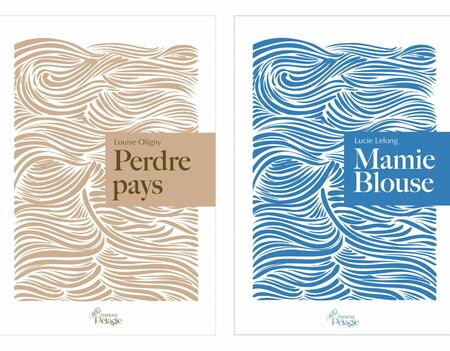Tout est de la faute des moissonneuses-batteuses. Après guerre, l'introduction massive de ces machines dans les champs de céréales du sud des Etats-Unis contraignit les ouvriers agricoles noirs, descendants d'esclaves, à l'exode vers les grandes villes du pays (et en particulier New York). Cet afflux de population provoquant des crispations dans les populations "autochtones", tandis que se développaient dans le même temps le mouvement des droits civiques et l'exigence pour les Afro-Américains que leur soit reconnue leur pleine et entière citoyenneté. Les années qui s'ouvrirent alors furent celles de la contestation, et les droits qui leur furent concédés le furent au prix du sang.
C'est cette histoire - de bruit et de fureur - que nous conte, dans La cité sauvage (New York 1963-1973), >le journaliste, scénariste et écrivain T. J. English, déjà auteur voici deux ans d'un remarquable Nocturne à La Havane (La Table ronde, 2010). Tout son récit s'articule autour d'un fait divers criminel qui défraya la chronique : le 28 août 1963, jour de la grande manifestation à Washington des Noirs pour la défense de leurs droits civiques (lors de laquelle le pasteur King prononça son immortel "I have a dream..."), furent sauvagement assassinées dans leur studio de Manhattan deux jeunes femmes blanches. La presse les surnomma les "career girls", et la police de New York (le fameux NYPD), que n'embarrassaient guère les codes de procédure pénale ni la plus élémentaire morale, eut relativement tôt fait de trouver un coupable idéal, un jeune Noir venu du New Jersey, pas loin d'être analphabète. C'est autour de ce personnage (et aussi autour des figures d'un flic corrompu et d'un activiste saisi en prison par la grâce de la "nation of Islam" et des Black Panthers), de cette victime expiatoire autour de laquelle vont se cristalliser les passions du temps, que T. J. English compose son livre, véritable "requiem des innocents" traversé par la folie et la mort. Depuis Ellroy, jamais New York n'avait été aussi proche de Babylone.