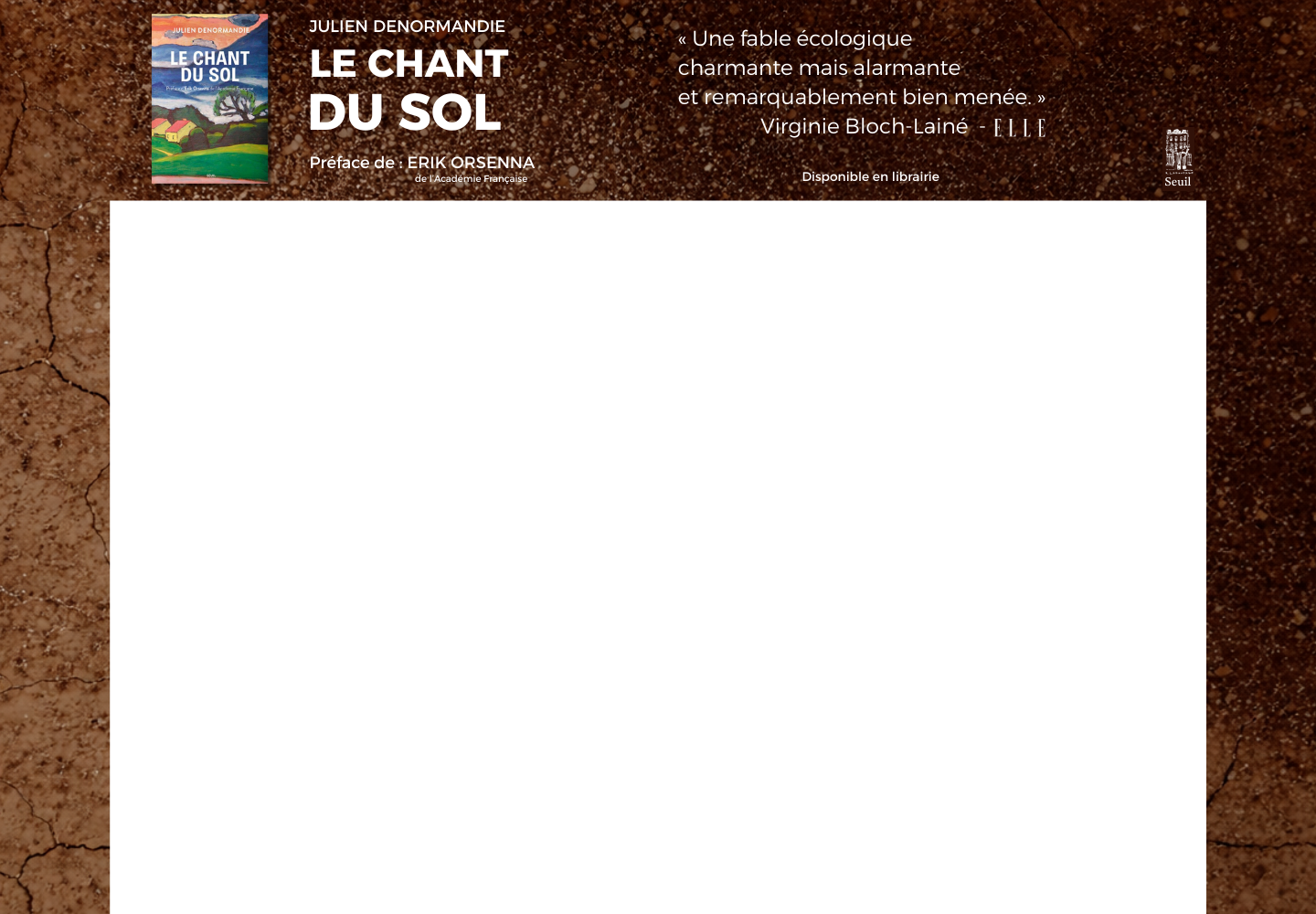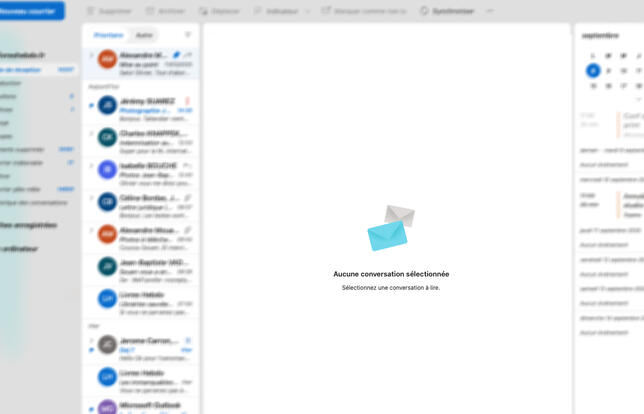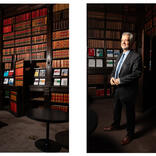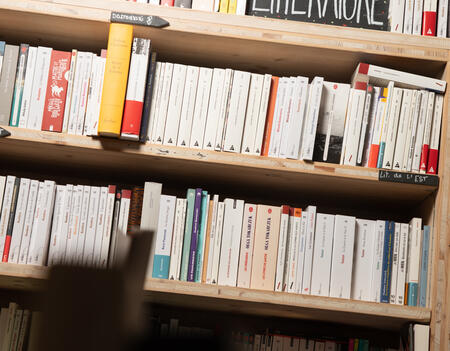Une salariée de librairie avait communiqué à son futur employeur, une autre librairie, des informations relatives à son travail dans le premier établissement. Afin de se défendre contre les agissements de sa salariée, la librairie avait fait des captures d’écran de la messagerie professionnelle de sa salariée afin de prouver des actes de concurrence déloyale.
Et la décision du Tribunal de commerce de Saintes du 2 juin 2025 (RG n° 2025R00014) tranche une question importante en droit de la preuve et en matière de vie privée dans ce cadre d’un contentieux de concurrence déloyale. L’ordonnance apporte une clarification sur le recours à la production de communications électroniques professionnelles comme mode de preuve et sur la proportionnalité de telles mesures d’instruction.
Les données du fichier client transmis au concurrent direct
Le nouvel employeur de la salariée, la librairie concurrente, avait assigné pour obtenir la rétractation de l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Saintes qui validait ces captures d’écran. Son principal argument reposait sur le fait que les captures d'écran produites seraient illicites et non proportionnelles, et qu'elles porteraient une atteinte jugée « trop importante » à la vie privée de la salariée. Il soutenait que la librairie avait eu accès à la messagerie personnelle de la salariée, violant ainsi le secret des correspondances et le respect de sa vie privée.
En réponse, la librairie, ancien employeur de la salariée, faisait valoir que son concurrent avait attendu une année entière avant de solliciter cette rétractation et surtout que son principal concurrent avait recruté son ancienne salariée qui avait emporté des fichiers clients. Ces agissements constituaient des actes de concurrence déloyale. Elle insistait aussi sur le fait que l'autorisation initialement donnée par le président du Tribunal pour la mesure d'instruction était conforme aux exigences de la Cour de Cassation à la suite de son arrêt du 22 décembre 2023 permettant de tenir compte d'éléments de preuve obtenus de manière déloyale.
Une décision rappelant les principes de la Cour de Cassation en matière de preuve
Pour confirmer l’ordonnance validant les captures d’écran, le tribunal rappelle que l'ordinateur professionnel de la salariée avait été remis spontanément par cette dernière après sa démission et a jugé que la mesure d'instruction ordonnée initialement était limitée dans son objet à l’examen des échanges entre la salariée et son nouvel employeur, qu’elle était considérée comme proportionnée et nécessaire pour tenter d’établir la preuve des faits de concurrence déloyale.
Il soulignait que les investigations et les pièces produites démontraient que la librairie n’avait prélevé aucune information étrangère au litige et n'avait pas empiété sur le périmètre exclusif de la vie privée de son ancienne salariée. En conséquence, le tribunal a conclu que la mesure autorisée par l'ordonnance attaquée était conforme à la jurisprudence de la Cour de Cassation du 22 décembre 2023, et que les éléments de preuve obtenus n'étaient ni illicites, ni déloyaux, ni attentatoires au caractère équitable de la procédure dans son ensemble.
Cette ordonnance confirme le principe de proportionnalité en matière de preuve : une mesure d’instruction portant sur des données professionnelles peut être admissible si elle est strictement limitée à l’objet du litige et qu’elle respecte la vie privée des personnes concernées. Elle illustre l’arbitrage entre le droit à la preuve et le droit au respect de la vie privée, dans le contexte croissant d’utilisation de données numériques professionnelles.
La décision réaffirme également que l’autorisation judiciaire préalable et la remise volontaire du matériel informatique sont des garanties indispensables au respect du secret et de la loyauté de la preuve.
Équilibre entre établissement de la preuve et protection des droits des personnes
Ce jugement apporte une solution équilibrée entre la nécessité d’établir la preuve dans les litiges commerciaux et la protection des droits fondamentaux des personnes, notamment leur vie privée dans le cadre de l’usage professionnel d’outils numériques. La rigueur procédurale et la proportionnalité sont des critères centraux pour l’admissibilité de preuves électroniques.
Alexandre Duval-Stalla

Olivier Dion - Alexandre Duval-Stalla
Alexandre Duval-Stalla est avocat au barreau de Paris et écrivain. Ancien secrétaire de la Conférence du barreau de Paris (2005) et ancien membre de la commission nationale consultative des droits de l’homme, il est le président fondateur de l’association Lire pour en sortir, qui promeut la réinsertion par la lecture des personnes détenues, et du prix littéraire André Malraux.
Pour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.