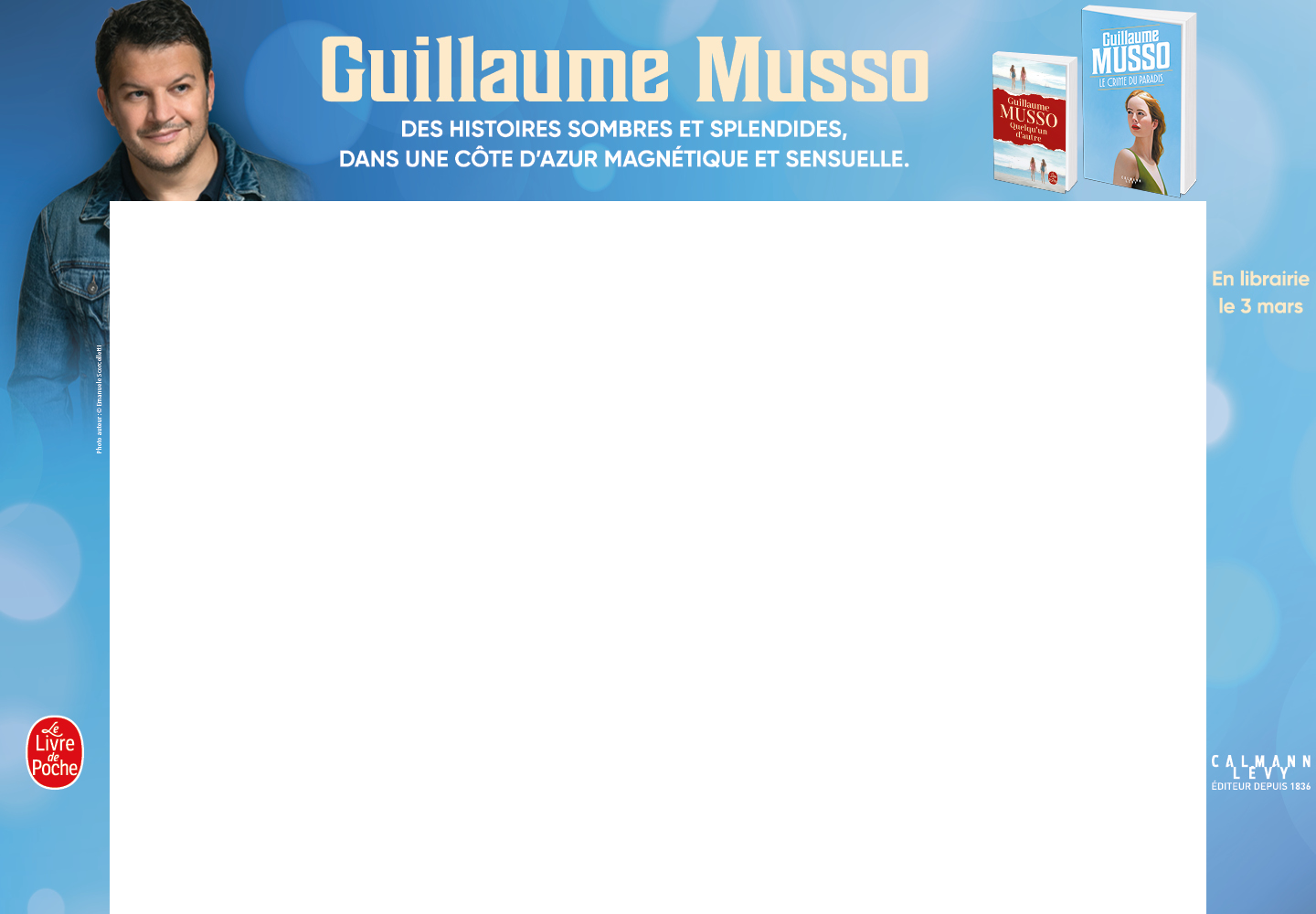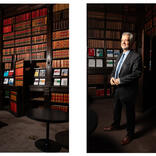Dans un message solennel aux évêques des États-Unis le 10 février 2025, le pape François, décédé le 21 avril à l'âge de 88 ans, avait adressé l'équivalent d'un testament philosophique où il développait une réflexion de haute teneur morale et juridique sur l’État de droit, notamment au regard de la question migratoire.
Loin d’être purement théologique ou pastoral, ce texte s’inscrit dans une perspective engageante pour tout État de droit soucieux de respecter les droits fondamentaux. La migration y devient un prisme révélateur de la manière dont les institutions juridiques, nationales et internationales traitent la dignité humaine, principe fondateur de tout ordre juridique démocratique.
La dignité humaine comme fondement de la légitimité juridique
Dans ce message, le pape François affirmait avec force que « La valeur la plus importante que possède la personne humaine dépasse et soutient toute autre considération juridique. » Une vision personnaliste du droit, selon laquelle la dignité humaine constitue la norme des normes, le critère ultime à l’aune duquel toute législation doit être évaluée. Une telle position s'inscrit dans la lignée des grands textes fondateurs, comme la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 (art. 1er) et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (préambule et article 1er).
À travers cette hiérarchie des valeurs, le pape critiquait implicitement le positivisme juridique, qui érige la loi en autorité suprême sans interrogation sur sa justice intrinsèque. En réaffirmant que le droit ne saurait être légitime s’il contrevient à la dignité de la personne, il rejoint la pensée des juristes du droit naturel, selon lesquels la loi injuste n’est pas une véritable loi (Lex iniusta non est lex).
L’État de droit authentique comme garant des plus vulnérables
Le pontife dénonçait aussi toute politique de déportation massive qui, sous couvert de légalité, viole les droits fondamentaux des migrants. Il rejetait avec vigueur l’assimilation du statut migratoire irrégulier à une infraction pénale, rappelant que nombre de migrants fuient des situations de pauvreté extrême, de guerre ou de persécution. Il appelait à un usage proportionné et éthique du pouvoir régalien, rejoignant ainsi les exigences de l’État de droit, qui suppose que la loi respecte les droits fondamentaux même lorsqu’elle est formellement adoptée. Il soulignait surtout que la qualité d’un État de droit se mesure au sort réservé aux plus faibles. Le respect de la dignité humaine dans les politiques migratoires constitue une obligation positive pour l’État, lequel doit intégrer les principes d’égalité, de non-discrimination et de protection effective des droits fondamentaux.
La fraternité comme horizon juridique et politique
En affirmant que la personne se construit dans la relation, notamment avec les plus démunis, le pape François proposait dans ce message une anthropologie juridique fondée sur la fraternité comme lien social. Il dépassait ainsi une vision individualiste des droits, en soulignant leur dimension communautaire et solidaire, une approche s’inscrivant dans une logique de droit de la reconnaissance, proche des travaux de juristes comme Paul Ricœur. Le texte mettait aussi en garde contre l’utilisation idéologique de la défense de l’identité nationale, qui risque de légitimer des pratiques juridiques fondées sur l’exclusion. Il appelait à rejeter les murs d’ignominie pour bâtir des ponts de fraternité.
Résonnant comme un avertissement solennel contre les tentations de l’affaiblissement de l’État de droit, le pape François ne proposait donc pas seulement une lecture théologique de la migration, mais bien une doctrine juridique et politique exigeante, fondée sur la dignité humaine comme clef de voûte de l’État de droit. En ce sens, il invitait les États à repenser leurs politiques publiques, non à partir de la seule légalité, mais à partir de la justice et de l’humanité. Rappelant ainsi que la vérité essentielle qu'est le droit, pour être pleinement tel, ne peut faire l’économie d’un regard éthique sur sa finalité et ses effets.
Au moment de la célébration des 75 ans de la Déclaration universelle des droits de l’homme, le pape François rappelait qu’il était « proche de tous ceux qui, sans faire de proclamations, dans leur vie concrète de tous les jours, luttent et paient de leur personne pour défendre les droits de ceux qui ne comptent pas ». Le combat continue.
Alexandre Duval-Stalla

Olivier Dion - Alexandre Duval-Stalla
Alexandre Duval-Stalla est avocat au barreau de Paris et écrivain. Ancien secrétaire de la Conférence du barreau de Paris (2005) et ancien membre de la commission nationale consultative des droits de l’homme, il est le président fondateur de l’association Lire pour en sortir, qui promeut la réinsertion par la lecture des personnes détenues, et du prix littéraire André Malraux.
Pour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.