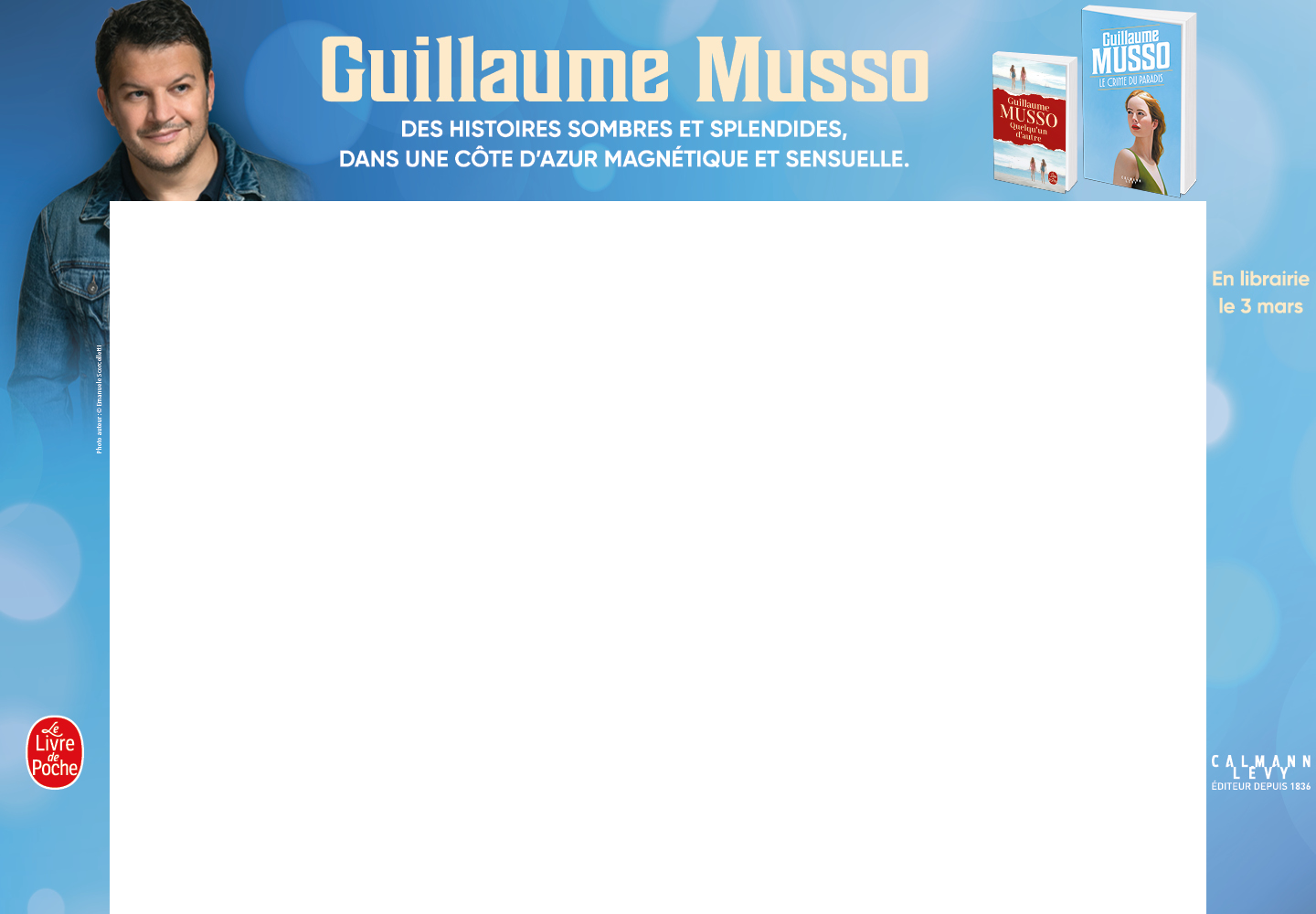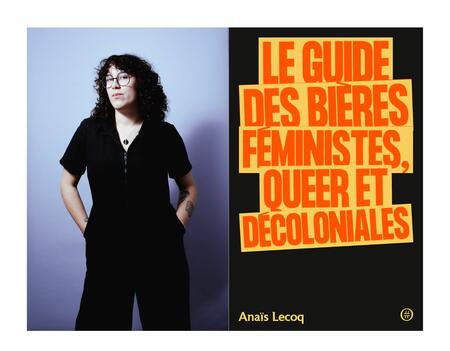Livres Hebdo : Dans quel contexte est née [barzakh] ?
Selma Hellal et Sofiane Hadjadj : En 1999, Abdelaziz Bouteflika est élu président de l'Algérie pour tenter de faire renaître le pays. Cette élection marque la fin de la décennie noire, la guerre civile. Nous portons alors beaucoup d'espoir et le sentiment que tout reste à reconstruire. Pendant cette décennie, la plupart des écrivains algériens sont partis en France, au Maroc, au Liban ou encore en Égypte, où ils ont été publiés. Nous créons [barzakh] en avril 2000. Nous souhaitons révéler des voix algériennes, qu'elles soient nouvelles ou confirmées, et les accompagner du mieux possible en Algérie mais aussi dans l'espace francophone. Dès les premières années, nous avons édité Mustapha Benfodil (Zarta !, 2000), Mohammed Dib (L'aube Ismaël, 2001) ou encore Maïssa Bey (Entendez-vous dans les montagnes..., 2002). À cette époque, nous sommes l'une des seules maisons à investir le champ de la littérature. D'autres auteurs et autrices ont donc rapidement rejoint notre catalogue comme Kamel Daoud ou Kaouther Adimi, pour ne citer que les plus connus aujourd'hui.
Vous n'éditez que de la littérature ?
Publier de la littérature en Algérie implique nécessairement de raconter l'histoire de ce pays, avec ses deux millénaires d'existence et la cassure de cent trente ans marquée par la colonisation. L'édition française a participé à la fabrication de l'histoire de l'Algérie. Aussi, il nous paraît important de raconter l'Algérie depuis l'Algérie en proposant des essais historiques, comme celui de Malika Rahal (Algérie 1962. Une histoire populaire, coédité avec La Découverte, 2022). Notre ligne éditoriale est guidée par le souci de réhabiliter l'art du récit. Il nous permet de nous raconter par nous-mêmes, que ce soit par la fiction, l'essai ou l'art. C'est un enjeu politique car c'est le seul moyen de résister aux discours dominants, d'où qu'ils viennent et quelle que soit leur nature. Nous faisons nôtre cette profession de foi de l'historien Patrick -Boucheron, en se référant à Michel Foucault : « Si l'on veut ne pas se laisser gouverner, il faut reprendre pied dans le récit de nos vies. » C'est ce que nous nous employons à faire.
L'année 2013 est un point de bascule avec la publication de Meursault, contre-enquête de Kamel Daoud. Qu'est-ce que cela a changé pour vous ?
Cinq ans après notre première rencontre avec Kamel Daoud, nous éditons son premier roman, Meursault, contre-enquête, en octobre 2013. Nous cédons les droits à Actes Sud pour sa publication en France. Sorti en mai 2014, le roman a notamment été finaliste du Goncourt et lauréat du Goncourt du premier roman. Le livre se vend à 300 000 exemplaires, les droits sont cédés dans une trentaine de langues, il est adapté au théâtre et au cinéma. Pour nous, c'est un changement majeur. Même si nous avions eu en 2010 la prestigieuse distinction du prix du prince Claus, aux Pays-Bas - un jalon capital dans notre parcours, ce livre est marquant en termes de reconnaissance de notre travail, d'un point de vue financier aussi. Le -succès de Meursault, contre-enquête montre par ailleurs qu'une fiction sur la problématique postcoloniale peut interroger le monde contemporain.
À l'image de Meursault, contre-enquête, vous portez une stratégie assez unique de cession de droits ou de coédition de vos livres à destination de la France. Pourquoi ?
Cette stratégie est née de contraintes. Nous avons essayé d'exporter nos livres. Mais en Algérie, les exportations sont très surveillées et contrôlées. Le système de réassort français n'est pas compatible avec le système algérien. Nous vendons donc les droits de 90 % de nos livres ou nous les coéditons. Cela nous semble désormais une bonne stratégie. Il nous paraît important que nos auteurs et autrices publient leurs ouvrages dans une perspective à la fois algérienne et universelle. Une équation parfois insoluble. Et c'est un symbole très fort dans le rapport de force toujours complexe entre la France et ses anciennes colonies. Nous essayons d'instituer un rapport plus vertueux. Sur le plan de la géopolitique de l'édition, c'est un changement de paradigme radical qui renverse le traditionnel rapport « dominant/dominé », « centre/périphérie ». Un lent rééquilibrage s'opère. Une autre carte se profile en filigrane, différente de celle polarisée par les grands groupes : une carte plus complexe, archipélique, celle d'un monde éditorial multipolaire. Depuis sa marge et à sa manière, [barzakh] y figure comme force de proposition et pôle d'énonciation.
Cette stratégie est-elle vitale à [barzakh] d'un point de vue économique ?
L'édition algérienne est d'une grande fragilité. Nous n'avons pas d'organisme professionnel de distribution. Sous la pression démographique et l'inflation des loyers commerciaux, de nombreuses librairies sont contraintes de fermer. Il n'existe pas de soutien massif à la librairie. Les salons du livre et les événements sont extrêmement importants pour pouvoir vendre des livres en Algérie. Le développement vers la France - avec les cessions de droits et les partenariats mais aussi les adaptations au théâtre et au cinéma - nous maintient donc en vie et contribue de manière décisive à notre survie financière.
Comme d'autres pays francophones, l'Algérie est-elle sujette à un raz-de-marée éditorial venu de l'Hexagone ?
Peu de livres français arrivent en Algérie. Contrairement à la Suisse, la Belgique ou le Québec, l'importation de livres est quasiment à l'arrêt. Pour préserver les réserves de change, le gouvernement algérien réduit les importations. Tout n'est pas disponible sur le territoire mais l'économie reste à l'équilibre.
Depuis un an, les relations entre la France et l'Algérie sont mises à mal par l'arrestation de Boualem Sansal puis par l'assignation en justice de Kamel Daoud. Quel regard portez-vous sur ces deux affaires ?
Quels que soient les points de vue, tout cela nous touche humainement. Il nous est difficile d'envisager sereinement notre travail. Jusqu'ici, il était stimulant de publier des livres. Maintenant, nous marchons sur des œufs. De manière générale, nous sommes pris dans quelque chose qui nous dépasse depuis deux-trois ans. Le paradigme populiste devient un nouveau narratif, y compris dans l'édition. La guerre en Ukraine questionne l'Europe sur sa propre identité. Les relations des pays africains décolonisés avec la France sont perturbées. Le génocide à l'œuvre en Palestine nous confronte à l'« innommable », pour reprendre un titre de Beckett. Il suscite des polarisations insoutenables et repose de manière urgente la question de l'engagement, celle du rôle possible, ou impossible, de la littérature pour dire, témoigner et dénoncer l'abomination. Tout ceci nous concerne toutes et tous. Cela perturbe aussi notre rapport à l'écriture, aux thématiques abordées, à notre métier même. Il semble exister tant d'angles morts et de lignes rouges qu'il est difficile de savoir dans quelle direction l'édition littéraire doit avancer.
En 2022, l'Algérie a fêté ses 60 ans d'indépendance. Voyez-vous apparaître des mutations de la société algérienne qui pourraient également perturber votre travail d'édition ?
Comme l'ensemble des pays du Maghreb, l'Algérie est un pays jeune, décolonisé et francophone. Un travail d'arabisation de la société a été engagé de manière graduelle et s'est accéléré depuis trois ans. L'enseignement est arabisé et la deuxième langue est devenue l'anglais. Nous en sommes les premiers déroutés. Il y a quatre ans, nous en minimisions l'importance. Aujourd'hui, nous nous rendons à l'évidence, ne serait-ce que par une observation empirique : nous recevons de plus en plus de manuscrits en anglais. C'est très symptomatique. Publier des livres en français en Algérie reste pertinent mais nous allons devoir nous réajuster. La littérature produite aujourd'hui en Algérie s'écrit de plus en plus en arabe. C'est la raison pour laquelle nous avons créé la collection « Khamsa » avec Philippe Rey il y a deux ans pour révéler des textes contemporains du Maghreb, traduits depuis l'arabe et porteurs d'un imaginaire dont la richesse et la texture sont inédites. Nous devons accompagner ces voix arabophones et les rendre disponibles en français.
De quelle manière envisagez-vous l'avenir ?
Dans notre société patriarcale et conservatrice, les femmes se sont depuis longtemps emparées de l'écriture mais le mouvement est aujourd'hui massif. Nous voulons accompagner ce vecteur d'émancipation qu'est la littérature. L'adversité de notre quotidien s'est accrue. Mais nous avons la certitude qu'il reste des histoires à raconter, des voix à faire entendre. L