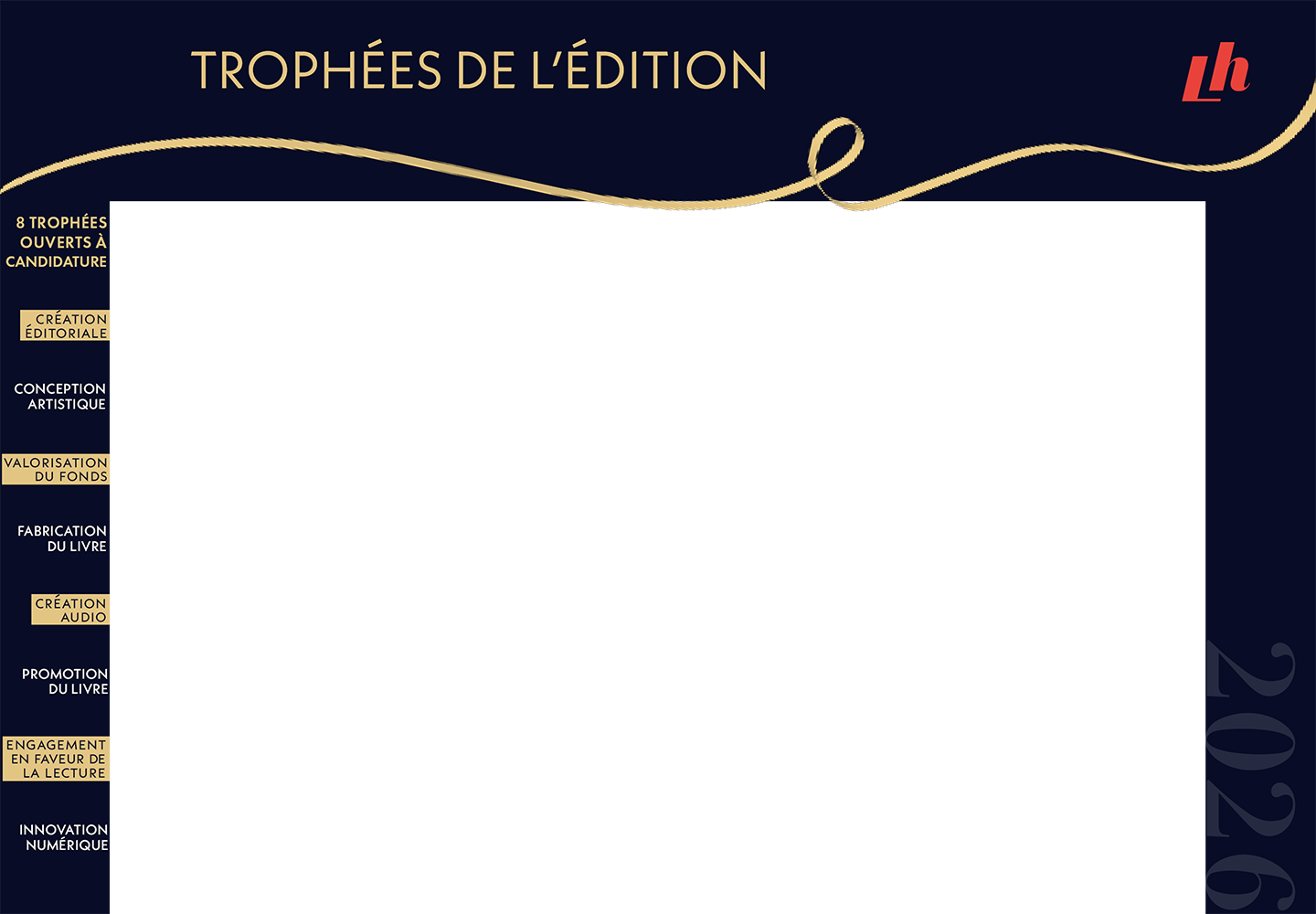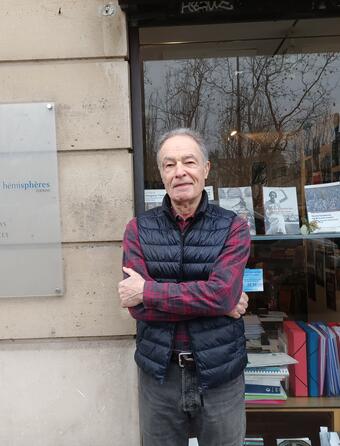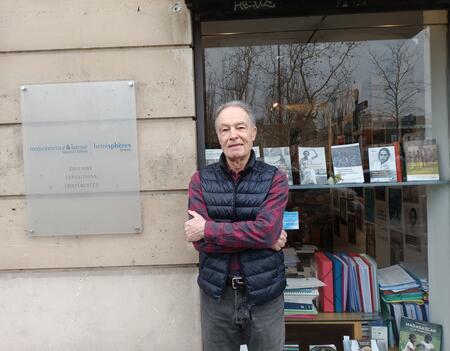Petites précisions sur la fin du monde d'Yves Cochet (Les Liens qui libèrent). Créer des ponts entre les mondes (TP) de Gabrielle Halpern (Fayard). Choisir l'avenir. 10 questions sur le monde qui vient de Nicole Gnesotto (CNRS éditions). À eux trois, ces titres résument le fil conducteur adopté par les maisons en cette rentrée d'essais et documents. Laquelle compte, au 3 juin, 1 396 titres programmés d'août à octobre selon Electre Data Services (-6 % par rapport à l'an passé). Les catalogues s'emparent massivement de thématiques devenues habituelles et incontournables comme l'écologie, les luttes LGBT+ et féministes, ou la politique. Mais après de très nombreuses parutions sur ces sujets, le cru de l'été 2024 est marqué par un déplacement du regard et des approches plus pointues.
L'artiste et activiste féministe Flor de Fuego le 15 mai 2024, peu avant l'élection de la première femme présidente du Mexique Claudia Sheinbaum.- Photo CARL DE SOUZA - AFPPour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.
Tsunami vert
En matière d'écologie, Eryck de Rubercy dresse la synthèse de toutes les connaissances sur les arbres et les forêts, explorant notamment leur rôle dans la lutte contre le réchauffement climatique dans L'univers des arbres (Bouquins). Dans Rendre l'eau à la terre (avec les illustrations de Suzanne Husky, Actes Sud), Baptiste Morizot promeut une alliance avec le castor pour développer la biodiversité et les écosystèmes. Jeremy Rifkin donne à voir un futur à l'aune des conséquences du dérèglement climatique dans Planète Aqua (traduit par Paul Chemla, Buchet-Chastel).
Lever de soleil sur la bande de Gaza le 7 juin 2024.- Photo BASHAR TALEB - AFPPour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.
De son côté, Aude Vidal analyse les dégâts écologiques, mais aussi culturels et sociaux, qu'engendre le tourisme dans Dévorer le monde (Payot). Peter Frankopan raconte comment les épisodes climatiques ont façonné l'histoire humaine dans Les métamorphoses de la Terre (Tallandier). Dans Polluer, c'est coloniser (traduit par Valentine Leÿs, Amsterdam), Max Liboiron interroge les ambiguïtés du recyclage et du nettoyage en montrant la mise en place de rapports coloniaux à la terre. Dans le catalogue de La Découverte, Pierre Charbonnier explore les liens entre guerre, paix et nature dans Vers l'écologie de guerre. Une histoire environnementale de la paix. La Plage lance une série Urgence écologique avec quatre titres : Le monde de l'influence face à l'urgence écologique, Le monde de la mode face à l'urgence écologique, Le monde du journalisme face à l'urgence écologique et Le monde de la gastronomie face à l'urgence écologique.
Avec Hydrogène mania (Le Passager clandestin), Aline Nippert enquête sur la réalité de l'industrie hydrogène qui permettrait de résoudre le problème du réchauffement climatique sans compromettre l'idéal de croissance. Théo Hareng part à la découverte des Écolieux français (Terre vivante). Marine de Guglielmo et Rémi Noyon présentent des projets insolites pensés pour lutter contre la crise climatique dans Climat d'urgence (Les Liens qui libèrent). Sous la direction de Baptiste Lanaspeze et Paul-Hervé Lavessière, plusieurs personnes livrent des clés pour concevoir des politiques territoriales écologiques cohérentes dans Villes terrestres (Wildproject). Géraldine Woessner et Erwan Seznec optent pour une enquête sur le milieu de l'écologie politique dans Les illusionnistes (Robert Laffont) tandis que Jean de Kervasdoué embarque pour « un voyage hallucinant chez les Verts » et dénonce le dogmatisme des écologistes dans La grande mystification (Albin Michel).
L'urgence #MeToo
Les vagues successives de parutions depuis 2018 n'ont pas freiné la volonté des maisons d'éclairer les luttes féministes. Mêlant écologie et antiracisme, Alexis Pauline Gumbs s'inspire des mammifères marins pour tirer des « leçons féministes noires » dans Non-noyées (Les Liens qui libèrent). Johanna Luyssen rend compte du « combat invisible des mères célibataires », dont 35 % vivent sous le seuil de pauvreté, dans Mères solos (Payot). Après la bible Notre corps, nous-mêmes (2020), Hors d'atteinte poursuit son travail de traduction de manuels féministes en se concentrant cette fois sur la parentalité avec Nos enfants, nous-mêmes.
Dans Ce que je veux sauver (Anne Carrière), Peggy Sastre milite pour recentrer la lutte sur les droits reproductifs, l'autonomie juridique et financière ou encore la libre disposition de son corps. Sophie Coste étudie ce qui incombe aux Gestes de femmes (Philippe Rey), qui sont associés à la sphère domestique, tandis que Soumaya Mestiri lance un appel Pour un féminisme décentré (Le Cavalier bleu). Laura Tripaldi interroge le rapport entre genre et technologie dans Gender tech (Lux, traduit par Muriel Morelli). Alors que le cinéma français contribue d'être ébranlé par les accusations de violences sexuelles, Geneviève Sellier explique comment Le culte de l'auteur (La Fabrique) a créé la possibilité de ces abus.
Claude Habib interroge les disparités entre public et privé, centrées sur le droit des femmes, dans Le privé n'est pas politique (Gallimard). De son côté, Caroline Fourest cherche à « trouver l'équilibre après la nouvelle révolution sexuelle » dans Le vertige MeToo (Grasset). Dans la lignée de son personnage de sexologue dans la série Sex education, l'actrice américaine Gillian Anderson montre la diversité de Nos désirs (Denoël) en racontant « 174 fantasmes féminins du monde entier » recueillis à travers des lettres qui lui ont été adressées.
Au chevet du monde
Les maisons d'édition se font aussi l'écho des luttes féministes dans d'autres pays. Trois ans après la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan, Fawzia Koofi raconte ses combats pour faire évoluer le statut des femmes dans Lettres à mes sœurs (Michel Lafon). En 2022, la mort de Jina Mahsa Amini provoque de vives manifestations en Iran, sous le slogan « Femme, vie, liberté ». Kamyar Abbasi et Marine Courtade donnent la parole aux acteurs et actrices de la révolte iranienne dans Femme, vie, liberté (Rocher). Le Mouvement de libération des femmes et l'Alliance des femmes pour la démocratie retracent le combat Des Iraniennes (Des femmes - Antoinette Fouque). Philippe Lemoine revient sur la manière dont le slogan iranien est devenu mobilisateur au niveau international dans L'aventure du XXIe siècle (L'Aube). Se faisant passer pour une touriste, la journaliste Anne-Isabelle Tollet fait le récit de son Voyage interdit (Cherche midi) en Iran et y raconte le pays depuis 2022.
L'actualité sanglante de Gaza depuis le 7 octobre dernier continue de trouver un relai dans les programmes. Plusieurs titres retracent cette terrible journée : Et nous danserons encore de Sébastien Spitzer (Albin Michel), Samedi rouge de Daniel Haïk (L'Archipel), Les portes de Gaza d'Amir Tibon (traduit par Colin Reingewirtz, Bourgois). Ibrahim Khashan raconte La vie sous les bombardements (traduit par Samia Mallié et Gérard Blot, Le Temps qu'il fait). Pour mieux comprendre le conflit, Mohamed Sifaoui décrypte le Hamas, plongée au cœur du groupe terroriste (Rocher). Didier Fassin dénonce le soutien occidental au massacre de la population gazaouie dans Une étrange défaite (La Découverte) et Denis Charbit observe Israël, l'impossible État normal (Calmann-Lévy).
Enfin, alors que les élections présidentielles aux États-Unis approchent, François Heisbourg imagine Un monde sans l'Amérique (Odile Jacob) et Amy K. Greene interroge L'Amérique face à ses fractures (Tallandier). Laurence Nardon explique La géopolitique de la puissance américaine (Puf) tandis que Jacques Baud analyse « la guerre de tous les dangers » dans Chine-États-Unis (Max Milo). De quoi aider lecteurs et lectrices à mieux se repérer dans un monde en mouvement permanent.
Pression sur l'école
Si la politique française concentre quelques titres, notre système éducatif est particulièrement sous le feu des critiques. Jean-Pierre Terrail décrypte La crise de l'école et les moyens d'en sortir (La Dispute). Pascal Clerc déplore dans Émanciper ou contrôler ? (Autrement) la manière dont l'école enferme les espaces et les esprits. Chez L'Aube, Philippe Meirieu appelle à abandonner les modèles de sélection et d'exclusion dans Éducation, rallumons les Lumières ! quand Yannick Trigance rappelle l'importance de la Mixité sociale et scolaire. François Dubet et Marie Duru-Bellat regrettent L'emprise scolaire (Presses de Science Po) et souhaitent atténuer l'hégémonie de l'école sur les notions d'intelligence et de mérite. Proposant des pistes de solution, Isabelle Peloux raconte avec la journaliste Anne Lamy comment elle a fondé en 2006 l'école du Colibri, reposant sur un apprentissage actif et la coopération entre les élèves, dans Coopérer pour s'élever (Actes Sud). Anne Lamy explique également Les bienfaits de l'école à ciel ouvert (La Salamandre) avec Diane Galbaud du Fort et Sabine Muster.
Préférences système
Plusieurs catalogues entendent donner voix à la communauté LGBT+. Sous la direction de Chacha Enriquez, Sexualités et dissidences queers (Remue-Ménage) démystifie l'emprise qu'exercent les normes sur les sexualités. Au diable Vauvert propose une nouvelle traduction du Manifeste contra-sexuel de Paul B. Preciado signée par Vanasay Khamphommala. Chez Divergences, Mickaël Tempête livre une « histoire politique de l'homophobie » avec La gaie panique, tandis que Sophie Pointurier et Sarah Jean-Jacques s'intéressent dans Le déni lesbien (HarperCollins) à « celles que la société met à la marge ». Dans une logique intersectionnelle, Sara Ahmed publie Obstinées (Hystériques & AssociéEs), un panorama de débats sur le féminisme, la théorie queer ou encore les personnes racisées. Une lutte en cachant une autre, deux titres explorent la notion de privilège blanc. Quand Solène Brun et Claire Cosquer interrogent La domination blanche (Textuel), du côté des personnes discriminées mais aussi des dominantes, Estelle Depris explique « comment identifier et déjouer » la Mécanique du privilège blanc (Binge audio éditions).
Dix essais immanquables
Après les succès retentissants de Sorcières et Réinventer l'amour, respectivement publiés en 2018 et 2021 chez Zones, Mona Chollet se penche cette fois sur le sentiment de culpabilité. Dans Résister à la culpabilisation (Zones), la journaliste montre comment et pourquoi ce sentiment est bien plus présent chez les enfants, les femmes et les minorités sexuelles ou racisées. Deux ans après avoir reçu le prix Albert-Londres du livre pour Les fossoyeurs (Fayard) dans lequel il dévoilait le scandale des Ehpad et du leader mondial Orpéa, Victor Castanet arrive chez Flammarion avec une nouvelle enquête, cette fois consacrée aux crèches privées. Le titre de son livre n'est pas connu à l'heure où nous rédigeons ces lignes. Toujours chez Flammarion, Judith Butler publie la suite de Trouble dans le genre (disponible dans le catalogue de La Découverte). Avec Qui a peur du genre ?, la philosophe américaine examine de quel fantasme le genre est devenu le nom, quelles haines il génère et pourquoi. Signe d'une volonté des lecteurs et lectrices de mieux comprendre le monde dans sa globalité, les atlas du Dessous des cartes tirés de l'émission éponyme diffusée sur Arte s'écoule à près de 30 000 exemplaires par an. Pour le huitième volume, Émilie Aubry et Frank Tétart se concentrent sur La puissance et la mer (Tallandier). Le président de Reporters sans frontières Pierre Haski adapte quant à lui son podcast Décolonisations africaines, diffusé par France Inter, dont l'ouvrage du même nom est au programme de Stock. Après l'enquête de Thomas Jusquiame sur les dispositifs de surveillance dans Circulez. La ville sous surveillance (Marchialy, avril 2024), c'est au tour de Félix Tréguer de se plonger dans la Technopolice. La surveillance policière à l'ère de l'intelligence artificielle (Divergences). Enfin, comme à chaque rentrée, quelques personnalités politiques prennent la plume. C'est notamment le cas de la députée Sandrine Rousseau avec Ce qui nous porte. Climat, immigration, solidarité (Seuil) et de Jean-Michel Blanquer. Dans La citadelle (Albin Michel), l'ancien ministre de l'Éducation nationale raconte la difficulté à mettre en œuvre des réformes sur le long terme. Enfin, les jeunes générations prennent la parole. L'écologiste britannique de 21 ans Bella Lack met en lumière les parcours des « jeunes au cœur de la crise climatique » dans Les enfants de l'anthropocène (traduit par Anne Steiger, Actes Sud). Et avec Les jeunes, c'est le présent ! (Payot), le streamer politique Jean Massiet, qui compte 235 000 followers sur Twitch, livre un plaidoyer pour que la jeunesse prenne sa place dans l'espace politique et public.