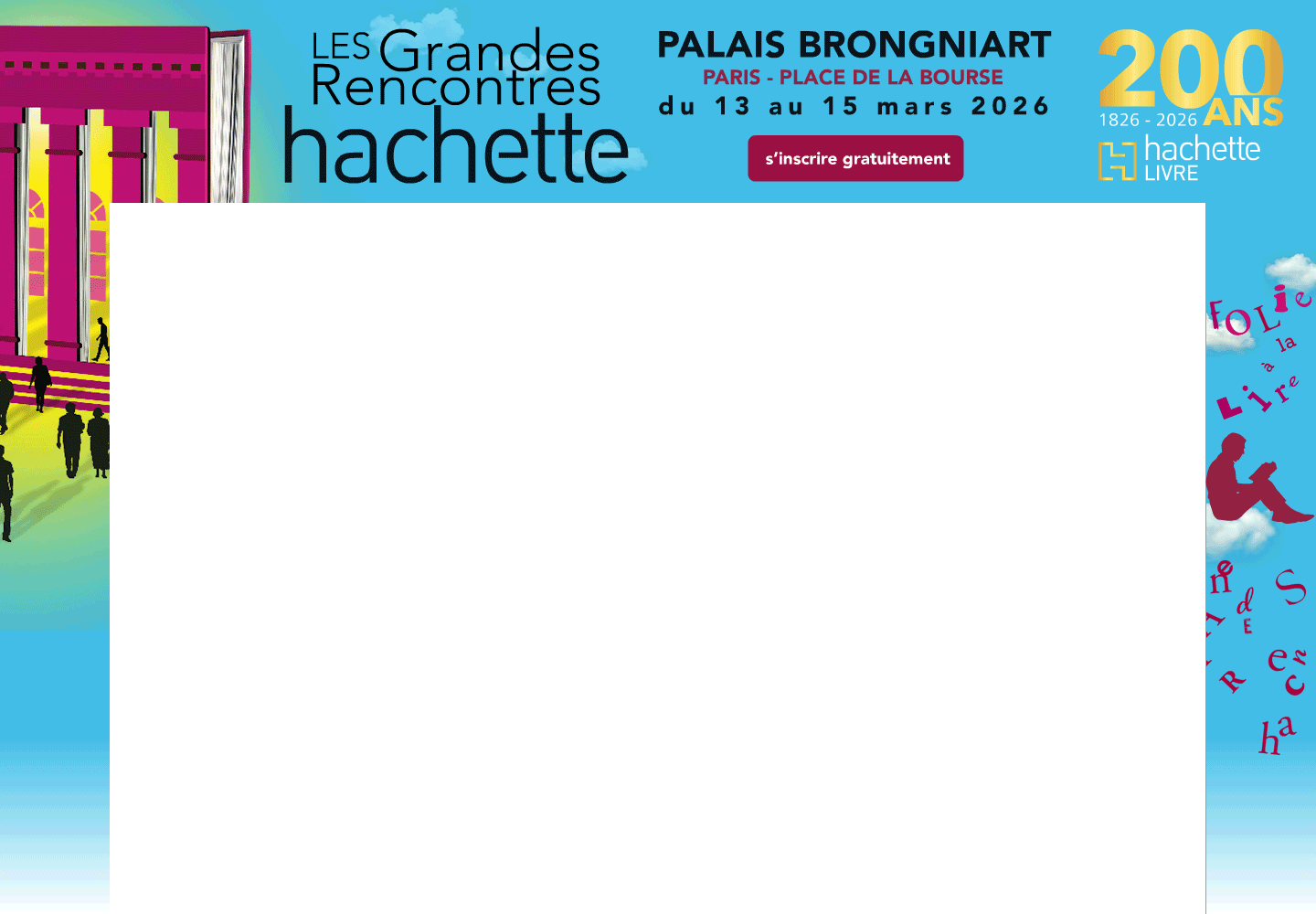Les premières critiques sont bonnes pour votre nouveau roman, Le grand monde ?
Je ne lis jamais les articles. Ça me met le moral à zéro, surtout quand je suis en période de promotion. C’est ma femme qui est chargée de ça. Elle me dit quand c’est bon ou quand ça ne l’est pas. Mais globalement la presse a toujours suivi mon travail avec pas mal de bienveillance.
Cette vulnérabilité provient peut-être de vos débuts tardifs, il y a quinze ans ?
C'est possible. L’avantage de l'âge c'est que vous vous fabriquez des airbags. Mais, vous avez raison, c'est aussi une question d’expérience. A force d'avoir pris des coups, vous apprenez à y résister. En plus j'ai commencé de manière un peu fulgurante. Alors ça n'aide pas non plus. J’avais 60 ans, je passe en littérature blanche, je rafle le Goncourt, on vend 600 000 exemplaires. C’est une histoire tellement extravagante que ça biaise. Je n’ai pas l'habituation que peuvent avoir certains de mes confrères.
Le grand monde est le début de votre deuxième trilogie, sur les Trente Glorieuses, après celle des Enfants du désastre. Quand vous avez écrit Au revoir là-haut, c’était déjà votre intention ?
Mon projet est d’articuler trois trilogies. Puis je me suis fait piéger par des choses que je n'ai pas vu venir. On peut parler technique narrative ?
Allons-y…
Une saga familiale répond à des règles de fabrication tout à fait particulière, notamment vous êtes obligé de conduire plusieurs fils narratifs qui doivent avoir des autonomies et même temps se tisser pour se répondre. C'est une mécanique un petit peu compliquée. Or, je ne m'étais pas rendue compte quand j'ai décidé de faire ça que si je faisais une trilogie sur les Trente Glorieuses, il allait se passer pas loin de dix ans entre chaque livre. En dix ans, un personnage dans la vie ne vieillit pas vraiment, mais dans un roman, il vieillit beaucoup. Un personnage qui a 22 ans et passe à 32 ans, c’est un célibataire qui devient père de trois enfants. A l’époque, on fait beaucoup de bébés. Donc si vous voulez je perds un peu mes personnages. Sur quatre, cinq ans, on peut faire des hypothèses, sur dix ans c’est beaucoup plus difficile. Je vais ramer, mais le lecteur aussi va ramer. Aussi, j'ai raccourci le délai entre les livres, en partant de 1948 et en arrivant en 1966. Soit avant la fin des Trente Glorieuses, dans les années 1970, et avant mai 68. Je resserre ainsi la narration pour que le lecteur ait le plaisir de retrouver les personnages, sans trop de manque.
Vous appuyez-vous sur un document pour ne pas perdre le fil ?
J'ai un arbre généalogique avec les dates où les personnages se rencontrent, où ils font des enfants, les dates de conceptions, même pour les prématurés… Si vous voulez que les choses tiennent debout, vous construisez un échafaudage solide. Il y a quelque chose dans le roman feuilleton, c'est la connivence avec le lecteur : on va l'emmener sur les fausses pistes, on va le tromper, avec brio si possible, mais il faut le faire avec honnêteté. Quand le lecteur ne voit rien venir, c’est ce qu’il y a de mieux. Cela veut dire que le rebondissement est réussi. Et en tant qu’écrivain, quand j’arrive à un tel twist, je suis content.
Comme celui au deux tiers du livre ?
Ce twist est lui-même lié à un piège. Le choix de placer la famille Pelletier à Beyrouth, c’est un piège narratif. Si vous lisez la fin d’Au revoir là-haut, c’est à Beyrouth qu’il va. C'est marqué et je suis prisonnier de ça. En 2013, c’est là que je l’ai mis. La hantise du feuilletoniste c’est d’avoir écrit un truc qu’il regrette. Et on ne peut pas tricher avec le lecteur… J’ai donc un roman d’avance. J’ai corrigé Le grand monde en écrivant la suite.
Votre roman fourmille de détails. Comment travaillez-vous en amont ?
Je mets six mois à me documenter, avec ma collaboratrice, l’historienne Camille Cléret, et un an à écrire. C’est un feuilleton, dans la grande tradition française. Il est populaire, je le revendique, parce qu’on peut le faire lire à tous. Je travaille sur l’illusion historique. Je ne suis pas historien, je suis un romancier. Je me dis je vais aller au Vietnam alors que je déteste voyager. Confinement ! L’annulation du voyage m’a presque fait renoncer à ce livre. Mais à cette époque-là, je relisais Jules Verne. Lui, il nous emmène Michel Strogoff dans les steppes de l'Oural sans jamais y avoir foutu les pieds. Je me suis dit que j’allais travailler sur l'illusion romanesque, c’est-à-dire que je vais essayer de vous donner l'impression qu’on y est. Il y a un certain nombre d’indices saillants qui fait que l’on va entrer dans le lieu et dans l’époque. Si vous ne vous y prenez pas trop mal, avec quelques odeurs de marchands ambulants, avec « la pluie qui tombe sur la carrosserie comme du gravier » et vous y êtes. C’est une des choses magnifiques de la littérature de faire en sorte que le lecteur va fabriquer son Saïgon, sans image. Ce qui n’est pas possible au cinéma.
Mais vous ne pouvez pas toujours vous cacher derrière l’illusion…
J'aime la narratologie et techniquement j'aime bien mettre les mains dans le cambouis. Et parfois ça ne marche pas parce que vous avez besoin de quelque chose de plus tangible parce que c’est de l’Histoire. Vous ne pouvez pas jouer les prestidigitateurs. Quand j’ai besoin de renseignements qui me sont inaccessibles et qui me sont essentiels pour un personnage, le manque d’information me met dans une impasse narrative et rend le roman infaisable. C’est là que j’ai besoin de Camille Cléret. Je lui demande des notes sur des sujets : elle passe son temps à la BnF et fouille dans tous les ouvrages possibles. Par exemple, dans ce livre, l’histoire des sectes. Elle a su m’expliquer pourquoi elles ont été importantes à ce moment-là, leur rôle protecteur. Après je pousse le trait, parce que j’écris des romans d’aventure.
Comment intégrez-vous la somme des documents dans un roman ?
Je vous donne un exemple. La grève que je décris, qui a eu lieu en 1947, mais je ne tords pas trop l’histoire en la plaçant un an plus tard, a failli ne pas être dans le roman. Dans le roman d’aventures, et même dans le roman historique, vous êtes souvent séduit par un détail que vous avez attrapé et la tentation est grande de mettre tout ce que vous avez appris dans votre bouquin. C’est la première erreur à ne jamais commettre. Il faut accepter la frustration intense d'avoir travaillé pendant six mois sur un sujet, d'avoir 300-400 pages de notes et de n’en utiliser que 20. Le reste va aller à la poubelle. Mais mon hypothèse, c'est que vous ne pouvez pas faire un bon roman si vous ne faites pas ça. Cela vous obligerait à fabriquer des boucles narratives uniquement pour faire passer les trucs qui sont intéressants. Or, ils n’ont leur place dans un roman qu'à la condition de servir le fil de l'histoire. C’est ainsi que la manifestation n’avait pas sa place. Il aurait fallu la faire entrer au chausse-pieds. Jusqu’au jour où miraculeusement, elle s’insère dans mon fil narratif et m’offre un rebondissement.
Vous nous faites découvrir l’arnaque à la piastre…
Je n’ai pas beaucoup de mérite parce que si vous vous intéressez la guerre de l'Indochine, ce fut un scandale, qui aujourd'hui a été oublié. Jacques Despuech, employé à l’Agence des Monnaies, était un homme en colère et a été le lanceur d’alerte en publiant en 1952 un livre aux éditions des deux rives (Le trafic de Piastres, ndlr), que je me suis d’ailleurs procuré. Un livre avec des fac-similés ! Le scandale va être important car cela a enrichit les politiques, les industriels mais aussi l’ennemi, le Viêt-minh. Prendre un lanceur d'alerte comme modèle me permettait de montrer émotionnellement ce que ça représente au quotidien, comment sa hiérarchie, prévenue, le rend impuissant. Il n’y a qu'une dernière case à cocher, c'est la presse. La presse c’est l’ultime contre-pouvoir pour le lanceur d'alerte. Si la presse ne marche pas, le message ne peut plus passer et il n’y a plus de vérité.
Et votre livre rend un vibrant hommage à la presse avec le personnage du journaliste, François…
C’est une presse mythologique et réelle. Je voulais comprendre cette mécanique absolument gigantesque qu’était France Soir, journal populaire qui me fascine, avec 1 million d'exemplaires et quatre éditions par jour. J’ai lu les mémoires des journalistes de Philippe Labro de Lucien Bodard et tous véhiculent la même chose : la fièvre du journal, la fièvre de bouclage, la concurrence interne, la concurrence externe, tout le monde veut plaire à Pierre Lazareff. Et le destin de ce journal coïncide avec toutes les étapes des trente glorieuses. Avec les années de crise, on passe à un autre modèle et les années « Libé ».
Finalement vos Trente glorieuses, en s’arrêtant en 1966, sont plus historiques et politiques qu’économiques…
Il y a une raison plus conceptuelle. Dès le début de mon travail avec Au revoir là-haut, j'ai eu l'idée de prendre l'histoire un petit peu de biais, moins familier pour le lecteur comme pour moi. La Première Guerre mondiale, je la raconte à travers l’après-guerre, dans le rétroviseur ; dans Miroir de nos peines, au lieu de traiter de de la Résistance ou de l'Occupation, j’utilise l'exode, qui est un angle un petit peu mort ; là, dans Le grand monde, plutôt que la guerre d'Algérie, je choisis plutôt la guerre d'Indochine. La manière que j'ai de feuilleter le siècle va apporter une certaine couleur… Je fais même le pari que ça donne un éclairage un peu nouveau, sur la fin des colonies notamment. Et à la différence du conflit algérien, la France n’envoyait pas d’appelés du contingent en Indochine. Les familles françaises n’envoyaient pas leurs enfants en Asie. C’était une guerre de professionnels, vue comme exotique. Les Français n’étaient pas touchés charnellement.
Pierre Lemaitre chez Calmann-Lévy en janvier 2022- Photo T. GIRAUD / LH
Pour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.
Précarité, chômage, violences policières, médias, la place de la femme, le décolonialisme, il y a tous les sujets politiques de notre époque dans ce roman d’aventure.
Le roman d’aventure n’est pas exempt de politique, et j’assume qu’il ait une vision du monde politique. Regardez Robinson Crusoë, qui traite de la naissance du capitalisme ! Mais le lecteur a besoin de cases. Personnellement, je conteste la catégorie des romans historiques. Mais je comprends que le libraire ait besoin de qualifier un livre : roman d’amour, roman policier, roman d’aventure, roman politique… Je préfère, si on me met dans une case, que ce soit celle du roman d’aventure. Je le dis de manière un peu provocatrice, mais c’est le roman d’aventures qui m’a fabriqué : Dumas, Les Pardaillan, Les Misérables… Aujourd’hui, elle est un genre mineur, dédié à la jeunesse.
Il y a aussi l’aspect sociétal. Vous valorisez fortement les minorités au fil de votre œuvre : handicapés, homosexuels, femmes…
Je n’avais pas vu ça comme ça. Mais c’est juste. J’aurai dit que je travaille sur la domination. Ça se recoupe un petit peu. Ces minorités sont des minorités dominées. On est quand même dans une période où la domination masculine règne sans partage : les femmes n’ont aucun statut. Pour l’homosexualité d’Etienne, je n’avais pas beaucoup de solutions. Le lanceur d’alerte ne pouvait être qu’un homme, il lui fallait une déchirure affective, une raison de partir en Indochine mais aussi un mobile de revanche… Et vous savez, je pense que l’homosexualité est un des grands marqueurs du siècle, comme la libération de la femme. Je commence par un héros homosexuel en 14-18. Dans ces années-là, c’est directement l’enfer. Et en 1950, c’est encore dur. Même si ce sera toujours une guerre, ça a évolué, par soubresauts, jusqu’au mariage.
Et votre fratrie s’émancipe surtout de son destin tracé par les parents. Ça aussi c’est un symbole des Trente glorieuses : la jeunesse coupe avec le déterminisme social…
Les Trente Glorieuses c'est une période de bascule. On ne choisit plus les maris de ses filles, les métiers de ses enfants. Ces stéréotypes sont laminés. On le verra d’ailleurs dans le prochain roman avec le personnage d’Hélène…
Autre marqueur de votre œuvre, l’empathie voire la sympathie qu’on peut éprouver pour les monstres, les cruels et les salauds… Je pense au couple de Jean et Geneviève.
Geneviève est ambiguë, et certains lecteurs en riront, son mari Jean est ambivalent. Du point de vue romanesque, c’est aussi l’héritage de la littérature populaire, que ce soit Les quatre mousquetaires avec Aramis et Porthos, ou Les Misérables. Regardez Javert, un personnage ignoble durant tout le roman, et à la fin Victor Hugo le rachète en un chapitre. Dans ces grands romans simplificateurs qui ont été le lait de ma jeunesse, je crois qu'on trouve cette ambivalence.
Votre écriture est aussi inscrite dans l’oralité, dans ce langage populaire justement.
Je n’aime pas la notion de style mais il y a une manière de raconter. Je pense que les lecteurs en lisant quelques pages peuvent reconnaître un de mes livres. Je n’écris pas du langage parlé. Je passe plus de temps à corriger qu’à écrire. Mais je veux donner l’illusion que je raconte l’histoire à haute voix, avec une rythmique spécifique. Et je veux qu’on comprenne que ma façon de m’exprimer est cohérente entre ce que je suis et ce que je fais, que c’est organique. Quand quelque chose me fait rire, je fais le pari que ça va faire rire l’autre. Je suis authentique. J'ai cette chance que ce que ce que je suis m'a permis de créer ce que je fais, sans prendre de posture, et que ce que je fais rencontre du public, c'est un miracle.
Le Grand monde signe votre retour chez Calmann-Lévy. Pourquoi avoir quitté Albin Michel, qui a contribué à votre succès ?
Je n’ai eu qu’à me louer des professionnels chez Albin Michel. Mais vous le voyez, Le grand monde c’est une étape, un carrefour, dans mon travail. Il y a une ambition revendiquée. J’ai mon sillon et il fallait que je sois porté par une autre dynamique. Pour cela il fallait que je change d’interlocuteurs, qui seraient dans une autre position. Pour Calmann-Lévy, c’est un pari absolument dingue. C’est une folle responsabilité, terrifiante des deux côtés. Je suis très heureux de ce choix, de ce virage. Pour l’instant, c’est un transfert réussi. Bien sûr, j’étais très content chez Albin Michel. Personne n’a démérité, mais il y avait un sentiment de répétition. Ce que je voulais c’était qu’un éditeur pose un regard sur mon travail. Qui, à part un éditeur, peut dire ce que je vaux ? La rencontre avec Philippe [Robinet], chez qui j’avais deux livres, a été bienvenue. Il me fallait un éditeur qui ait besoin de moi, qui a faim. Il y a eu de vraies discussions et réflexions sur la maquette, la promotion, la couverture : vous avez noté que mon prix Goncourt n’est pas mentionné sur la quatrième ? Je veux aller conquérir un nouveau lectorat. Et Calmann-Lévy peut m’apporter ça.