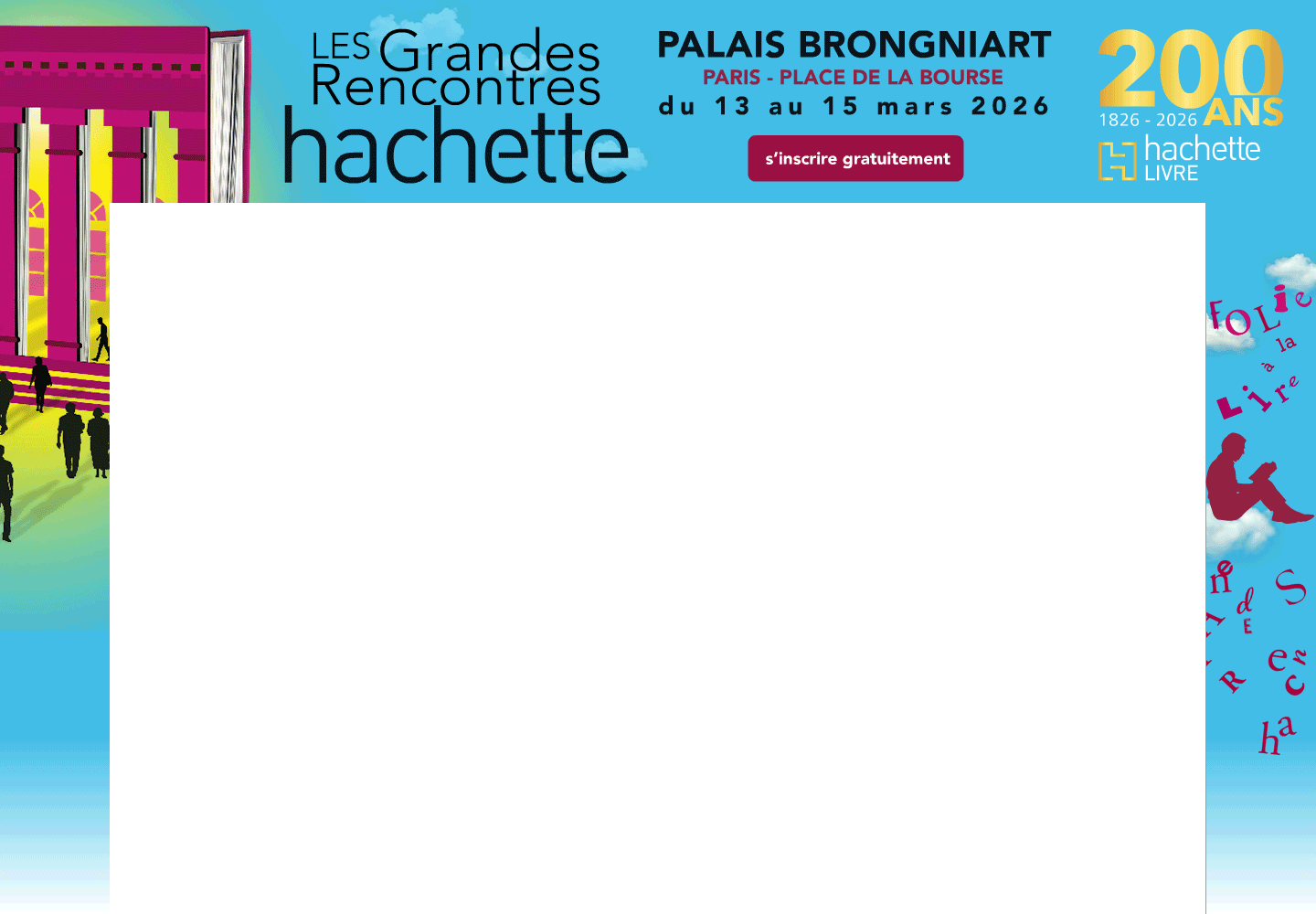Jonathan Franzen, Jane Smiley, Angela Carter ou Robert Stone, ils sont tous d’accord. Jusqu’au New Yorker qui la sacra "la plus extraordinaire romancière de langue anglaise depuis Virginia Woolf". Sans nécessairement abonder dans cette exultation critique (du moins à ces hauteurs-là), on peut en effet se demander pourquoi l’œuvre de l’Australienne Christina Stead (1902-1983) demeure à ce point ignorée dans notre pays et féliciter les éditions de l’Observatoire de contribuer peut-être à la réhabiliter en publiant pour la première fois en français, plus de quatre-vingts ans après sa parution anglaise (en 1936), cette manière de prodige romanesque qu’est Splendeurs et fureurs.
De quoi s’agit-il? De quelques jours dans la vie d’une femme. Un matin de 1934, Elvira quitte son foyer londonien, son mari, Paul, pour rejoindre à Paris son jeune amant, Oliver. Là, plutôt que de céder aux feux de la passion, une curieuse langueur se saisit de son séjour parisien. Parmi la faune de viveurs, bourgeois transgressifs, danseuses, marxistes noctambules, journalistes, étudiants, Elvira va faire l’expérience de la duplicité du réel, de la fragilité du désir. Alors que Paul essaie de la reconquérir et qu’elle n’est pas insensible à cette perspective, elle devra se poser la question de sa présence au monde. Et y répondre.
Ce n’est pas toutefois le fil narratif, au demeurant plutôt lâche, qui fait toute l’étrange et singulière beauté (magnifiée par l’impeccable traduction de Lori Saint-Martin et Paul Gagné) de ce livre, considéré comme le plus audacieux de toute l’œuvre de Christina Stead. D’une manière effectivement assez woolfienne et sans jamais oublier de dépeindre les séductions de Paris, l’écrivaine nous promène dans la psyché de son héroïne et de ceux qui l’entourent. Et le voyage est aussi périlleux que fascinant. En ce sens, c’est plutôt du côté de Jean Rhys, celle de Bonjour minuit, qu’il faut chercher un vrai cousinage. Comme elle, comme Woolf, comme Djuna Barnes aussi et dans les mêmes parages, Stead sait qu’il n’est de roman qui ne soit d’abord l’aventure d’une écriture. La sienne, protégée peut-être par sa trop longue invisibilité, n’a pas pris une ride. Olivier Mony