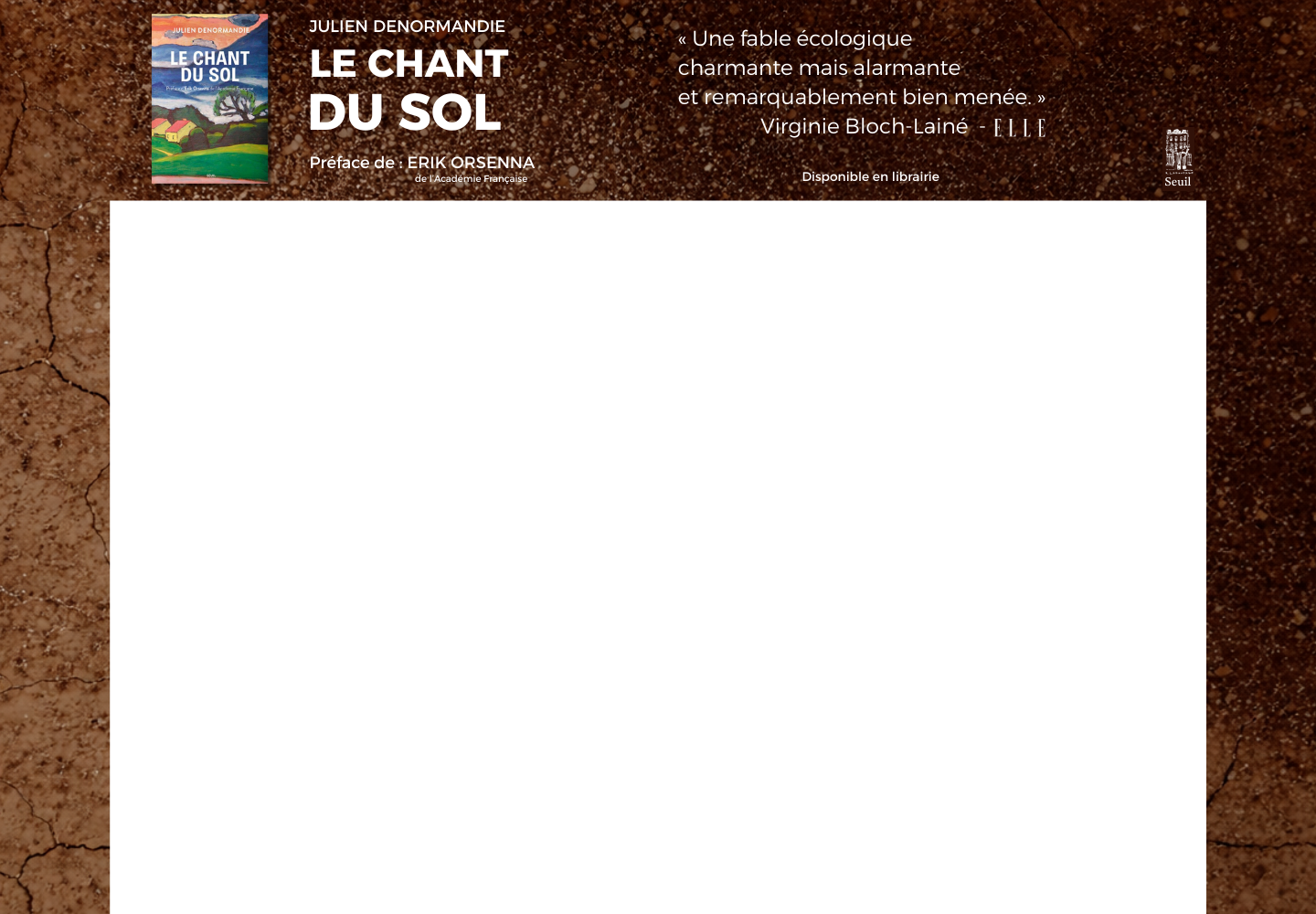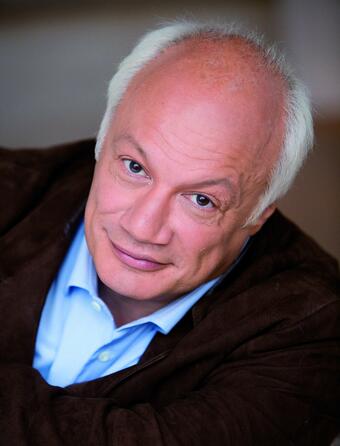Après une Contre-histoire de la philosophie en douze volumes, et une Brève histoire du monde qui s’est dilatée en six volumes, Michel Onfray se lance dans l’une de ces sagas dont il a le secret, une Histoire philosophique de l’Occident, prévue en quatre volumes, dont le premier, Déambulation dans les ruines, paraît le 24 septembre chez Albin Michel. Il s’y livre à son exercice favori, une traversée des siècles à travers des pensées, des théories, des philosophies, des religions, des penseurs également et leurs œuvres, qui ne nous sont que très partiellement parvenues. Au passage, Onfray, philosophe aussi populaire et médiatique que controversé, y développe quelques thèses qui lui sont chères, comme la mort programmée de notre civilisation. Pour Livres Hebdo, il a bien voulu expliciter son projet, et en donner les lignes de force, non sans extrapoler sur le monde actuel.
Livres Hebdo : Pouvez-vous nous expliquer l’architecture de votre nouveau chantier ?
Michel Onfray : C’est une espèce de généalogie de l’Occident judéo-chrétien. Une histoire philosophique de l’Occident, à travers une vingtaine de thèmes, de propos (le corps, les femmes, la nourriture, la lecture etc.) qui fonctionnent de manière dialectique, par oppositions deux à deux. Le premier volume traite des Grecs et des Romains, le deuxième traitera du christianisme, du bloc judéo-chrétien, de Jésus à Giordano Bruno, le troisième de la Renaissance, avec l’émancipation de la pensée judéo-chrétienne, de Descartes à la Révolution française, le dernier de notre modernité qui s’émancipe du christianisme, l’ère du nihilisme, jusqu’au philosophe Peter Singer.
Un volume par an jusqu’en 2028 ?
C’est de nouveau une vraie aventure éditoriale, et je suis content que mon éditeur m’ait suivi. Je suis en train de travailler au deuxième volume, et j’en suis déjà à 200 000 signes, alors que je n’ai pas écrit le dixième de mon propos. Il se peut que le projet prenne plus d’ampleur, comme ma Brève histoire du monde !
« La génération qui lit de la philosophie, ce n’est plus d’époque »
Ce sont des ouvrages de philosophe, pas forcément accessibles à un vaste public. En avez-vous conscience ?
J’essaie d’être clair, et pédagogue. Mais je ne m’occupe pas des ventes de mes livres. Je ne demande jamais les chiffres. Aujourd’hui, vendre au-delà de 100 000 exemplaires, c’est très rare. J’ai publié mon premier livre en 1989. La génération qui lit de la philosophie, ce n’est plus d’époque. D’ailleurs, la civilisation de l’écriture, c’est bientôt fini !
Vous avez publié, dit-on, 150 livres en 45 ans.
Peut-être plus, je ne compte pas ! ça s’appelle une névrose. Quand je ne travaille pas, je ne suis pas bien. J’ai eu une enfance affreuse, mon salut est venu par les livres. Mon premier texte de fiction, je l’ai écrit à l’âge de dix ans. En fait, j’aurais pu me faire moine (j’ai failli), bénédictin ou chartreux, et mener une vie d’ascèse, dédiée à l’écriture et à Dieu. Mais je n’avais pas la foi !
Vous faites preuve d’une érudition considérable, ce qui suppose une importante documentation, avez-vous quelqu’un pour vous aider ?
Non, non, je fais tout tout seul. Et moi seul peux le faire. Se faire aider, c’est comme un critique gastronomique qui demanderait à d’autres de goûter les plats !
Vous placez votre entreprise sous le haut-patronage de Nietzsche, pourquoi ?
C’est le penseur de la civilisation. Il est le plus fondamental pour comprendre le modernisme. Ici, c’est le Nietzsche jeune qui m’accompagne, celui de la Naissance de la tragédie (1872), le philologue, lecteur des présocratiques grecs. Viendront par la suite le Nietzsche de L’Antéchrist, puis de la critique de la raison, et celui du « nihilisme européen », de la décadence.
« Les gens qui disent qu’ils vont arrêter la décadence de notre civilisation sont des imposteurs »
Comme lui, vous croyez à une mort de notre civilisation occidentale ?
Toutes les civilisations sont mortelles, comme les humains, elles ont disparu. Il n’y a pas de raison que la nôtre échappe à la règle. Les gens qui disent qu’ils vont arrêter la décadence de notre civilisation sont des imposteurs. Elle a duré 2 000 ans, ce n’est pas si mal. Même si l’Inde en est à 5 000 ans.
Qu’est-ce qui vous permet d’avancer cette thèse ?
Un des signes de la décadence, c’est la détestation de soi. Il me semble que nous y sommes. Notre planète va devenir invivable ; l’intelligence artificielle va tout dominer ; à cause du réchauffement climatique, le permafrost dégèle, et va libérer des virus autrement plus mortifères que la Covid. Une autre civilisation prendra la place, elle sera post-humaine, post-terrestre. Certains travaillent déjà à cet avenir, comme Elon Musk, un pionnier fou, mais que je prends très au sérieux. Il a le génie des fêlés !
Nous voilà bien loin de la philosophie antique, de Platon à Plotin, schématiquement…
Pas tant que ça. J’ai intitulé mon livre Déambulation dans les ruines, celles de Rome, mais pas seulement. Je suis un « ruiniste », c’est mon troisième livre avec « ruines » dans le titre. Comme des monuments, il ne nous reste qu’une toute petite partie de la littérature et de la philosophie antiques, largement victimes des autodafés par les chrétiens.
« La pensée procède toujours par des oppositions, sur tous les sujets »
Pourquoi définir la philosophie comme « une guerre des idées » ?
La pensée procède toujours par des oppositions, sur tous les sujets. Par exemple entre l’idéalisme et le matérialisme, ou entre l’ascétisme prôné par Pythagore le végan et le libertinage prôné par Diogène le carnivore, voire cannibale. C’est la civilisation qui résout toutes ces questions. On oppose aussi traditionnellement les Grecs et les Romains, qui n’auraient rien inventé, ce qui est faux. Les Grecs dissertent sur des concepts, des idées, les Romains philosophent avec des exemples concrets, pris dans la vie quotidienne.
La philosophie, comme les religions, est venue d’Orient ?
Évidemment. Il n’y a jamais eu de « miracle grec ». La démocratie, ni la philosophie ne surgissent comme ça ! Il y a eu de nombreux philosophes qui ont voyagé. Le néoplatonicien Plotin, par exemple, qui est allé jusqu’en Perse. D’autres, comme son disciple Pyrrhon, jusqu’en Inde. Ils y ont rencontré les mages, et les gymnosophistes. Des concepts égyptiens, également, sont arrivés en Grèce, comme celui du souffle vital, ou l’idée de la vie après la mort. L’Orient nous a aussi amené Jésus, dont le personnage est un collage de différentes traditions. Les chrétiens ont recyclé le maximum des visions païennes du monde.
Qu’est-ce qu’un philosophe, finalement ?
Le sage, c’est celui qui vit sa philosophie, le philosophe celui qui aime la sagesse.