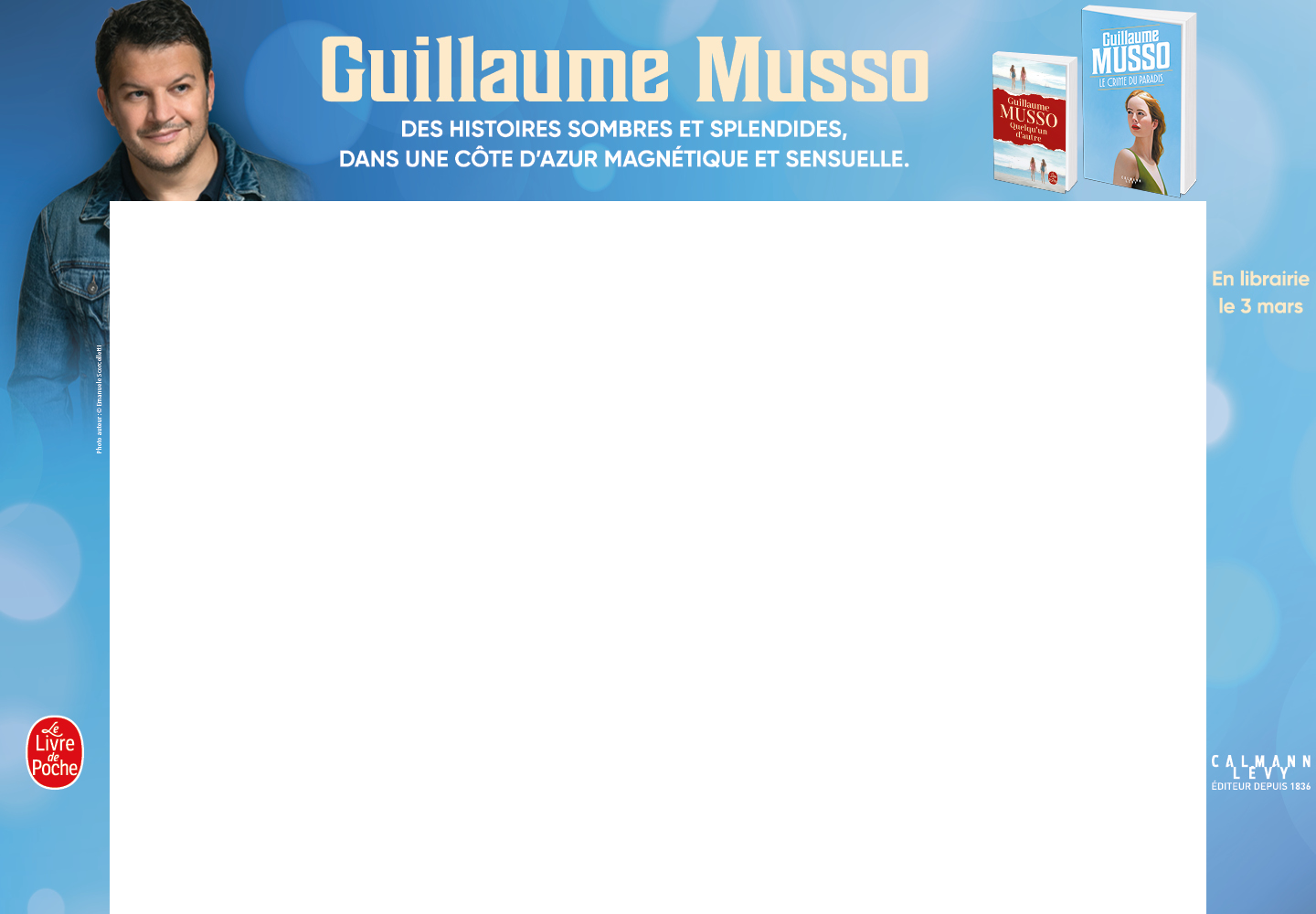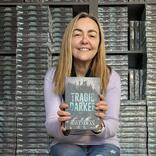Livres Hebdo : Pouvez-vous nous raconter comment votre grand-père, Jacques Catineau, en est venu à créer le prix Quai des Orfèvres et quelles valeurs ou motivations guidaient ce projet ?
Agnès Catineau : L'idée du prix est née au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Mon grand-père possédait alors une maison d’édition, S.E.P.E., et s’intéressait de près à ces questions. Il avait même contribué à résoudre les problèmes de pénurie de papier de l’époque. Il fallait faire preuve d’ingéniosité : il ne restait plus grand-chose. Il entretenait également des liens étroits avec de hauts fonctionnaires de police et des magistrats qu’il admirait profondément. Constatant que ces milieux évoluaient souvent en vase clos, il souhaita les réunir autour d’un projet créatif commun. En collaboration avec le grand patron d’Hachette, il s'engagea avec sa maison (ndlr : S.E.P.E., puis Hachette, et à partir de 1966, Fayard) à publier des manuscrits d'anonymes, afin de donner leur chance à des auteurs inconnus. Une valeur essentielle pour lui. Le projet reposait alors sur des critères précis qui mettaient à l’honneur ceux qu’il admirait profondément : les policiers et leur sens de l’enquête, leur rigueur technique, ainsi que le rôle essentiel des juges et des magistrats.
En 80 ans d’existence, comment le prix du Quai des Orfèvres a-t-il évolué ?
A.C. : Il est resté très fidèle à sa forme d’origine. Sa force, c’est sa simplicité : une gouvernance claire, un principe solide, et une idée intemporelle. Ce qui me passionne, c’est que le prix offre une véritable fenêtre sur l’évolution de la société. À travers les romans primés, on lit les grandes transformations du monde : les crimes, les technologies, les enjeux nouveaux. Même les couvertures des livres racontent cette évolution : des années 1950 très “noir classique” à l’esprit plus coloré des années 1970, puis un ton plus dur dans les années 2000.
« Le roman doit être crédible et refléter le réel »
Fabrice Gardon, quel regard portez-vous sur un prix qui relie police et littérature ?
Fabrice Gardon : Je trouve ça extrêmement riche. En revenant chaque année, l’événement entretient le mythe et l’histoire de l'institution. Et puis, le prix réunit des personnalités très variées : des parrains et marraines de renom, comme ce fût le cas en 2016 avec Alain Delon et Jean-Paul Belmondo mais aussi d’anciens directeurs de la PJ (ndlr : qui restent membres de droit), des policiers, des magistrats, des écrivains, un scénariste, un journaliste... Que toute cette communauté se retrouve une fois par an au « 36 » c’est quelque chose de fort.
A.C. : Cette mixité professionnelle c'est justement ce qui fait la richesse du jury. Chaque membre apporte son expertise : Jacques Dallest (procureur général honoraire) sur les cold cases, Caroline Rey-Salmon (chef de l’Unité médico-judiciaire de l’Hôtel-Dieu à Paris) sur les scènes de crime, etc.
Prix du Quai des Orfèvres 2026 : Christophe Molmy récompensé pour Brûlez tout
Mais quelle est l’importance du prix ici, à la PJ ? Les policiers lisent-ils les ouvrages ?
F.G. : Tous les ans, la maison Fayard offre un exemplaire du roman lauréat à chaque policier du 36. Après, je ne les suis pas chez eux pour vérifier qu’ils le lisent (rires), mais je peux dire qu’une grande partie d’entre eux le fait, et qu’ils en sont vraiment contents. Au-delà de l’événement, il y a un vrai lien entre le roman et le travail des policiers. Les deux se nourrissent mutuellement : le roman doit être crédible et refléter le réel, et pour les policiers, c’est valorisant de voir leur métier raconté, compris, mis en lumière. Au final, la fiction nourrit la réalité, et la réalité nourrit la fiction : c’est une belle alchimie.
Comment se déroule la sélection des manuscrits, de la présélection à la décision finale ?
A.C. : La maison Fayard effectue une première sélection avec un comité de lecteurs. Une fois cette présélection faite, cinq à six manuscrits anonymes sont remis aux membres du jury. Ils ont alors un vrai « devoir de vacances » : les lire attentivement pendant l’été ! Puis, les 22 ou 23 membres du jury, se réunissent pour en débattre. C’est toujours un moment fort : un vrai dîner-débat, où les points de vue s’expriment librement, parfois avec vigueur, mais toujours dans la cordialité.
« C’est formidable de donner une telle opportunité à quelqu’un qui, souvent, va être publié pour la première fois »
F.G. : Les deux dernières années, d’ailleurs, pendant la soirée de délibération, il y a eu de véritables joutes oratoires. Certains membres du jury sont avocats, donc défendre un point de vue, c’est un peu leur métier ! À la fin, chacun vote, et c’est la majorité qui l’emporte. On essaie toujours d’être 22 autour de la table, un nombre symbolique pour les policiers (« 22 v'la les flics »).
A.C. : Et puis il y a la proclamation. C'est un vrai moment de joie d'entendre l'émotion des lauréats au téléphone lorsqu'on leur annonce la bonne nouvelle. C’est formidable de donner une telle opportunité à quelqu’un qui, souvent, va être publié pour la première fois. Fayard a d'ailleurs récemment lancé une collection, Les Lauréats, pour permettre aux auteurs de poursuivre dans la même veine.
Selon vous, quels sont les critères qui font un bon manuscrit pour le prix du Quai des Orfèvres ?
A.C. : D’abord, il faut que ça tienne la route. Mais je dois dire que, depuis trois ans, nous sommes assez alignés avec Fabrice. Pour moi, un bon manuscrit repose sur trois choses. D’abord, un ancrage dans l'époque. Ensuite, il faut du rythme. Le monde va vite, la lecture aussi : on doit avoir envie de tourner les pages. Et enfin, il faut qu’on sente la présence des flics, leur manière de chercher, leur travail d’équipe. Et bien sûr, a minima, une écriture solide.
F.G. : Oui, je suis d’accord. Pour moi, la première chose, c’est la crédibilité. Ce n’est pas un reportage, ni une procédure fastidieuse, mais il faut que ça sonne juste. Ensuite, il faut une vraie intrigue : quelque chose de prenant, avec des rebondissements bien dosés. Et puis, moi, j’aime quand il y a de l’action. Si on parle trop longuement des états d’âme des personnages, ça devient un roman psychologique, pas un polar.
A.C. : Oui, et à ce titre, la présence d’une scénariste dans le jury est précieuse. Elle apporte un vrai regard sur la construction du récit. Aujourd’hui, tout passe par l’image. Le prix doit aussi refléter cette évolution : donner à voir les scènes, les ambiances, les séquences du récit. Christophe Gavat, Jean-François Pasques, Alexandre Galien, de nombreux lauréats du prix sont d’anciens policiers. Diriez-vous que cela reste aujourd’hui une condition essentielle pour espérer remporter le prix ?
F.G. : Non, vraiment pas. Martial Caroff, lauréat 2024, est géologue, et Olivier Tournut (2025), secrétaire général de l’Autorité nationale des jeux. En revanche tout deux lisaient énormément de polars et cultivaient une réelle passion pour le milieu.
« Le vrai défi sera de maintenir la qualité des ouvrages »
A.C. : La curiosité est la clé. Même sans être du métier, on peut se documenter, comprendre les bases d’une procédure. Et puis, certains auteurs sont très imaginatifs !
Pouvez-vous partager quelques anecdotes marquantes de délibérations ?
A.C. : Je me souviens d’un débat autour de Tension extrême, de Sylvain Forge (lauréat 2018), sur le thème du piratage informatique et de la cybercriminalité. Certains trouvaient que le récit allait un peu loin… Je n’ai pas le droit de voter, mais j’espérais vraiment que ce manuscrit l’emporte et il a gagné. Trois mois plus tard, une affaire réelle traitait exactement du même sujet. C’était une belle intuition du jury !
F.G. : L’an dernier, le jury a débattu pour savoir si un roman devait rester « lisse » pour plaire au public ou s’il pouvait aborder des aspects plus durs et réalistes. Pour ma part, je pense que plus le lecteur est choqué par le criminel, plus il s’investit dans l’enquête. Une partie du jury partageait ce point de vue, tandis qu’une autre estimait qu’il ne fallait pas aller trop loin, pour ne pas heurter le public.
Les lauréats remportent généralement un grand succès en librairie. Comment expliquez vous ce phénomène ?
F.G. : C’est une mécanique bien rodée : un format poche, un prix abordable (moins de 10 euros), un bandeau reconnaissable… Les lecteurs de polars savent qu’ils vont trouver de la qualité. Et puis c’est un événement annuel : ça crée l’attente.
A.C. : Oui, et puis c’est une littérature populaire dans le bon sens du terme. Ce sont des romans qui reflètent la société et c'est ce réalisme qui fait la force du prix.
F.G. : Et puis, c'est un tremplin énorme pour les auteurs : on parle d’un premier tirage à 50 000 exemplaires.
Quels défis et enjeux anticipez-vous pour le prix du Quai des Orfèvres dans les années à venir ?
F.G. : Je pense que le modèle est solide. Le vrai défi sera de maintenir la qualité des ouvrages. En réalité, la seule menace, c’est celle qui pèse sur toute la littérature : est-ce que les gens continueront de lire ?
A.C. : Même si nous vivons à l’ère du digital, il y a encore un vrai plaisir à tourner les pages d’un livre. Aujourd’hui, je pense qu’un bon polar doit être visuel. Il faut que le lecteur ressente l’action : qu’il soit dans la filature, qu'il ressente la peur aux côtés des officiers de police… C’est ce rythme et cette immersion que nous devons conserver.
Pour finir, quels conseils donneriez-vous à un jeune auteur qui souhaiterait tenter sa chance ?
A.C. : N’ayez pas peur ! Envoyez votre manuscrit. Tout est lu, sans barrière ni réseau. Renseignez-vous simplement sur les procédures policières et judiciaires, pour être crédible.
F.G. : Soyez clairs, rythmés, réalistes. De l’action, des rebondissements, mais pas de complexité inutile. Le polar du Quai des Orfèvres, c’est un roman populaire : il doit se lire avec plaisir.