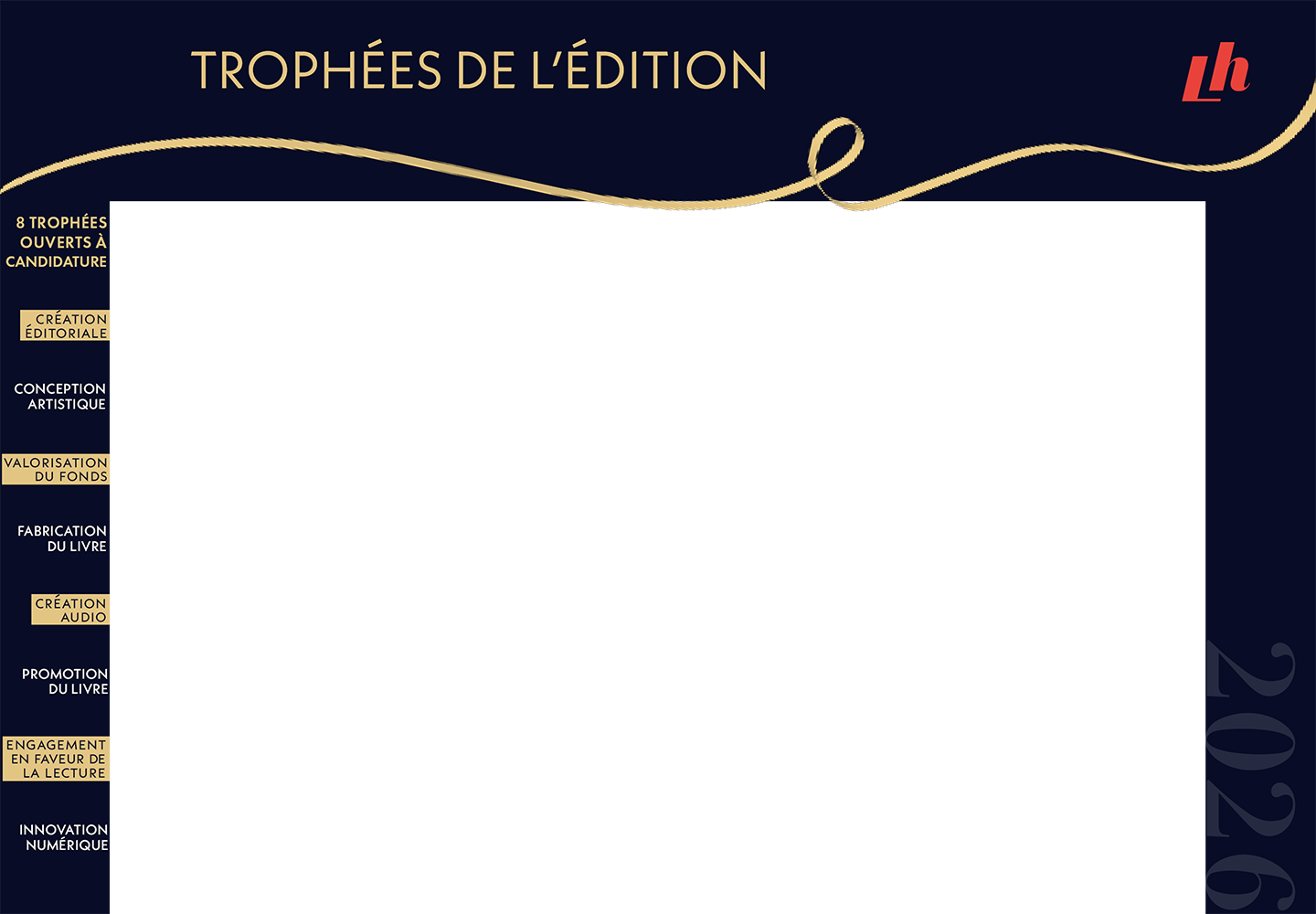La Documentation française est née en 1945, à la Libération. Elle célèbre donc ses 80 ans en 2025. Issue de la fusion de deux centres de documentation clandestins, l’un à Londres, l’autre à Alger, elle a vu le jour sous l’impulsion du gouvernement provisoire afin de fournir une information fiable et impartiale aux décideurs comme au grand public.
Jean-Louis Crémieux-Brilhac et Marcel Koch, figures de la France libre, en ont assuré la direction initiale, posant les bases d’une institution qui deviendra un pilier de l’édition publique.
Indépendance et pluralisme
En 1947, la Documentation française est placée sous la responsabilité directe du Secrétariat général du gouvernement, la mettant à l’abri des pressions politiques. Julien Winock, responsable éditorial des Cahiers français, rappelle : « La Documentation française ne se contentait pas d’accumuler des documents : elle produisait des synthèses actualisées et rédigées. Dès 1953, un véritable concours a d’ailleurs été mis en place pour recruter des rédacteurs et analystes de haut niveau. »
François Cohen et Julien Winock- Photo OLIVIER DIONPour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.
En revanche, il faudra attendre 1968 pour que le pluralisme éditorial intègre pleinement les valeurs de la maison qui ne dérogera pas pour autant à son « refus de la polémique ». « Toutes les questions sujettes à débats ont le droit de cité, à condition que chaque partie puisse exprimer son point de vue », souligne François Cohen, responsable du pôle de la Documentation française.
Des revues comme Les Cahiers français (1945) et Questions internationales (2003) vulgarisent alors les grandes questions de société, à destination notamment du public scolaire, cœur de cible des fondateurs.
De la Documentation française à la DILA
Les années 1990 et 2000 marquent quant à elles une grande période d'innovations avec le lancement notamment des sites Service-public.fr et Vie-publique.fr. Pour autant, à partir des années 2000-2010, la Documentation française connaît une période de « vaches maigres », explique François Cohen.
Face au recul des ventes et à la fragilisation des comptes, une rationalisation s’impose, menant entre autres à la fusion de la Documentation française avec le Journal officiel en 2010, conduisant à la création de la DILA (Direction de l’information légale et administrative) réunissant ainsi Légifrance, Journal officiel, Service-public et Vie-publique. « Cette fusion a du sens, elle a permis d’unifier la diffusion de l’information légale et citoyenne », ajoute François Cohen.
Papier et numérique : une complémentarité assumée
En 2018, la Documentation française quitte le quai Voltaire pour la rue Desaix dans le XVe arrondissement parisien. La librairie et le centre de documentation ferment leurs portes. Une mise en mouvement en phase avec la volonté de la maison de développer son offre numérique.
Pour autant, la Documentation française continue d’accorder une place centrale à la diffusion papier. « D’autant plus que la DILA maîtrise l’ensemble de la chaîne du livre : édition, relecture, création graphique, mise en page et impression », explique François Cohen. Il rappelle également que certains ouvrages, notamment ceux destinés à la préparation des concours de la fonction publique, nécessitent le support papier pour être pleinement exploités.
François Cohen, responsable du pôle publications au département de l'édition et du débat public chez DILA- Photo OLIVIER DIONPour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.
Outre ses propres collections, la Documentation française publie également les productions d’autres administrations comme la Cour des comptes, le Conseil d’État, certains ministères ou encore des instituts publics de formation comme l’INSP.
Un service public avant tout
Loin de toute logique de profit, la DILA poursuit une mission de service public. « Notre objectif n’est pas de maximiser le gain, mais de répondre à un besoin, tout en maintenant l’équilibre économique », résume François Cohen. Ainsi, depuis quatre ou cinq ans, la quasi-totalité des revues et collections ont vu leurs maquettes retravaillées, dans le but de les rendre « les plus attractives possible ».
Si le chiffre d’affaires a légèrement reculé en 2024 (1,05 million d'euros HT contre 1,17 million en 2023, selon le rapport annuel de la DILA), l’institution nuance ce constat, notamment en raison de l’arrêt des publications du CIGPC. Elle souligne le dynamisme des collections historiques, avec une année record pour les Cahiers français : +26 % en librairie et +62 % en kiosques sur les cinq premiers numéros de 2024.
De plus, la diffusion reste un pilier central de l’activité. En plus de la vente en librairie et sur son site, la Documentation française s’appuie sur plusieurs plateformes pour élargir son audience : Cairn.info pour le milieu académique, et Cafeyn pour le grand public. « Un chiffre d'affaires non négligeable », souligne Julien Winock.
Renouer avec la jeunesse
Après 80 ans d'activités, la maison poursuit son développement, consciente de devoir s’adapter à une société en pleine transition. « Le challenge, c'est de redevenir une référence pour toutes les générations et pas simplement pour les sexagénaires qui nous ont connus dans leurs études », développe Julien Winock.
Lancée sur Instagram depuis peu, la Documentation française tente de renforcer ses liens avec la jeunesse. « Les partenariats récents avec Lumni et le CLEMI visent à l’éducation des jeunes aux médias et à l'information. Le guide Jeune et citoyen, destiné aux 15-25 ans, est une aide précieuse pour les premières années d’autonomie », liste François Cohen. « Parler de sujets sérieux n'est pas forcément synonyme d'ennui. Notre mission est d’allier exigence, pédagogie et attractivité », sourit Julien Winock.
De nouveaux enjeux pour l’information
Face à l’essor de l’intelligence artificielle et à la multiplication des sources, la maison reste vigilante : aucun contenu n’est produit par l'Intelligence artificielle et des chartes éthiques sont en préparation. Mais pour l’heure, les deux responsables restent confiants : « On aura toujours besoin de formation et d’information et nous serons toujours là pour répondre à ces besoins », insiste François Cohen.
Après 80 ans d’existence, les deux responsables se projettent avec ambition vers l’avenir : podcasts, vidéos, nouvelles formes d’expression… « Nous voulons que le public continue de connaître notre histoire et notre mission : fournir une information fiable et pédagogique », conclut Julien Winock.