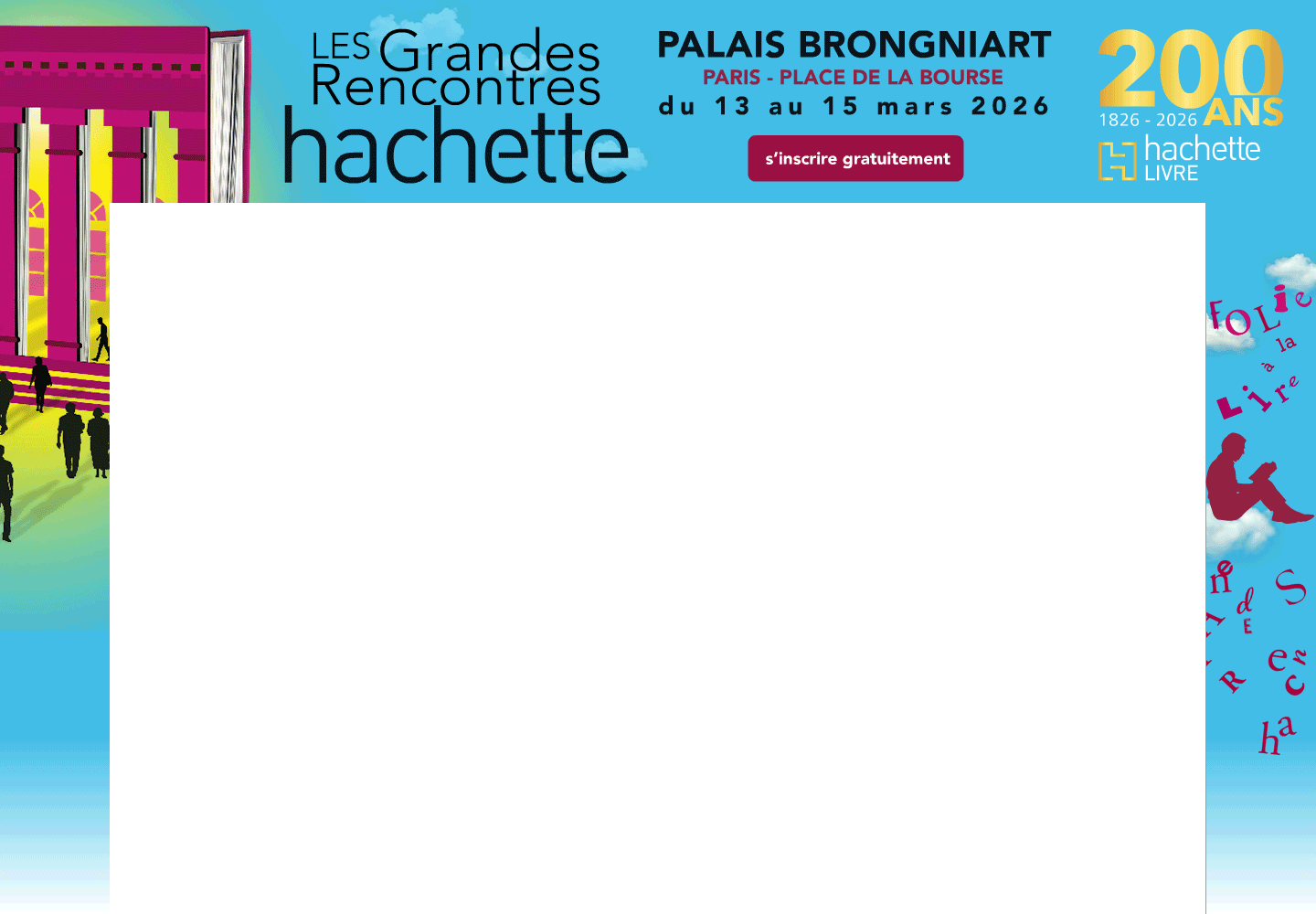Ne nous fions pas à ses apparences de petite mamie fragile. Oya Baydar, outre une grande dame des lettres turques, est une femme au caractère bien trempé. "On me considère toujours un peu comme une pasionaria de gauche, sulfureuse", s’amuse-t-elle. Réputation pas vraiment usurpée.
Dès ses débuts en littérature, en 1958, avec Dieu a oublié les enfants, d’abord paru en feuilleton dans le quotidien stambouliote Hürriyet, puis en volume, Oya Baydar fait scandale. Cette histoire d’un groupe d’étudiants "qui s’ennuyaient et faisaient l’amour" choque la Turquie bien-pensante, comme le Bonjour tristesse de Sagan, à qui on la compare évidemment. Ses parents apprécient modérément.
Exil européen
Elle récidive avec L’âge de l’espoir et du combat, tout un programme, qui paraît en plein milieu d’un des nombreux coups d’Etat militaires qui secouent régulièrement la Turquie, et dont elle sera la victime collatérale. Jusqu’en 1991, année de son retour au pays après une amnistie, tout en ayant "continué d’écrire", elle ne publiera plus, se consacrant à l’action politique au sein du Parti des travailleurs de Turquie (socialiste) et au journalisme, tout comme son mari, Aydin Engin. Après que, en 1964, sa thèse de sociologie sur "L’origine de la classe ouvrière en Turquie", acceptée par le jury, a été refusée par le Conseil de l’université d’Istanbul, provoquant une protestation et une grève des étudiants, elle devient assistante à l’université d’Hacettepe, jusqu’en 1972. Date à laquelle, à cause d’un autre coup d’Etat, elle doit quitter l’université ; elle est arrêtée, torturée (là-dessus, elle reste discrète), puis relâchée. Mais en 1980, une nouvelle junte militaire l’ayant condamnée à 24 ans de prison ("Et mon mari à 37", dit-elle), et déchue de sa nationalité, elle s’exile en Europe. Moscou, puis Berlin, où elle reste douze ans, jusqu’après la chute du Mur et du bloc communiste. Elle ne rentrera chez elle qu’en 1991, pour publier Adieu Aliosha, un recueil de nouvelles en partie autobiographiques, comme toute son œuvre, dont elle dit : "C’est ce que j’ai écrit de mieux", et qui obtient le prestigieux prix Sait-Faik. Elle renoue avec le roman, publiant notamment un diptyque, Et ne reste que des cendres (2000), qui paraît en français à la rentrée, avant le second volume, Le portail de l’arbre de Judée (2004). Ou encore Parole perdue (2007), déjà traduit chez Phébus en 2010, et très remarqué.
"Mes livres ne sont pas des romans politiques, et mes héroïnes ne sont pas exactement moi, explique-t-elle, mais elles sont de ma génération. Et ils traitent du monde d’aujourd’hui, et de la Turquie actuelle." Sur laquelle elle porte un regard sans indulgence : "Erdogan, c’est le Poutine turc, l’islamisme en plus." Vous avez dit "pasionaria" ?
Jean-Claude Perrier
Oya Baydar, Et ne reste que des cendres, traduit du turc par Valérie Gay-Aksoy, Phébus
25 euros, 576 p. isbn : 978-2-7529-0780-6. Sortie le 20 août.