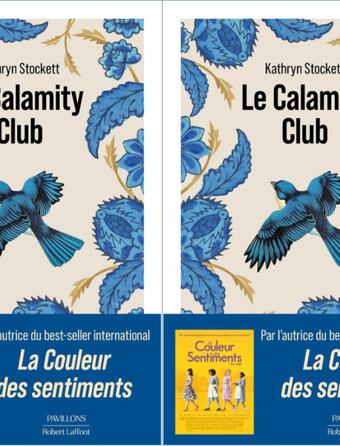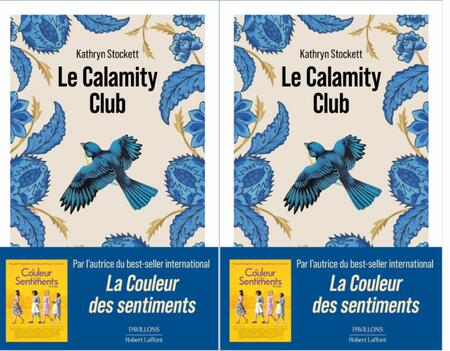Ceux qui suivaient, depuis le démarrage de la toute première saison, il y a onze ans, les amours de la « tuante » Marie, entre Tokyo, Paris, Shanghai, Pékin et l’île d’Elbe, ne vont pas regretter d’avoir attendu quatre ans pour connaître l’épilogue du thriller passionnel imaginé par Jean-Philippe Toussaint : le finale de la saison 4 est chavirant. Aux autres, inutile de résumer les épisodes précédents dans la mesure où Nue, qui vient après Faire l’amour (2002), Fuir (prix Médicis 2005) et La vérité sur Marie (prix Décembre 2009), est un roman autonome dans lequel on peut faire directement connaissance avec Marie Madeleine Marguerite de Montalte, styliste, plasticienne et femme d’affaires, la compagne du narrateur avant la rupture inaugurale du premier volet. Depuis, les deux n’en finissent pas de se séparer « pour la dernière fois ». De faire, défaire, refaire l’amour.
On retrouve dans Nue ce cocktail incendiaire de mort et de sexe, cette tonalité ironiquement mélancolique des volets précédents. Et le roman offre encore des scènes saisissantes d’intensité visuelle et de densité sensuelle - une mannequin défile vêtue d’une robe en miel, une chocolaterie partie en fumée, un rendez-vous dans un café parisien -, qui viennent rejoindre dans l’album Toussaint des images qui avaient déjà fortement impressionné notre rétine de lecteur : le pur-sang courant sur une piste d’aéroport de La vérité sur Marie, la fuite en moto de Fuir, le bain nocturne dans la piscine du dernier étage d’un grand hôtel tokyoïte dans Faire l’amour…
On a choisi ici de ne rien révéler des ultimes spasmes de l’histoire pour ne pas menacer l’harmonie de la composition et préserver le suspense. Attention, les commentaires suivants contiennent malgré tout quelques spoilers !
Livres Hebdo - A la sortie de La vérité sur Marie, certains ont parlé de dernier volet d’une trilogie tandis que vous laissiez entendre de votre côté que vous n’en aviez peut-être pas terminé avec les amours de Marie et du narrateur. A partir de quel moment avez-vous su que ce serait un cycle ?
Jean-Philippe Toussaint - Quand j’ai commencé Faire l’amour, je n’avais pas du tout conscience qu’il y aurait d’autres livres. Mais à la fin de son écriture, il me restait encore une scène, que j’avais imaginée mais qui n’avait pas trouvé sa place dans le livre. Puis, pendant un voyage en Chine quelques mois plus tard, m’est venue l’idée d’une scène dans un train de nuit entre Shanghai et Pékin. A partir de ces deux éléments, j’ai pensé qu’il y avait matière à écrire un deuxième livre. Et c’est au cours de l’écriture de Fuir qu’a vraiment pris naissance l’idée de concevoir un cycle romanesque, où chaque élément pourrait être à la fois autonome tout en faisant partie d’un ensemble plus vaste. Nue est le dernier volet du cycle, il revient sur tous les thèmes abordés dans les précédents livres. On retrouve les lieux familiers, les appartements parisiens de la rue de La Vrillière et de la rue des Filles-Saint-Thomas, la Rivercina, qui est le nom de la maison du père à l’île d’Elbe, ou le Contemporary Art Space de Shinagawa à Tokyo. Surtout, dans Nue, j’apporte un dernier élément narratif déterminant, qui, d’une certaine manière, peut s’apparenter à un dénouement au regard de l’ensemble du cycle. Nue est celui des quatre romans qui s’inscrit le plus consciemment dans un ensemble.
Dans L’urgence et la patience (Minuit, 2012), vous observez que chaque écrivain, chaque livre a son propre dosage entre ces deux énergies nécessaires à toute création artistique. Quelle a été, dans le processus d’écriture de Nue, la répartition entre elles ?
J’ai mené de front en 2011 la préparation de l’exposition « Livre/Louvre », conçue comme un hommage visuel au livre, la relecture de L’urgence et la patience et l’écriture de Nue. Pour Nue, il y a eu deux grandes périodes d’urgence pendant l’année 2011, une à Ostende et une en Corse, où j’ai écrit la deuxième partie du livre qui se passe à l’île d’Elbe, avec cette atmosphère de Méditerranée automnale que je connais très bien : l’humidité, l’odeur des maisons fermées, l’arrière-saison méditerranéenne sous la pluie. La patience a consisté ensuite comme d’habitude à relire, à reprendre, à retravailler certains passages. Lorsque j’aurai mis les brouillons en ligne sur mon site (www.jptoussaint.com), on verra que j’ai beaucoup raccourci certaines scènes, celle par exemple où le narrateur et Marie se retrouvent dans un café de la place Saint-Sulpice à Paris, scène qui était au départ deux ou trois fois plus longue, et que j’ai fini par raccourcir car elle me semblait trop statique.
Quand on lit dans Nue : « ce que Marie recherchait, c’était la perfection, l’excellence, l’harmonie, une certaine adéquation de la forme et du tissu, la fusion de l’œil et de la main, du geste et du monde », on retrouve la profession de foi clairement exprimée dans La main et le regard (Louvre éditions/Le Passage, 2012), le livre qui accompagnait l’exposition au Louvre. On se dit que Marie, c’est vous : elle pratique la haute couture comme vous pratiquez l’écriture, la photographie ou le cinéma.
Oui, je prête volontiers mes réflexions théoriques à Marie. Quand j’écris que Marie « voulait tout contrôler, sans voir que ce qui lui échappait était peut-être ce qu’il y avait de plus vivant dans son travail », je parle sans doute autant du travail de Marie que de mon propre travail. Je partage évidemment aussi l’idée que, dans « la dualité inhérente à la création - ce qu’on contrôle, ce qui échappe -, il est également possible d’agir sur ce qui échappe, et qu’il y a la place, dans la création artistique, pour accueillir le hasard, l’involontaire, l’inconscient, le fatal et le fortuit ». L’épisode de la robe en miel qui ouvre Nue est une scène à la fois réelle et fantasmée, en partie produite par l’imagination, qui se situe donc entre réalité et fiction, mais il m’importe toujours de créer un effet de réel saisissant, presque hallucinatoire.
Justement, dans le cas d’un projet aussi structuré que ce cycle romanesque, porté sur une aussi longue durée, n’est-il pas difficile de « travailler consciemment sur ce qui échappe », de laisser entrer cette part d’inconnu, d’imprévu ? Peut-il y avoir encore des moments où le livre vous échappe ?
J’ai beau passer beaucoup de temps sur la structure du livre, j’ai beau travailler comme un âne sur la construction, j’ai conscience que la trop grande maîtrise est ennuyeuse. La solution, c’est de rester ouvert, à l’écoute du livre, de sa logique. Par exemple, le roman s’arrête beaucoup plus tôt que je ne l’avais d’abord imaginé. Au départ, je pensais que l’on verrait le narrateur et Marie quitter l’île d’Elbe. J’imaginais la dernière scène du livre sur le bateau du retour, je pensais souligner le fait que pendant tout leur séjour à l’île d’Elbe, ils n’avaient jamais enlevé leurs manteaux (même dans la chambre d’hôtel, même pendant la scène d’amour), et que la grosse valise de Marie qu’ils trimballent tout au long du récit n’a en définitive jamais été ouverte. Mais je me suis rendu compte que le livre devait se terminer avec la scène d’amour dans la chambre de la Rivercina. Que ça devait finir là, que plus rien n’avait d’importance ensuite. J’ai écouté le livre. Certains écrivains disent qu’à un certain moment, leurs personnages leur échappent. Non, mes personnages ne m’échappent pas (sinon, ne vous inquiétez pas, je les rattraperais), mais le livre impose sa propre structure.
Marie est très peu décrite physiquement mais, à l’occasion de l’exposition au Louvre l’année dernière, vous avez choisi de la représenter sous les traits de Dolores Chaplin dans deux des trois courts-métrages inspirés de scènes de Fuir que vous avez réalisés : mettre un visage réel sur ce personnage a-t-il été problématique ?
Oui, c’est une décision difficile, mais au cinéma, on ne peut pas y échapper, il est indispensable d’incarner les personnages par des acteurs et je suis très content d’avoir choisi Dolores Chaplin, avec qui j’avais déjà travaillé sur La patinoire. Mais, pour moi, Marie reste un personnage mental, comme une figure de rêve, l’image qui se forme quand on pense à des proches qui sont absents : les traits de la personne ne sont pas définis. Je ne décris jamais physiquement les personnages, mais cela ne m’empêche pas de donner des détails très précis sur une robe, la position d’un poignet, de décrire sur plusieurs pages les chaussures de Jean-Christophe de G… Tout cela correspond aussi à une évolution générale du roman. Au XIXe siècle, il fallait décrire physiquement les personnages, leur visage, la forme de leur nez. Du coup, on trouve dans les romans de cette époque une gamme invraisemblable d’adjectifs sur la forme des nez… Je préfère rester dans une certaine indétermination. Il n’est jamais dit si Marie est brune ou blonde. J’aime mieux laisser le lecteur compléter le portrait, se faire lui-même sa représentation du personnage. Flaubert écrit quelque part que Madame Bovary est brune. Or, elle est blonde, à mon avis. Flaubert s’est trompé, c’est dommage (mais je ne lui en veux pas : tout le monde peut se tromper).
Dans ce dernier volet, le lecteur accède à une connaissance plus profonde de la personnalité de Marie. Le narrateur dit qu’elle est comme « nue à la surface du monde ». Il évoque sa « disposition océanique », son « adéquation consubstantielle au monde », posture existentielle qui donne une clé très importante pour comprendre les émotions exacerbées qui la submergent…
A un niveau immédiat, prosaïque, le titre fait référence au fait que Marie aime se promener à poil dès que possible, dans sa chambre, dans les jardins de la propriété de l’île d’Elbe. Il s’agit alors de cette « innocente lubie » dont parle le narrateur, mais le titre renvoie aussi, et surtout, à une nudité plus essentielle. On pourrait alors dire que la vérité sur Marie, c’est sa nudité.
Le narrateur paraît plutôt passif, soumis au rythme de Marie. Il attend ses coups de téléphone, la rejoint chaque fois qu’elle l’appelle, à la mort de son père, lorsque son amant Jean-Christophe de G fait une crise cardiaque…
Même si l’on ne sait pas grand-chose du narrateur, c’est tout de même lui qui a la parole, qui écrit, qui raconte, mais il est vrai que le personnage de Marie prend toute la place : elle est l’artiste, c’est elle qui occupe la position socialement dominante dans le couple, c’est elle qui est dans la lumière. Construire un personnage féminin fort, d’une telle ampleur, faisait partie du projet. Le cycle en entier porte d’ailleurs son nom : Marie Madeleine Marguerite de Montalte.
« Je fus alors pris de vertige car je me rendis compte que le présent que j’avais sous les yeux avait toutes les apparences d’une scène issue du passé et que ce n’était que maintenant, dans l’avenir, que j’en prenais conscience. » Dissimulé sur le toit du musée pour tenter d’apercevoir Marie, le narrateur médite sur une sorte de collision des temps qui apparaît très souvent dans vos livres…
J’aime jouer sur tous ces présents superposés. Le narrateur exprime en fait exactement ce que vit le lecteur quand il lit un livre : être là et ailleurs en même temps. Je me sers des sensations réelles du lecteur. D’ailleurs, pour les lecteurs qui ont commencé à lire Faire l’amour il y a dix ans, le temps réel de la lecture, qui est le vrai temps, se superpose au temps de la fiction qui s’étale sur à peu près deux ans. J’aime que le temps romanesque, le temps de la fiction, se superpose au temps réel de la lecture. Ça permet de rendre plus sensible, concrète, la dialectique entre amour et rupture, qui est en permanence à l’œuvre dans l’ensemble du cycle.
A la sortie de Faire l’amour, on a parlé d’une nouvelle orientation romanesque, d’un changement de forme par rapport aux romans que vous aviez écrits jusque-là. Comment l’analysez-vous ?
Dans mon esprit, il ne s’agit pas d’une rupture, mais plutôt d’une nécessité de se renouveler. Je venais d’avoir 40 ans, quinze ans s’étaient écoulés depuis mon premier livre, nous entrions dans le XXIe siècle. Je ne voulais pas refaire toujours le même livre. Je voulais explorer quelque chose de nouveau, une certaine gravité s’est imposée à moi. Mais l’humour n’a pas complètement disparu. Il y a dans Nue une scène de quiproquo qui, dans sa fantaisie et son impertinence, peut rappeler certaines scènes de La salle de bain. De la même manière, il était possible de deviner une certaine gravité sous-jacente dans mes premiers livres, qui annonçait déjà la gravité qui imprègne le cycle de Marie.
A l’occasion de la réédition en poche de vos livres, vous proposez au lecteur des textes en complément. La vérité sur Marie est ainsi suivi d’un dialogue avec Pierre Bayard, « une enquête » titrée L’auteur, le narrateur et le pur-sang où vous échangez vos points de vue…
Je suis très heureux et très fier que Pierre Bayard ait accepté de s’associer à moi pour cette enquête littéraire sur La vérité sur Marie. J’aime que la publication des livres en poche soit accompagnée de compléments, qui sont soit des prolongements théoriques comme dans Autoportrait à l’étranger (2000, 2012), auquel j’ai ajouté une préface où j’analyse l’autoportrait comme genre littéraire, soit des espaces d’échanges où je peux m’exprimer indirectement sur des questions littéraires ou sur les enjeux de l’écriture, comme dans « Pour un roman infinitésimaliste », un entretien avec Laurent Demoulin qui accompagne l’édition de poche de L’appareil-photo, ou « Ecrire, c’est fuir », un entretien avec Chen Tong, mon éditeur chinois, qui accompagne l’édition de Fuir en collection « Double ».
A présent que le cycle de Marie est achevé, avez-vous une idée de la direction que vous allez prendre ?
Pour l’instant, il y a un grand vide, même si je vais encore vivre un moment avec Marie, au moins le temps de la sortie du livre. J’ignore encore ce que je vais écrire ensuite, mais une réflexion s’impose qui, j’en ai conscience, engagera les dix prochaines années… <
Jean-Philippe Toussaint, Nue, Minuit, 14,50 euros, 176 p., ISBN : 978-2-7073-2305-7. En librairie le 5 septembre.