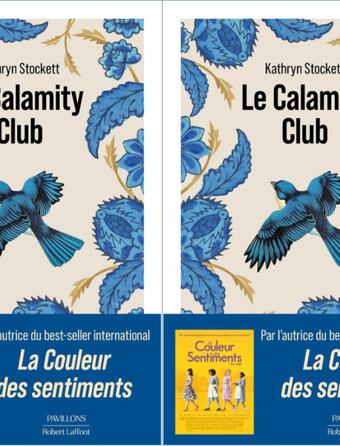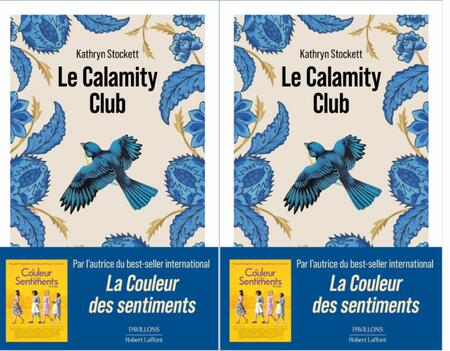T’as-l’air-d’un-ca-da-vre », dit Jeanne Moreau, en détachant chaque syllabe, à Maurice Ronet dans Le feu follet de Louis Malle. C’est à travers la vitre d’une galerie qui les sépare qu’elle énonce cette phrase au héros qui se suicide à la fin du film. Ainsi commence Qu’est-ce qu’une place ? de Michel Gribinski, qui paraît concomitamment à la 24e livraison de la revue de psychanalyse Penser/rêver qu’il a créée et qu’il dirige depuis 2007. Le livre s’ouvre sur une ouverture, brèche remémorée : une séance de cinéma, la sortie du Feu follet en 1963, en présence d’une Solange : « plus âgée que moi et bien moins glacée que la Solange du film, la maîtresse de maison de la soirée sinistre chez les bourgeois intellectuels ». « Nous étions entrés dans la salle en fin d’après-midi et, à sa sortie, il faisait nuit : le grand espace noir et blanc où l’on s’est caché était dehors. Ça scintillait, nuit et jeunesse confondues dans un âge que je n’avais pas souvent mais, cette fois-là, si - et si vivement. » L’étudiant de médecine de 20 ans rentre tard chez lui, chez ses parents, station Michel-Ange-Auteuil, vers cette « table triste et figée, pesante, du repas du soir », vers la place qu’il retrouve « malheureusement ». Sans doute cette place n’était-elle déjà plus la sienne. « C’était la première fois que j’ai senti que j’avais une place dans le désir d’une femme », se souvient-il.
Elégante placidité
Né en 1942 à Cannes, lorsque sa famille d’origine juive était en fuite, Michel Gribinski a joué parmi les ballots de fourrure de l’atelier de son père pelletier, dans le 9e arrondissement de Paris. Typique produit de la bourgeoisie juive assimilée, le jeune Michel habite à l’ouest de la capitale. A la maison, « pas un livre, mais France Soir et Paris Match », et une chape de plomb sur la catastrophe survenue pendant la guerre (17 membres de sa famille ont disparu). Il fréquente le lycée Janson-de-Sailly, «un formidable endroit de liberté». Sinon, le jeune homme peint. A 14 ans, il est repéré par la galeriste d’avant-garde Colette Allendy qui lui promet de l’exposer, mais la mort de cette dernière met fin au projet. Admiratif du tachiste Léon Zack ou des abstraits lyriques Zao Wou-Ki et Wols, il continue de peindre « par nécessité » jusqu’à l’âge de 30 ans, où il arrête définitivement. Il étudie la médecine pour faire plaisir à son père. Alors sa place, il ne la trouvera pas aisément, ou plutôt s’y sentira souvent si mal.On peine à le croire en discutant avec ce monsieur à l’élégante placidité dans l’intérieur cosy de son cabinet sis dans le quartier du Marais. Autour de l’incontournable divan, des livres, des assiettes en faïence de Gien représentant des monuments parisiens dans un fantaisiste décor de palmiers, un tableau anglais d’un enfant sur le ventre lisant. Le psychanalyste le rappelle avec un sérieux souriant, il n’est pas venu à la psychologie des profondeurs par la théorie : « J’ai d’abord été un très bon malade, je me sentais si peu à ma place qu’à l’âge de 19 ans j’ai poussé la porte d’un dispensaire et j’ai demandé l’aide de quelqu’un. » Il tombe sur « un type remarquable » : le psychanalyste et neuropsychiatre Victor Smirnoff. « En un an de thérapie, le monde a pris des couleurs, les choses se sont ouvertes et quelques années plus tard, quand les choses se sont à nouveau refermées, j’ai fait une analyse. C’était pour moi, pas pour devenir analyste, et puis en cours de route je n’ai plus vu la possibilité de faire autre chose que ça. » Avant de troquer le divan du patient contre le fauteuil du psy, il lui aura fallu treize ans d’analyse avec J.-B. Pontalis, « rencontré lors d’une manifestation en 68 ». Il en rit encore : « Je me suis dit qu’il avait l’air si étonnamment seul qu’il pourrait me comprendre. Or c’était la personne la moins seule du monde, un homme de conversation qui avait une vie sociale très épanouie à laquelle il prenait beaucoup de plaisir. Ma complicité était a priori totalement imaginaire. » Et réelle à la fois, puisque Pontalis l’invitera plus tard au comité de sa Nouvelle Revue de psychanalyse et l’aidera à mettre le pied dans l’étrier de l’aventure éditoriale - Gribinski traduit notamment Winnicott. Une amitié faite de convergences fortes comme de fâcheries. Mais feu le directeur de la collection « L’un et l’autre » a toujours vu dans la revue de son ami, Penser/rêver, et dans sa collection du même nom une continuation de cette vision « de la psychanalyse qui ne fait pas de la psychanalyse » mais croise d’autres champs. Au premier chapitre de Qu’est-ce qu’une place ? fait écho le dernier, sur la porosité, la possibilité d’ouverture « lorsque les mots se mettent à communiquer et toutes les places ne font qu’une ».
Sean J. Rose
Michel Gribinski, Qu’est-ce qu’une place ?, «Penser/rêver», L’Olivier, 114 p., 13 €.
Penser/rêver, n°24, « Façon de tuer son père et d’épouser sa mère quand on est l’enfant d’un couple homoparental », L’Olivier, 396 p., 20,50 €.