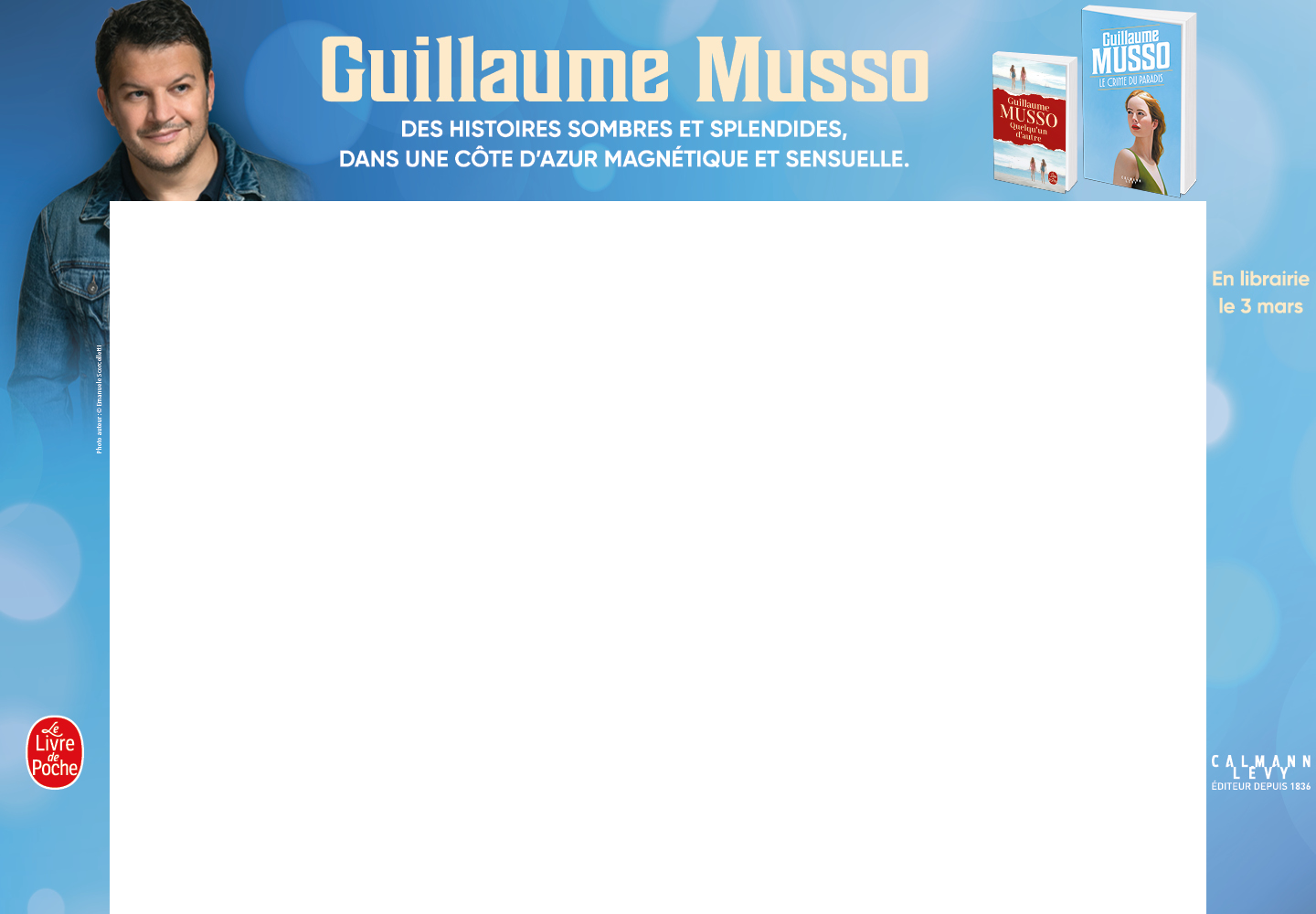À la Foire du livre de Francfort, la conférence « How Books Travel Today », organisée le 16 octobre sur la scène centrale en partenariat avec Creative Europe, ThinkPub et la Slovenian Book Agency (JAK), a dressé un portrait en mouvement des marchés européens de la traduction. Réunissant Ruediger Wischenbart, consultant, et les universitaires Anja Kamenarič et Miha Kovač (Université de Ljubljana), la rencontre a dévoilé les premiers résultats d’une vaste étude en cours sur les flux linguistiques du livre en Europe. Le rapport complet paraîtra à la fin de l’année.
Une production en baisse, des traductions stables
Selon les premiers indicateurs rassemblés par la JAK auprès des bibliothèques nationales européennes, la production globale de livres originaux tend à reculer depuis dix ans, alors que la proportion de traductions reste globalement stable. « Partout, les éditeurs corrigent la sur-production de livres », estime Ruediger Wischenbart. Depuis les années 1950, la production totale, y compris les traductions, a fortement augmenté, mais, sur la grande majorité des marchés la tendance est à la baisse depuis la dernière décennie.
La France demeure une grande puissance traductrice, selon Ruediger Wischenbart, et le français reste aussi, dans la plupart des pays, la deuxième langue la plus traduite après l’anglais, même si le japonais — porté par la vague manga — le dépasse parfois, comme en Allemagne. Ceci loin derrière l'anglais, qui reste la première langue émettrice, phénomène qui tend à s'intensifier partout sur le continent ces dernières années.
Petits marchés, grandes proportions
Autre constat : dans les petits marchés linguistiques, la part de traduction est beaucoup plus forte : jusqu’à 40 % des titres en Lituanie ou en République tchèque, et de 20 à 30 % en moyenne dans les « petites zones linguistiques ». Les langues les plus traduites y demeurent les mêmes — anglais, français, japonais — parfois suivies de l’allemand ou du russe.
En Catalogne par exemple, où l’on traduit chaque année plus de 1 000 titres sur 6 000 publications originales, l’anglais domine même l'espagnol. Dans la majorité des petits pays européens, plus de la moitié des traductions proviennent de l’anglais, avec des taux culminant à 70% en Islande et 60 % en Slovaquie. Miha Kovač a rappelé que seulement 47 % des Européens peuvent tenir une conversation en anglais, un enjeu linguistique qui continue de structurer ces échanges.
L’IA, un nouvel acteur dans l’arène
La question de l’intelligence artificielle s’est naturellement invitée dans le débat, qualifiée par les intervenants de l'université de Ljubljana d’« éléphant qui est entré dans la pièce ». Une expérience menée à Ljubljana a été présenté, consistant à traduire un poème slovène vers l’anglais, puis vers le zoulou, avant de le renvoyer vers l’anglais. Résultat : une « hallucinante » perte de sens, démontrant la fragilité des chaînes de traduction automatisées.
« Nous sommes en l’an trois après l’IA grand public », a noté Miha Kovač. « En l’an dix, pourra-t-on changer la langue d’un e-book comme on change de police ? », s’est-il interrogé, non sans ironie. « Et si les traducteurs réguliers n'auront plus de travail, est-ce que les meilleurs en auront trop ? », a-t-il ajouté.
Et les perspectives esquissées par les statistiques et les intervenants vont au-delà de la traduction : avec la prolifération des formats numériques, le texte devient un objet démultiplié, parfois à un seul exemplaire, parfois à des millions. « Il existe aujourd’hui des millions de contenus similaires à des livres, dérivant dans un univers de lecture totalement hors du radar des statistiques traditionnelles », a résumé Ruediger Wischenbart. Et de l'avis général, ce nouveau paysage, où cohabitent publications imprimées, numériques et audio, rebat les cartes de la circulation culturelle européenne.