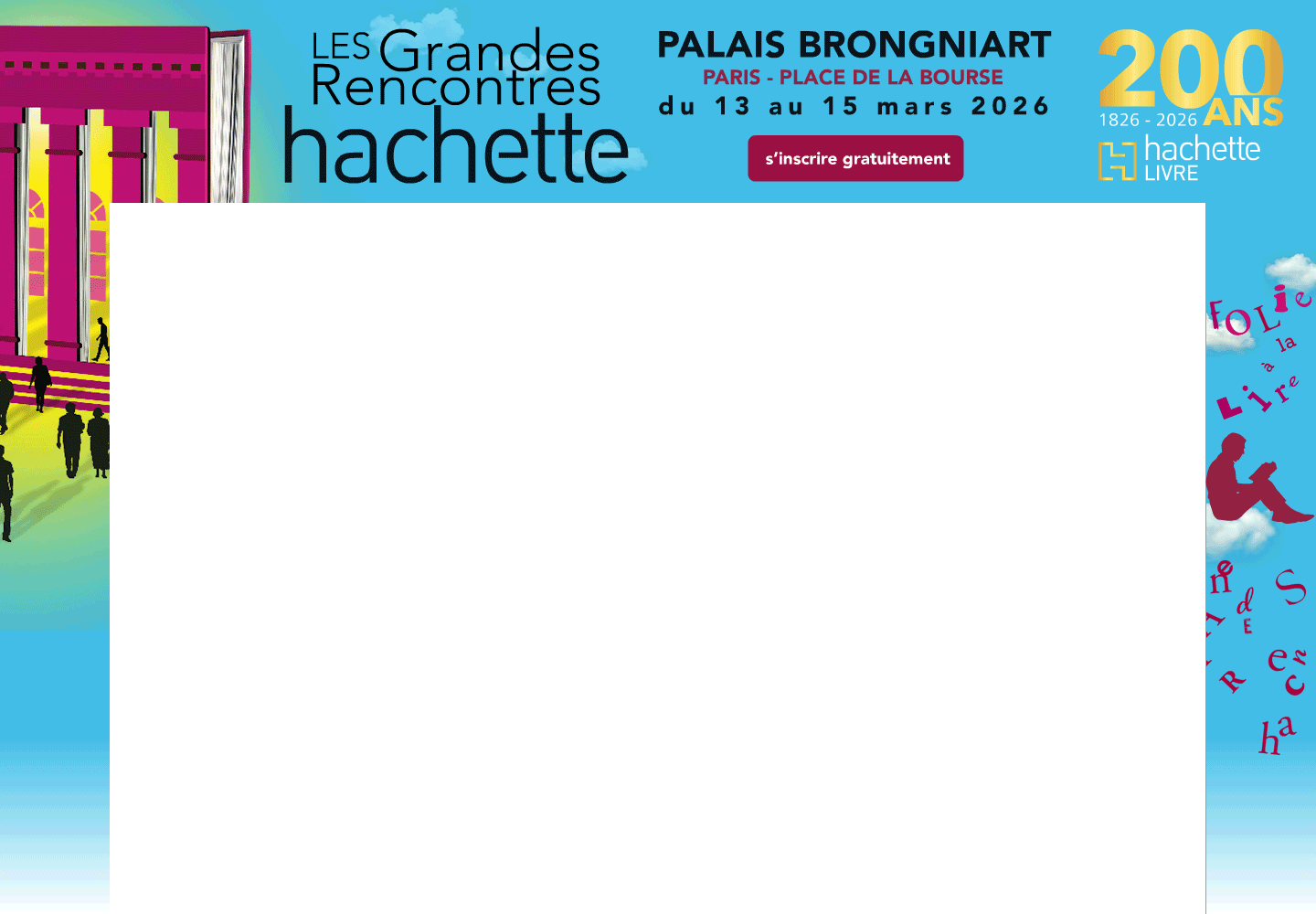Le marché des ouvrages sous licence est extrêmement rodé depuis des années ». A la tête de l'agence de conseil Kazachok, Nathalie Chouraqui accompagne depuis vingt ans éditeurs et ayants droit pour leurs projets de marque. Elle organise chaque année la grand-messe française B2B de la licence, le salon Cobrandz, qui se tiendra les 1er et 2 juillet prochains. Les marques et producteurs de contenus s'y croiseront pour mettre au point des produits dérivés. Quelques poids lourds de l'édition comme Delcourt, Mediatoon et Hachette y seront présents. « Pour les ayants droit, le livre comme produit secondaire apporte un supplément d'âme à leurs marques », assure Nathalie Chouraqui.
Plusieurs milliers de titres sous licence paraissent chaque année en France. L'essentiel de cette activité se concentre autour des univers de pop culture et jeunesse, de Disney à Marvel en passant par Star Wars. Comme pour tout produit dérivé, en l'échange de royautés sur le produit fini, le licencié confie l'exploitation de sa marque à l'éditeur. « Mais un livre n'est pas une paire de chaussettes », souligne Antoine Béon, directeur de Hachette Jeunesse Disney, qui publie plus de 300 titres par an. Plutôt qu'un pur produit de consommation mercantile, « le livre permet aux ayants droit de déployer leurs univers narratifs sur d'autres supports, par le biais d'un produit très institutionnel, qui va accréditer la puissance de leur franchise », rajoute le responsable.
Un produit institutionnel
Contrairement au textile ou au jouet, « le livre ne rapporte pas des sommes considérables », assure Rodolphe Lachat, directeur de Huginn & Muninn, la filiale de Média-Participations consacrée aux beaux livres sur la pop culture. L'envie des détenteurs de droits de se tourner vers une publication papier « dépend plutôt de la culture d'entreprise et de l'historique de la licence », estime l'ancien directeur éditorial des éditions du CNRS. Parmi les plus imprégnées dans l'imaginaire collectif, les marques Disney ont un long passif avec l'imprimé. Le premier ouvrage sous licence publié par Hachette remonte à 1931. « Pour ces entreprises, le livre est autant un facteur de développement qu'un moyen de faire vivre et de dynamiser leur patrimoine », observe Rodolphe Lachat.
L'enjeu est d'autant plus saillant sur le segment jeunesse, puisque le livre permet « d'installer la marque dans les espaces institutionnels comme les écoles, les bibliothèques, les mairies, etc. », avance Nathalie Chouraqui. « Le rapport aux jeunes est extrêmement important pour nos ayants droit, abonde Alexandra Bentz, directrice du pôle jeunesse d'Edi8, qui édite notamment les livres Pokémon, Smiley et Barbapapa. Le livre est un objet prestigieux qui va accompagner les enfants tout le temps, c'est une question d'image de marque ».
« Chaque titre, un nouveau pari »
Pour assurer un certain standard de qualité, la confection des ouvrages est soumise à un processus d'approbation plus ou moins strict de la part du licencié. Une étape parfois fastidieuse qui demande « beaucoup de ressources », estime Moïse Kissous, président du groupe Steinkis. Ancien champion de la BD sous licence avec Jungle au début du millénaire (Totally Spies, Bob l'éponge...), l'éditeur a progressivement réduit la voilure à partir des années 2010. « Le temps de passer sous les fourches caudines de l'ayant droit, il existe un risque que la licence ne fonctionne plus », assure-t-il. Dictée par des cycles médiatiques dont le contrôle échappe aux éditeurs, la popularité aléatoire des franchises pose un véritable défi.
« Chaque titre est un nouveau pari, on dépend totalement de la licence », concède Samantha Thiery, responsable éditoriale du Dragon d'or, chez Editis. L'éditrice se souvient d'un coffret aux couleurs de la série Chica Vampiro, élaboré au printemps pour être commercialisé pendant les fêtes de fin d'année. « Entretemps, la licence, qui n'était plus alimentée par de nouveaux épisodes, s'est effondrée. » Afin de réduire sa dépendance aux effets de mode, Edi8 a opté pour une stratégie de partenariats « qualitatifs » pour développer des gammes courtes et ciblées, avec des institutions comme le Louvre, Versailles ou bien le journal Le Monde, tout en développant des produits inspirés de grandes franchises comme Le seigneur des anneaux et Friends.
« Même dans le cas des licences les plus pérennes, la popularité de la marque est vouée à baisser, surtout en jeunesse où les enfants s'attachent rarement longtemps aux univers », estime pour sa part Moïse Kissous. Voyant la durée de vie des licences se réduire de plus en plus, l'éditeur a opté pour une approche originale : développer des bandes dessinées qui parodient les plus gros blockbusters audiovisuels. Galère of Thrones pour Game of Thrones, La terre du milieu mais un peu sur la gauche pour Le seigneur des anneaux... « La parodie accorde beaucoup plus de liberté que la licence, limite les coûts et prouve qu'on peut faire tout aussi bien avec de la création », juge l'éditeur.
Aux aléas liés à la santé de la marque se rajoute une concurrence « de plus en plus rude » et des « minimums garantis de plus en plus élevés » demandés par les ayants droit, relève Sébastien Dallain, directeur éditorial de Panini France, franchisé sur les univers Marvel et Star Wars. L'apparition de nouveaux acteurs sur le segment comme 404 éditions, Hachette Heroes ou encore Mana Books a cimenté la niche en même temps qu'elle la conduisait vers une certaine forme de saturation.
« Maintenant, il existe un risque qu'un titre ne se vende vraiment pas du tout, explique Alexandra Bentz. Depuis quelque temps, on voit finalement assez peu de nouvelles licences décoller dans les ventes. » L'éditrice n'hésite pas à parler d'une forme de « best-sellarisation » du marché autour des franchises iconiques, en partie due à la fermeture des commerces. « L'achat d'impulsion, essentiel pour émerger sur ce segment, a été supprimé pendant un temps », avance la responsable. Pour Rodolphe Lachat, le meilleur moyen de remédier à cette « fatigue » de la licence est de se « recentrer sur les valeurs sûres » et les « grands univers inépuisables avec de larges communautés de fans ».