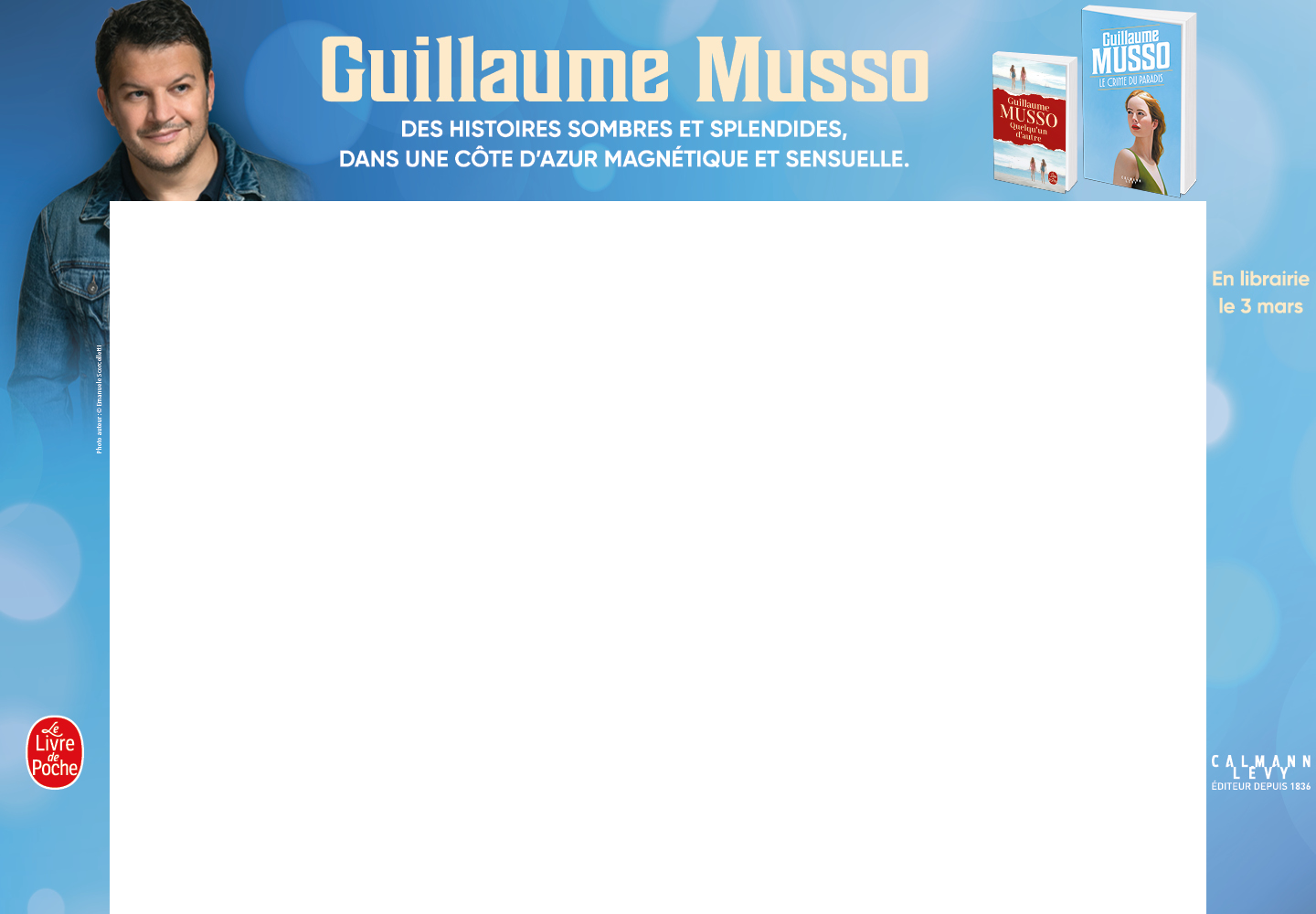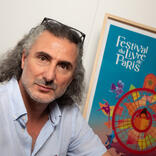Plus d’une heure de queue pour avoir sa dédicace de Leïla Slimani. L'autrice franco-marocaine a notamment écrit Sexe et mensonges (Les Arènes), qui raconte les injonctions sociales, et notamment sexuelles, pesant sur les femmes marocaines.
Une thématique revenue à plusieurs reprises au festival du livre de Paris 2025, qui s’est tenu du 11 au 13 avril au Grand Palais, avec le Maroc en invité d’honneur.
Écrire le désir
L'enjeu des injonctions sociales au Maroc n'est pas seulement saisi par les femmes : dans une table ronde intitulée « S’autoriser à être soi », Abdellah Taïa, auteur du Bastion des larmes (Julliard), a raconté comment dans des sociétés où l’orientation sexuelle et la sexualité sont âprement refoulées, il pouvait littérairement exprimer son homosexualité. Pour Souleiman Berrada, qui a écrit Le Baigneur (Le Soupirail), cela passe par une langue poétique, aquatique, seyant à l’univers des hammams. « L’eau éveille des frissons ; et être à moitié nu, c’est se montrer dans sa vérité », confie-t-il.
Les femmes en force
Une vérité qui sort de plus en plus chez les écrivaines marocaines, soutenues par leurs éditeurs. « On reçoit de plus en plus de manuscrits d’autrices. Pour moi, l’avenir, c’est la femme », proclame l’éditeur Yacine Retnani, de La Croisée des chemins. Pour l’anecdote, il est venu la première fois au Festival en… 1981, quand il était encore dans le ventre de sa mère, libraire à Casablanca. Le bestseller de la maison : Au-delà de toute pudeur, un essai sur l’émancipation de la femme.
L’association Mentor’Elles a connu lesuccès Les Intrépides, portraits de Marocaines combatives et inspirantes. Y figure la sociologue Fatima Mernissi (1940-2015) qui n’a pas voulu publier de son vivant au Maroc La peur-modernité, conflit islam démocratie. L’essai est aujourd’hui publié aux éditions du Fennec.
Présente au Festival : Salma El Moumni raconte dans Adieu Tanger (Grasset) l'impossible retour chez soi et la douleur du déracinement. Dounia Hadni, dans La Hchouma (Albin Michel), relate l’écartèlement entre des dictats contradictoires visant à faire d’elle « une bonne Marocaine » et « une vraie Parisienne ». Bref, le récit d’une lutte pour la liberté.
Dialogue entre les autrices marocaines Souad Jamaï et Fedwa Misk au Grand Palais
Les autrices marocaines Souad Jamaï et Fedwa Misk.- Photo FANNY GUYOMARDPour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.
« Il y a une écriture de femmes qui explose », observe la critique littéraire Fedwa Misk, autrice de Nos mères (La Croisée des chemins), qui estime que « les hommes cherchent le pouvoir, les femmes la liberté ». « Ils le perdent sur les femmes !, réagit l’écrivaine Souad Jamaï. Elles ne veulent plus forcément se marier. »
S'ensuit le dialogue suivant entre les deux femmes :
- L’amour ne doit plus être un sacrifice. Comme d’autres choses. On le voit : les autrices se saisissent de toutes les libertés dans leurs écrits. Et elles ne tombent plus dans le piège de l’Occident rêvé, qui porte d’autres injonctions. Elles ont compris qu’on devait se sauvait chez soi.
- Le voyage est formateur.
- On peut aussi faire un voyage intérieur. Chercher au fond de soi. Ne pas attendre le sauveur.
- Ça s’appelle le syndrome de Cendrillon, rebondit Souad Jamaï, qui a écrit la pièce de théâtre La Version des fées, dans laquelle des princesses interrogent leur condition dans un Maroc moderne, comme Cendrillon mais aveuglées par un faux prince charmant rencontré sur Tinder. Dans Les ailes de papier, elle « parle du rêve emprunté aux parents, celui de partir. Mais comment peut-on réussir dans un autre pays si on ne réussit pas chez soi ? Tu dois avoir des bases, les reins solides pour partir ».
Pour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.
Pressions
Des voix fortes, mais pas toujours bienvenues. Les éditions du Fennec ont subi la censure des Salons du livre de Doha et du Caire. Autre histoire : invitée sur un plateau télévisé national marocain, en direct, pour parler d’Effacer (publié en France Au Diable Vauvert), Loubna Serraj a appris quelques minutes avant d’entrer sur le plateau qu’elle devait taire la relation homosexuelle entre les deux protagonistes (femmes).
Loubna SerrajPour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.
La loi qui interdit l’avortement est en cours de réflexion. « Mais ça n’est pas le combat principal. D’autres sujets chauds sont interrogés, comme la tutelle des enfants forcément attribuée au père, l’héritage privilégiant les fils (car c’est écrit dans le Coran)… Le roi est dans une posture délicate, il ne doit pas bousculer. Des sujets sont tabous, comme les relations sexuelles hors mariage. Quand vous demandez une chambre d’hôtel avec un homme, le réceptionniste demande votre carte d’identité », rapporte l’autrice Myriam Jebbor.
« La société marocaine est foncièrement patriarcale et traditionaliste », résume Fedwa Misk, qui a pu recevoir à son bureau des appels téléphoniques de lectrices lui reprochant de salir l’image de la femme marocaine en partageant des récits sur l’avortement. Sa BD Des Femmes guettant l’annonce (avec Aude Massor, aux éditions Sarbacane), a fait l’objet de débats enrichissants lors de rencontres.
Mais le lectorat reste limité. Pour « créer un débat public, il faut écrire pour la télé », avance Fedwa Misk, qui regrette que son scénario sur l’histoire de trois femmes divorcées, publié à l’écran, ait été édulcoré. Mais sur papier, ses écrits ne perdent rien de sa verve.
Extrait de La version des fées, pièce de Souad Jamaï (La Croisée des chemins)
Journaliste : « N'est-il pas trop dur, parfois, de porter ce mythe de la femme arabe ? »
Shéhérazade : « Vous parlez de la condescendance qui nous renvoie à une sorte d'impuissance de la femme arabe ? C'est une image façonnée par les orientalistes qui suppose que la femme arabe est soumise ; ce regard, parfois agaçant, nous place dans une position dans laquelle nous ne nous reconnaissons pas. Nous sommes bien plus libérées qu'ils ne le croient. Mais je suppose que cela doit plaire à l'imaginaire de certains qui se prennent pour des libérateurs. »
Pour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.