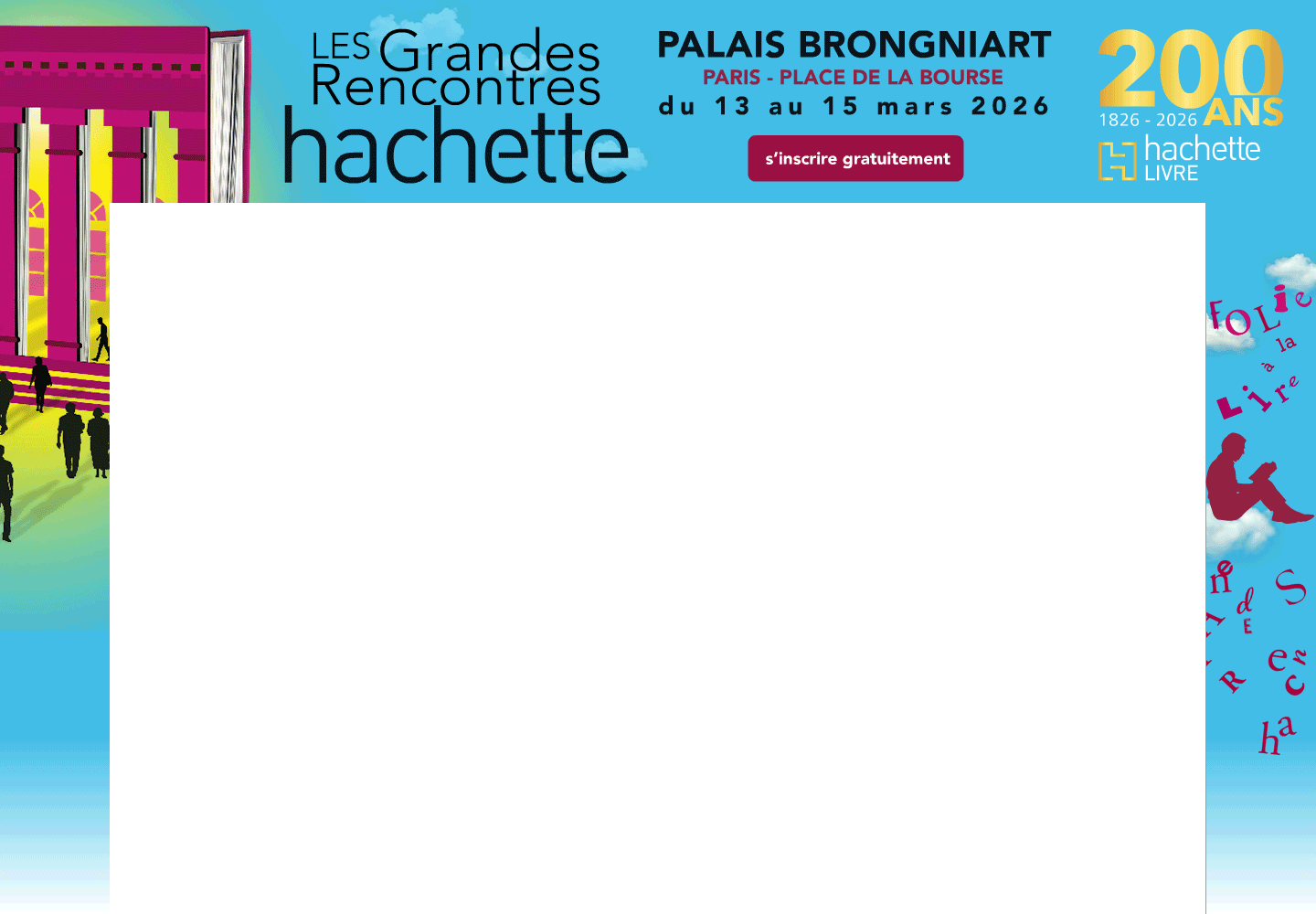Livres Hebdo : Dans quelles circonstances est né Sindbad ?
Farouk Mardam-Bey : C’était une toute petite maison indépendante, créée en 1972 par Pierre Bernard, afin de « renouer un lien avec le monde arabe », dans le cadre de la politique gaullienne de l’époque. Bernard, qui n’était pas un arabisant, était d’ailleurs gaulliste, et il a entretenu des liens privilégiés avec le président Boumédiène. Typographe de formation, l’éditeur publiait des livres très soignés, avec des couvertures qui se remarquaient. Son premier succès a été Le Roman de Baïbars, une épopée ottomane en arabe du XVIe siècle. Il en a publié six volumes jusqu’en 1992, quatre autres sont parus ensuite. Bernard, dans son travail, était soutenu par de grands arabisants, comme André Miquel et Jacques Berque.
Comment Sindbad est-il arrivé dans le groupe Actes Sud ?
En 1995, à la mort de son fondateur, Sindbad était à vendre, et c’est Hubert Nyssen, alors patron d’Actes Sud, qui a fait la meilleure offre. La maison d’Arles avait créé, en 1990, sa propre collection « Mondes arabes », qui avait publié une douzaine de titres. Une fusion avec Sindbad et ses quelque 50 titres, dont ceux de l’Égyptien Naguib Mahfouz, beaux succès en librairie, faisait sens. Nyssen m’a alors appelé pour prendre la direction de l’ensemble. J’étais conseiller à l’Institut du monde arabe, et j’avais travaillé avec Bernard pour le Salon du livre arabe. À l’origine, la collection avait un programme éditorial ambitieux, avec jusqu’à huit ou dix titres par an.
Quels ont été vos axes majeurs ?
Nous avons publié essentiellement des romans et des nouvelles de tout le monde arabe, quelques essais et de la poésie, en pratiquant une vraie politique d’auteur. C’est ainsi que nous avons édité toute l’œuvre de Naguib Mahfouz, et celle d’Alaa El Aswany dont L’Immeuble Yacoubian (paru en Égypte en 2002, traduit en France en 2006) a remporté un succès mondial et demeure notre best-seller, avec 300 000 exemplaires vendus. Nous avons aussi édité les écrivains libanais « de la guerre civile », qui écrivent en arabe, et des Syriens, des Irakiens, des Koweitis, des Yéménites, sans oublier des auteurs maghrébins qui écrivent en arabe. Pendant longtemps, pour la littérature arabe, on était les leaders, presque les seuls.
L'exposition Sindbad à la fondation Corm à Beyrouth- Photo DR
Pour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.
Et aujourd’hui ?
Différentes crises sont passées par là. Et on constate, en France, un tassement des ventes de littérature étrangère traduite, quelles que soient les langues. Sindbad ne fait pas exception. Quand nous vendions autrefois 10 000 exemplaires de Mahfouz, aujourd’hui c’est plutôt 1 500 ! Et nos charges, elles, n’ont cessé d’augmenter. Nous avons donc réduit notre production à quatre titres par an, à un moment où l'on assiste à une surproduction de titres dans tout le monde arabe… Mon problème n’est pas de trouver des livres de qualité, mais de les vendre !
Comment voyez-vous l’avenir ?
C’est un peu « le dur désir de durer »… En ce qui concerne Sindbad, la relève est prête. Je travaille déjà avec Charlotte Woillez, qui vit à Arles. Elle est arabisante et traductrice, tout comme son mari. La transition se fera donc, le jour venu, sans souci. Je souhaite aussi que d’autres maisons d’édition françaises se lancent sur le monde arabe, comme Philippe Rey vient de le faire pour l’Algérie en association avec Barzakh. Sindbad prépare ses prochains titres : Il y avait du poison dans l’air, roman du Libanais Jabbour Douaihy, récemment disparu, traduit par Stéphanie Dujols, pour janvier. Et, en mars, La Bêtise comme on ne l’a jamais racontée, de l’Algérien Samir Kacimi, traduit par Lotfi Nia.