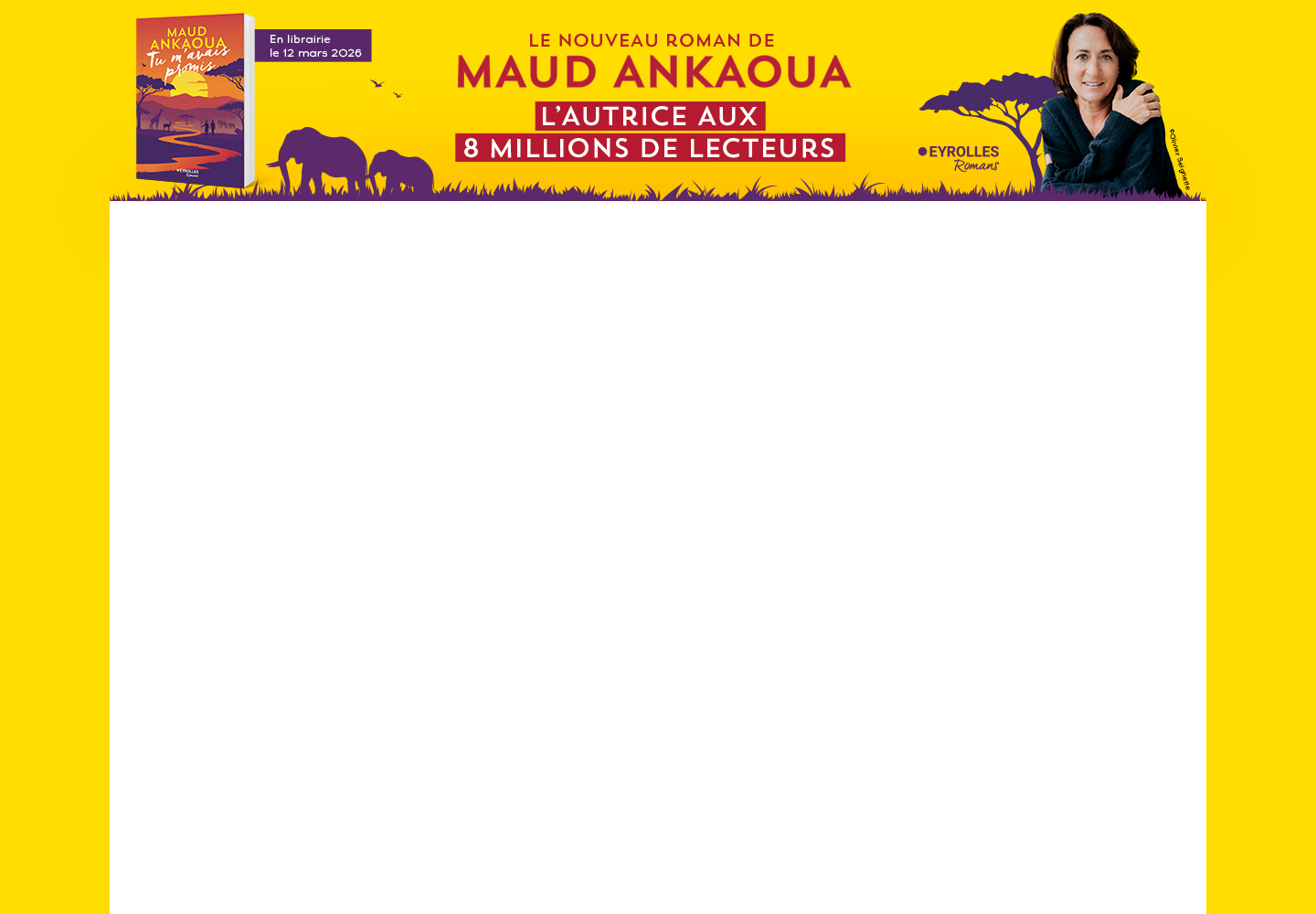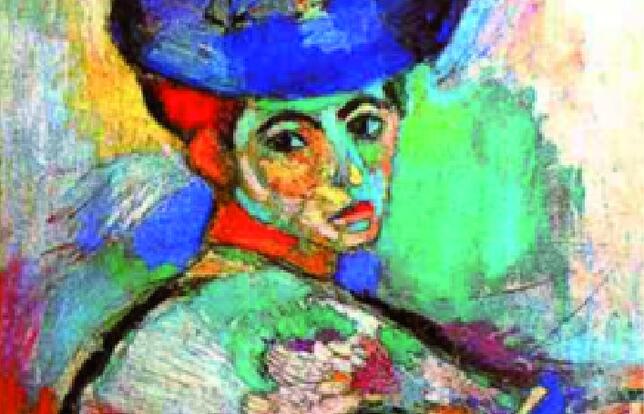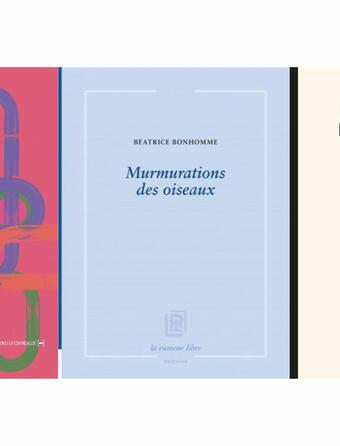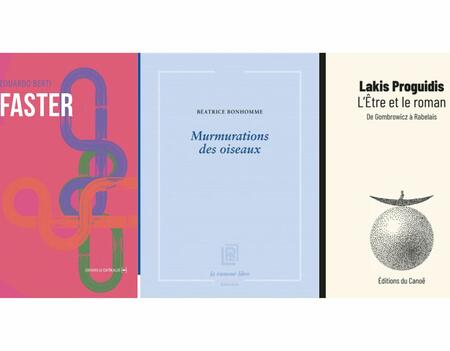Pour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.
Louis XIV a certes créé l’institution du Salon qui offrait au public le spectacle des tableaux les plus récents mais, en général, les œuvres des peintres se dérobaient au regard du plus grand nombre qui ne les possédait pas. Avant l’époque contemporaine et ces expositions qui allaient bouleverser la face de l’art, il est bien difficile de se faire une idée de la production artistique du moment. Le critique Jean-Luc Chalumeau raconte ici l’art moderne à travers ces « expositions capitales » qui ont révolutionné la grammaire des formes. Répondant aux exigences de la collection « 50 questions » chez Klincksieck, il retrace l’épopée de ce « regard exposé » en cinquante étapes allant de L’Exposition universelle de 1900 où Monet fut célébré comme « le plus grand peintre vivant » (Octave Mirbeau) à « Lucian Freud, l’atelier » au Centre Pompidou en 2010. Acclamations ou cris d’orfraie, Jean-Luc Chalumeau refait vivre l’émoi de ces grands instants comme si on y était. La troisième édition du Salon d’automne de 1905, acte de naissance du fauvisme avec Derain, Vlaminck, Marquet et surtout Matisse dont Lafemme au chapeau lui vaut de la part d’un critique réactionnaire un cinglant « on a jeté un pot de peinture à la face du public ». Scandale de la sculpture de Duchamp intitulée Fontaine - un urinoir signé « R. Mutt » -, à la suite duquel le père du ready-made démissionne des Independent Artists, ce projet de « salon d’indépendants » sans prix ni jury pourtant importé à New York par lui.
Autres temps, autres mœurs : « Sensation », l’expo choc organisée par le collectionneur et publicitaire anglais Charles Saatchi, fait un tabac à Londres et voit émerger les Young British Artists, dont Damien Hirst, auteur d’un requin baignant dans le formol.
Mais Jean-Luc Chalumeau ne se contente pas de faire figurer chronologiquement les événements phares comme la création du Moma de New York ; son livre est avant tout un exercice d’admiration pour les artistes mais aussi les mécènes et les commissaires d’exposition comme Jean-Hubert Martin (« Les magiciens de la terre », Grande Halle de la Villette et Centre Pompidou, 1989) ou Jean de Loisy (« La beauté in fabula », palais des Papes, Avignon 2000). Par le choix des questions posées, l’auteur dévoile ses engagements : non, le Français Pierre Soulages n’a pas copié l’Américain Franz Kline ; non, malgré la prophétie d’une certaine critique des années 1970, la peinture n’est pas morte, confer le figuratif Lucian Freud admiré par nombre d’ultra contemporains. S. J. R.