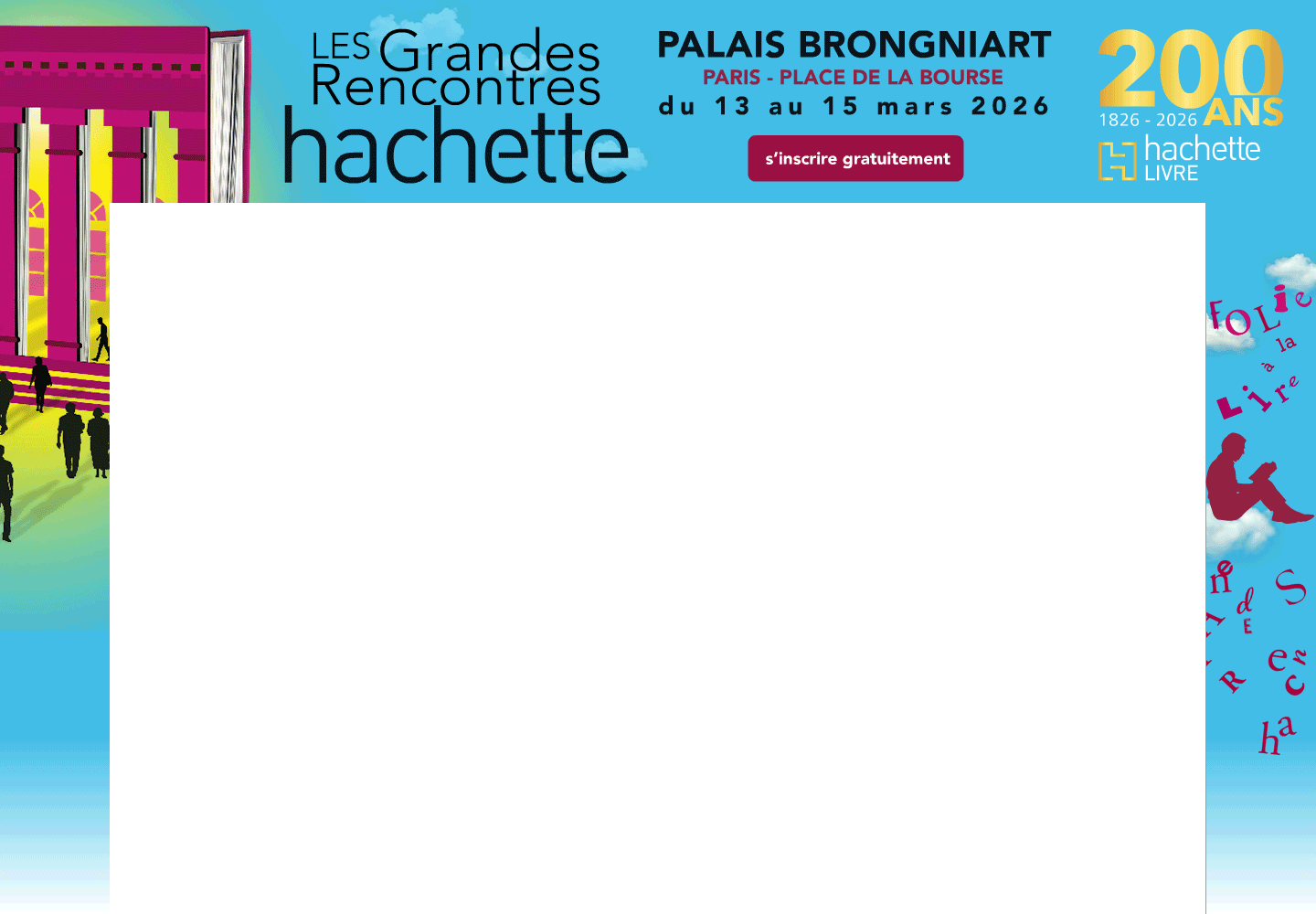Mis à part deux beaux livres de Jean-Philippe Domecq (Sirènes, sirènes, Seuil, 1985 et Ce que nous dit la vitesse, Quai Voltaire, 1994), un de Bernard Chambaz (A tombeau ouvert, Stock, 2016), quelques lignes éparses chez Leiris ou Vailland, dans la nomenclature des sports dits "littéraires", le sport automobile ne tient guère le haut du pavé. Curieux au fond, tant les questions de vitesse et de trajectoires, de mythologies et de tragédies, sont de celles qui font les bons livres.
C’est l’une des raisons (mais pas la seule, rassurons le lecteur rétif aux chevaux-vapeur) pour lesquelles la publication du Monte-Carlo du Belge flamand Peter Terrin est si bienvenue. Terrin y aborde la Formule 1 de la seule façon dont elle doit l’être : par le versant de la poésie.
Soit donc un grand prix, le plus prestigieux de tous, celui de Monaco. Jack Preston est mécanicien pour la prestigieuse écurie Lotus, et le meilleur pilote, Jim Clark. Nous sommes en 1968, alors que les voitures commencent à se barioler de sponsors et que Monaco commence à se rêver en cour d’école du Festival de Cannes. La preuve, Lily, cette jeune femme vedette d’Hollywood, qui remonte l’air de rien, et la grâce incarnée, la ligne de départ. Lorsque la Lotus prend brutalement feu, Jack protège la jeune actrice. Elle sera saine et sauve, lui gravement brûlé. Durant sa convalescence, l’humble mécano attend de Lily un signe qui ne vient pas. Pourtant, il se convaincra du contraire, jusqu’à la névrose, jusqu’à la folie, là où l’amour côtoie ce qui faisait jusqu’alors sa vie : la décence, la morale, la religion…
Peter Terrin tire son Monte-Carlo du côté de la fable et à la frontière du poème en prose. C’est un magnifique styliste qui fait sa pelote avec les icônes de la modernité de ce temps : les courses de F1, les stars d’Hollywood, les royaumes d’opérette, la fusée Apollo… A l’arrivée, un requiem endeuillé, puissant et lyrique. O. M.