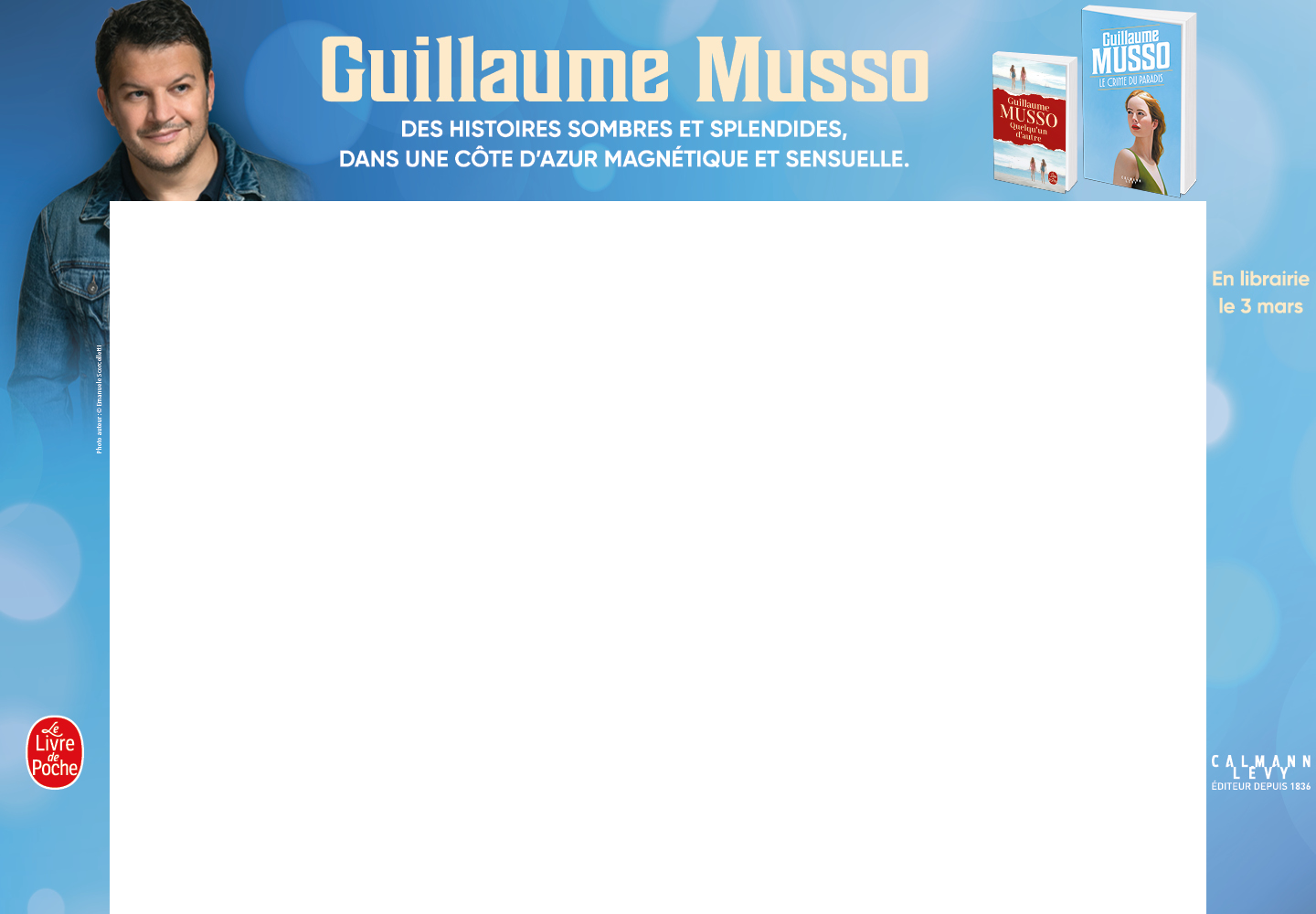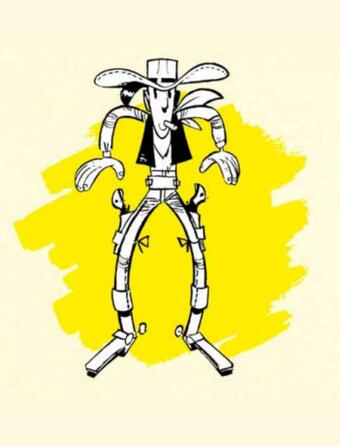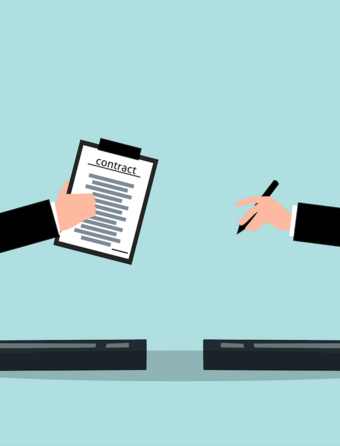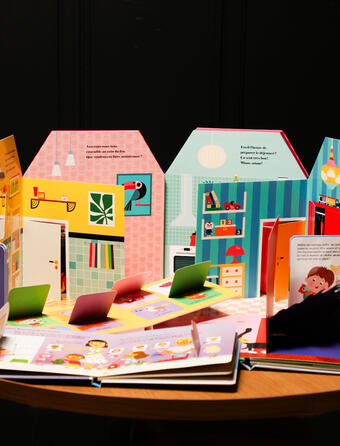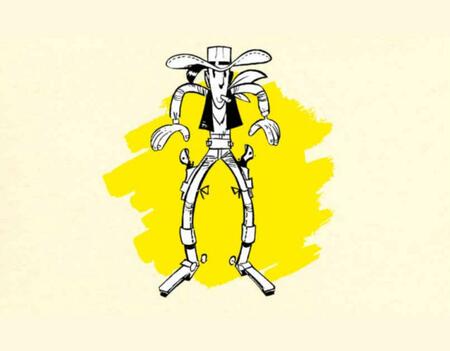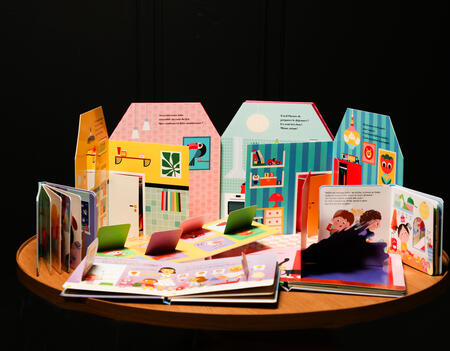Livres Hebdo : À un moment de Départ(s), l'un de vos personnages, Jean, parle de « ces trucs hybrides » que vous écrivez. Ce nouveau livre est-il hybride ?
Julian Barnes : Oui, absolument - c'est un mélange de fiction, de non-fiction et d'autobiographie, qui se recoupent. Cela ne surprendra pas mes lecteurs fidèles. Mon troisième roman, Le perroquet de Flaubert, était un ouvrage hybride. Tout comme Une histoire du monde en 10 chapitres et 1/2. J'aime aller là où l'histoire me mène, sans me soucier des codes du genre.
On peut y lire un essai sur la mémoire, un roman présenté comme une autofiction, et une partie de confidences intimes... Quoi d'autre ?
C'est également une méditation sur l'approche du départ final. Dans ma réflexion sur la mort, je suis les traces de Montaigne : nous devons l'envisager à la chute d'une tuile, au broncher d'un cheval, et souhaiter la trouver au jardin, en y plantant nos choux. La théorie veut qu'en pensant à la mort chaque jour, on en réduise la terreur. Ah, te voici enfin, murmurons-nous alors que les médecins se pressent à notre chevet, je t'attendais, je ne suis pas surpris. Si cette théorie fonctionne, je le découvrirai en mon temps, peut-être malheureusement trop tard pour en communiquer les effets.
On a l'impression, à la lecture, que vous avez pris beaucoup de plaisir à écrire ce texte composite...
Je me réjouis que cela se voie. L'écriture est, ou devrait être, un travail plaisant, comme l'est la lecture. Certains écrivains préfèrent la recherche ou les tournées de promotion à leur machine à écrire. Moi au contraire, je suis à l'aise assis à mon bureau.
Vous y instaurez une familiarité, voire une complicité avec votre lecteur, grâce à une grande liberté de ton, même quand vous traitez de sujets graves, comme la maladie et la mort. Est-ce naturel ou le fruit d'un important travail d'écriture ?
J'ai toujours été convaincu de l'importance de la manière d'entrer en contact avec le lecteur, et ce dès la première page. Certains écrivains se positionnent comme académiciens derrière un pupitre : leurs lecteurs deviennent élèves. Mon approche, comme vous le relevez justement, est celle de la complicité. Nous sommes côte à côte, nous regardons la même scène, je la commente et le lecteur écoute ce que je souffle à son oreille. C'est particulièrement le cas dans les dernières pages du livre.
Traitant de la mémoire involontaire, vous faites naturellement référence à Proust. Vous écrivez : « Il y a pas mal de Proust dans ce livre. Et je ne suis même pas proustien ». Qu'est-ce qu'être proustien, et en quoi ne l'êtes-vous pas ?
La définition d'un « proustien » forme un cercle : il partage les préoccupations sociales et intellectuelles de Proust, et se délecte de leur expression dans son texte. Ainsi, je ne suis qu'en partie proustien. Terence Kilmartin, un des traducteurs de Proust, était un très bon ami. Quand je me suis plaint de ma difficulté à entrer dans À la recherche du temps perdu, il m'a conseillé, plutôt que de commencer par le début, d'utiliser un index des thèmes. Je me rappelle avoir cherché « trains » dans un tel index, et lu les entrées. Elles étaient brillantes, finement observées, drôles et originales. Et pourtant je rechignais encore à lire tous ces volumes pour y parvenir. Parfois, je me sentais coupable, mais pas suffisamment pour m'y mettre à mon grand âge. Mon maître, si j'en ai un, reste Flaubert.
Parmi tous les autres auteurs que vous citez (Mallarmé, Baudelaire, Rimbaud, Gautier, Mérimée, Flaubert, Sand etc.), la plupart sont français, et du xixe siècle. Quels auteurs plus contemporains lisez-vous ?
Parmi les vivants : Modiano, Echenoz, Ernaux, Houellebecq. Récemment, j'ai adoré Vous êtes l'amour malheureux du Führer, de Jean-Noël Orengo.
Vos parents étaient professeurs de français. Vous-même avez étudié le français à Oxford dans les années 1960. Quel est votre rapport avec notre pays, sa culture, sa langue ?
La France est le premier pays étranger que j'ai visité, et, jusqu'à mes 21 ans, le seul. J'ai vécu à Rennes et enseigné au collège Saint-Martin de 1966 à 1967, et j'ai parcouru la France les années suivantes. Elle est devenue mon « deuxième pays », et un filtre à travers lequel regarder le Royaume-Uni. Il est sain, intellectuellement (et même selon moi, nécessaire), de regarder son propre pays à travers le prisme d'une autre langue, culture, tradition intellectuelle. Je pense bien connaître la France, mais il me faudrait toute une vie pour en comprendre la politique. Que serait-il advenu si mes parents avaient été professeurs d'italien ? Peut-être aurais-je écrit La tortue de Dante.
Toute votre œuvre est traduite en France depuis vos débuts, vous y avez reçu plusieurs prix littéraires et décorations. Quel effet cela vous fait-il ?
C'est toujours encourageant de recevoir un prix, même si l'on n'écrit pas, et on ne devrait pas écrire, en s'y attendant. Pendant près de vingt-cinq ans, je n'ai reçu aucun prix dans mon propre pays. Un prix français fut comme une double récompense. C'est agréable d'en recevoir un dont on ne connaît même pas l'existence. Ainsi, en 2021, j'ai été ravi de gagner le prix Jean Bernard de l'Académie nationale de médecine pour mon livre L'Homme en rouge, à propos du gynécologue Samuel Pozzi.
Vous êtes lu et traduit dans le monde entier, adapté au cinéma. Dans quels pays plus particulièrement ?
Principalement des pays européens : la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas. En tout, j'ai été publié dans cinquante pays : le Monténégro vient de s'ajouter à la liste.
Diriez-vous, l'âge venu, que vous avez réussi ?
Selon mes attentes en 1980, à la publication de Metroland, oui, et même plutôt OUI !, au-delà de mes espérances. La réussite littéraire découle de travail, de talent, et de chance. Je sais qu'au fil des années, j'ai eu ma part de chance.
Comment jugez-vous votre premier roman, Metroland, paru en 1980 ?
Je relis rarement mes propres ouvrages, mais je reste attaché à Metroland car c'était le premier, il m'a donné la confiance d'en écrire d'autres.
Pourquoi, à vos débuts, avoir écrit des romans policiers, quatre aventures de Duffy le détective, mais sous le pseudonyme de Dan Kavanagh ? Et pourquoi n'avoir pas continué ?
Je lisais beaucoup de romans policiers dans mes jeunes années, et après avoir passé sept ans sur l'écriture de Metroland, j'ai écrit mon premier thriller en trois semaines. J'ai aimé ce processus, et j'ai écrit trois autres Dan Kavanagh. Mais un problème étrange et peu commun s'est posé : mes romans « littéraires » se vendaient bien mieux que mes polars. Ainsi, des livres tels que Le perroquet de Flaubert soutenaient mes romans policiers, plutôt que l'inverse. Cela semblait un peu paradoxal, c'est le moins qu'on puisse dire.
Dans Départ(s), vous présentez l'histoire d'amour loufoque de Stephen et Jean comme authentique. Qu'en est-il réellement ?
Moi seul le sais, et vous pouvez chercher la réponse (ou l'imaginer).
Jean est décédée, mais Stephen est-il toujours en vie ? A-t-il pu lire leur histoire, que vous aviez juré de ne pas écrire ?
C'est une très bonne question, et je ne connais pas la réponse. Peut-être dirais-je qu'il est mort avant la publication du livre. D'un autre côté, Stephen pourrait même apprécier « mon » livre, et peut-être écrira-t-il sa réponse quelque part...
Vous affirmez : « Ceci sera mon dernier livre. » Et vous signez à la fin des pages testamentaires. En êtes-vous sûr ?
Disons que si j'écris un autre livre, il faudra que son titre soit Non, je rigole. Ou peut-être, Oups, je me suis trompé. Quand j'ai commencé à écrire Départ(s), il y a cinq ans, j'avais à l'idée de simplement mettre en place mon « dernier livre » et qu'il soit vraisemblablement publié de manière posthume, lorsque mon heure viendrait. Mais d'habitude, lorsque j'écris un livre, plusieurs idées pour de prochains écrits se bousculent à la porte. Là, pas une seule, ou aucune que j'avais vraiment envie d'écrire. J'ai donc décidé de publier ce livre de mon vivant. De cette façon, je pourrai au moins lire mes nécrologies littéraires.
Vos lecteurs, bien sûr, espèrent que non. Il y a aussi ce journal, que vous tenez depuis plus de cinquante ans, et qui commence à occuper un espace considérable : 777 000 mots, 18 volumes (soit plus de 4,5 millions de signes). Comptez-vous le publier un jour ?
Pour l'instant, je pense interdire la publication de mon journal jusqu'à vingt ans après ma mort, car il serait ainsi lu de manière plus objective (et aussi, pour frustrer quelques personnes vivantes aujourd'hui qui souhaitent connaître tous mes secrets...).
Départ(s)
Stock
Traduit de l’anglais par Jean-Pierre Aoustin
Tirage: 10 000 ex.
Prix: 21,50 € ; 240 p.
ISBN: 9782234099210