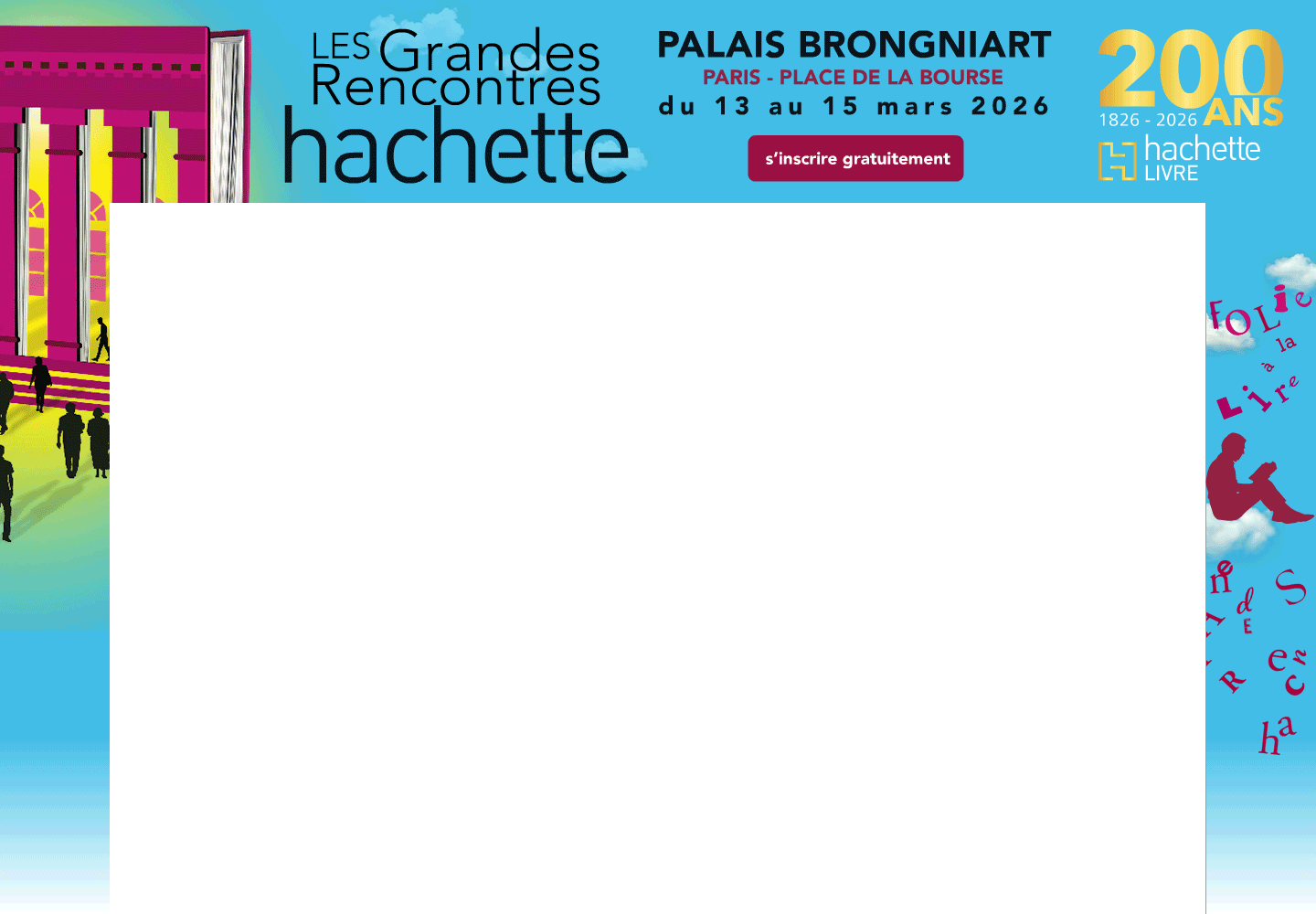Livres Hebdo - Contrairement à la grande majorité des écrivains catalans qui se penchent sur le passé de Barcelone, vous êtes l’un des seuls à mettre en scène vos personnages dans la ville des années 2000. Pourquoi ce choix ?
Eduardo Mendoza - Je trouve qu’il est très difficile d’écrire sur le passé. Il nous faut laisser du temps entre les événements et l’écriture de ces événements, laisser passer une certaine période. Moi, ce qui m’intéresse, c’est le présent. Décrire une réalité grâce à la fiction sans intervenir et sans la commenter. Le moment que l’on est en train de vivre à Barcelone, en Espagne et en Europe en général se caractérise par une chose : l’incertitude. On ne sait pas ce qui se passe, ni ce qui va se passer. On se demande s’il faut épargner, dépenser, investir… Je souhaitais faire une esquisse de ce que je voyais et de ce que j’entendais dans les transports publics, au marché, sur le trottoir, à la radio. De ce qui se passe réellement dans les rues de Barcelone. Le mélange de préoccupations et de solutions absurdes : par exemple, je voyais que dans mon quartier beaucoup de magasins fermaient, mais qu’on ouvrait en retour des tas de centres de méditation, de bien-être, de massages. Quelle relation y avait-il entre l’échec du commerce de proximité et cette espèce de recherche spirituelle ? Je voulais mettre ces deux données ensemble.
Vous faites partie de ces écrivains barcelonais qui écrivent en castillan et non en catalan. Pourquoi ce choix ?
Ce n’est pas une question de choix : du point de vue littéraire, on ne choisit pas la langue, c’est la langue qui nous choisit. Quand j’ai commencé à écrire, c’était normal pour moi d’écrire en espagnol, la langue que l’on parlait à la maison et à l’école. J’ai aussi écrit en catalan : du théâtre, des articles de presse. J’ai commencé à écrire un roman en catalan mais je n’ai pas continué car le roman a tellement de registres que, du point de vue de la langue, il est difficile pour quelqu’un qui n’appartient pas à la tradition littéraire catalane de le faire. J’appartiens à la littérature espagnole parce que j’écris en espagnol mais je me sens plus près d’écrivains catalans comme Josep Pla. C’est très difficile pour quelqu’un qui n’est pas d’ici de comprendre pourquoi le catalan existe. Comme si c’était une difficulté que l’on s’était créée. Ce n’est pas ça, c’est naturel. Barcelone est une ville bilingue. Elle fonctionne dans les deux langues : télé, presse, littérature, vie quotidienne, tout est en double. Pourquoi je ne pourrais pas l’être aussi ?
Vous ne vivez pas à Barcelone, mais vous y avez grandi, écrit et y revenez souvent. Qu’est-ce qui fait selon vous de cette ville un pôle littéraire ?
Avant d’être un pôle littéraire, c’est un pôle éditorial : la plupart des maisons d’édition en langue catalane évidemment, mais aussi en langue espagnole, qui publient pour l’Espagne et toute l’Amérique latine, sont encore basées à Barcelone. Les principaux agents littéraires aussi. Barcelone reste une capitale culturelle : dans un pays d’Amérique centrale par exemple, c’est difficile de trouver un cercle éditorial, de s’y faire un nom. Alors ceux qui peuvent s’établissent à Barcelone. Malgré tout, beaucoup de choses ont changé ces dernières années dans le milieu littéraire : il y a de très bonnes librairies, mais le réseau est de plus en plus concentré, il y a de plus en plus de maisons d’édition. Et Barcelone reste la référence du monde espagnol en matière d’édition de littérature, peut-être aussi parce qu’elle décerne les prix littéraires les plus importants du pays (1). < Propos recueillis par M. Mo.
(1) Selon la Generalitat de Catalunya, la Catalogne décernerait plus de 1 000 prix littéraires par an. Le plus connu est le prix Planeta, organisé par la maison d’édition éponyme et doté de 600 000 euros.