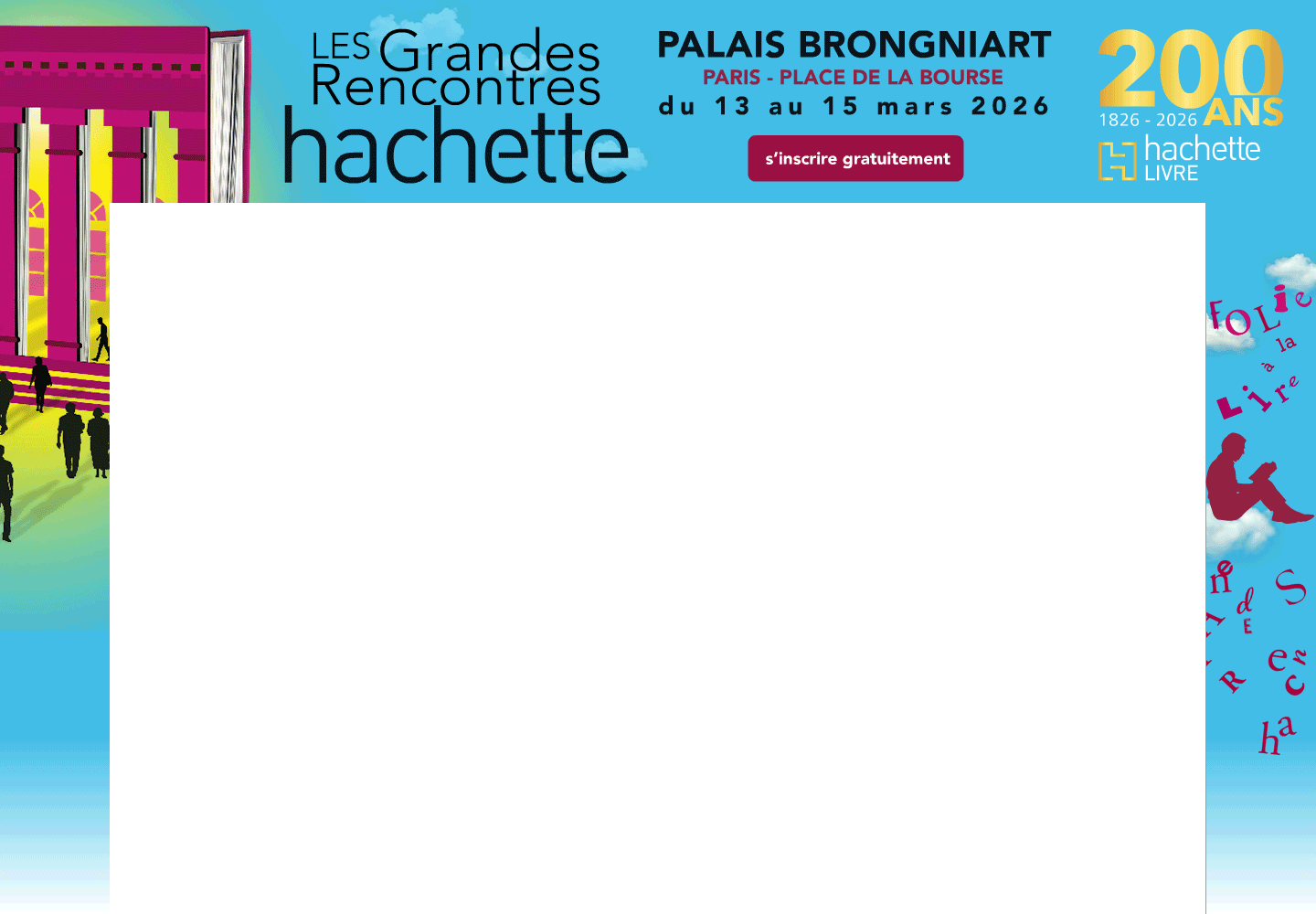Présente-t-on encore Dany Laferrière, né à Port-au-Prince en 1953 et arrivé à Montréal à l’âge de 23 ans ? Un prosateur que l’on a découvert en France à la fin des années 1980, quand Belfond publiait un livre aussi épatant que son titre, Comment faire l’amour avec un nègre sans se fatiguer. Cette figure importante de la francophonie a ensuite poursuivi sa route vaille que vaille, avec des volumes remarqués comme Cette grenade dans la main du jeune nègre est-elle une arme ou un fruit ? (1993), Chronique de la dérive douce (1994), Vers le sud (2006), adapté au cinéma par Laurent Cantet, ou encore L’énigme du retour (2009) qui a obtenu le prix Médicis. Depuis Zurich, où il réside actuellement, tandis qu’il s’apprêtait à donner un cours sur l’amour de la lecture à l’Ecole polytechnique, l’écrivain a répondu avec spontanéité à nos questions.
Livres Hebdo - Vous êtes cette année le président du prix du grand prix Livres Hebdo des Bibliothèques. Quels sont vos premiers souvenirs de bibliothèque ?
Dany Laferrière - Le mot « bibliothèque » sonne très fort chez moi. J’ai découvert la bibliothèque chez moi, à Petit-Goâve. Il y avait une étagère avec une dizaine de livres. Depuis, je me demande d’ailleurs combien il faut de livres pour composer une bibliothèque. Ma tante Renée, que j’ai mise dans mes livres parce qu’elle est à l’origine de ma passion des livres, était bibliothécaire. J’allais la retrouver, lui faire la conversation. Le fils du maire, médecin en France, avait envoyé des livres de sa collection personnelle. A 10 ans, j’étais féru de livres médicaux. C’était l’époque de Tel Quel, d’Henri Michaux. Ce n’était pas pour les enfants, mais je les lisais. On n’a pas besoin de comprendre pour lire. Puis j’allais m’asseoir sur la galerie avec tante Renée pour regarder les gens passer et tenter de connaître leurs pensées.
Quelle importance ce rôle de président du prix des Bibliothèques a-t-il pour vous ?
C’est important pour moi d’être attaché à un tel prix. J’aime lire dans une bibliothèque, c’est ce que je fais toujours, partout où je me trouve. Je ne sors jamais sans un livre dans la poche. C’est une image rassurante, quelqu’un qui a un livre à lire, il semble toujours plus disponible. Pour le prix, je m’apprête à rencontrer des gens qui ont goût à faire circuler les livres, à converser avec des lecteurs passionnés et à tenter de savoir où l’on en est, des deux côtés de l’Atlantique, sur la question de la bibliothèque. Je rappelle que rien n’est plus vivant qu’un écrivain mort. On n’a qu’à ouvrir son livre pour qu’il se mette à parler, et nous à l’écouter. Ma fille croit que ces auteurs conversent entre eux durant la nuit. C’est un lieu magique. Cette magie n’est possible que par le travail incessant du personnel de la bibliothèque. C’est ce travail que le prix tient à saluer.
Quelle pratique, en tant qu’écrivain et lecteur, avez-vous aujourd’hui des bibliothèques ?
J’y suis souvent invité à faire des lectures, à rencontrer des lecteurs. Avec la librairie, la bibliothèque me permet de prendre la température d’une ville. Dès que j’entre dans une bibliothèque, je sais ce que lisent les gens, cela me renseigne sur leur nature. J’aime aussi aller dans les cimetières pour voir si la ville est ouverte aux étrangers ! Comme écrivain, j’y suis souvent invité à faire des lectures. Et quand l’une d’elles se retrouve en danger, je monte aux barricades. Ce qui se passe de plus en plus, car on coupe volontiers dans leurs budgets. Il arrive qu’on ouvre aussi de nouvelles bibliothèques, et là aussi j’épaule. Comme celle de Limbé, une petite ville du nord d’Haïti, où l’on transporte les livres à dos de mulet pour faire bénéficier les communes avoisinantes.
Quelle différence voyez-vous entre les bibliothèques françaises et canadiennes ?
Quand la Grande Bibliothèque de Montréal allait s’ouvrir, j’ai demandé à la directrice, qui est aussi écrivaine, Lise Bissonnette, que les gens puissent y parler. J’avais peur du silence. Cette bibliothèque est située au-dessus du métro central de la ville (métro Berri-UQAM). C’est un point de convergence. Mes filles, quand elles sortent de l’école, y donnent rendez-vous à leurs amis. C’est un lieu très éclairé, pas du tout intimidant. Ce succès de la Grande Bibliothèque de Montréal est-il dû au fait qu’on a monté d’un cran l’intensité de la lumière et qu’on a permis un niveau de bruit raisonnable ? Je ne saurais le dire, mais je remarque qu’on se démène partout pour faire en sorte que la lecture devienne une chose naturelle. J’ai toujours plaisir, durant mes voyages en France, à observer la folle énergie que déploient les bibliothécaires pour rendre leur espace attrayant.
Le prix des Bibliothèques est pour la première fois ouvert à la francophonie. Comment vous situez-vous par rapport à cette question ?
Pour moi, c’est une chose naturelle. Les livres ne peuvent souffrir de frontière. Les bibliothèques doivent avoir des livres dans les langues nationales. Tout en gardant ce grand lien de la langue française. Ce serait dommage qu’on n’en fasse pas une famille. D’autant plus que le besoin de la bibliothèque se fait le plus sentir dans ces pays où le livre se fait rare. Je me souviens que les livres n’avaient pas toujours le temps de se reposer tant ils circulaient de main en main, portés par une rumeur louangeuse. Reconnaître l’importance de la bibliothèque dans certains pays, c’est protéger les livres des saccages qui ont lieu au moment des bouleversements politiques. La bibliothèque devient ce lieu nécessaire dans une ville survoltée. Combien de fois je me suis réfugié dans une bibliothèque pour échapper à la simple violence du soleil éclatant de midi ?
Votre nouveau livre, Journal d’un écrivain en pyjama, vient de paraître au Québec et sortira en France chez Grasset à la rentrée prochaine. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ?
Ce livre de 312 pages est sorti chez l’éditeur Mémoire d’encrier où j’avais déjà publié Tout bouge autour de moi. C’est une histoire de lecture et d’écriture. Je souffre d’insomnie et me réveille à trois heures du matin pour lire et écrire. Cela devient donc un moment excessivement intéressant. Les idées me viennent dans le calme, quand la ville est endormie. J’ai noté mes digressions, et cela a donné un livre. Une sorte de roman de la lecture et de l’écriture. Deux choses qui m’aident à voyager. Il n’y a rien de plus concret que d’être dans son lit en pyjama. Cela débouche sur une action, un mouvement. Dans mon cas : lire et écrire me permettent de voyager, car on invite de plus en plus les écrivains dans les festivals littéraires. Et c’est ainsi qu’on visite les bibliothèques. Journal d’un écrivain en pyjama regroupe des notes assez concrètes sur des questions qui nous intéressent, des analyses, des conseils, des rappels. J’explique par exemple que si cela fait deux heures que vous essayez de décrire la pluie, il suffit d’écrire : « Il pleut. » Je demande aussi aux éditeurs de faire un contrat aux mères d’écrivains, qui sont trop souvent sollicitées dans les premiers romans. Je propose qu’on mette en place une taxe d’écriture pour les écrivains qui dépensent si étourdiment dans leurs livres qu’on a l’impression qu’ils ignorent le prix des choses, qu’ils ne connaissent pas le prix d’un ticket de métro ou d’une baguette ! Je rappelle qu’écrire est d’abord une fête intime <