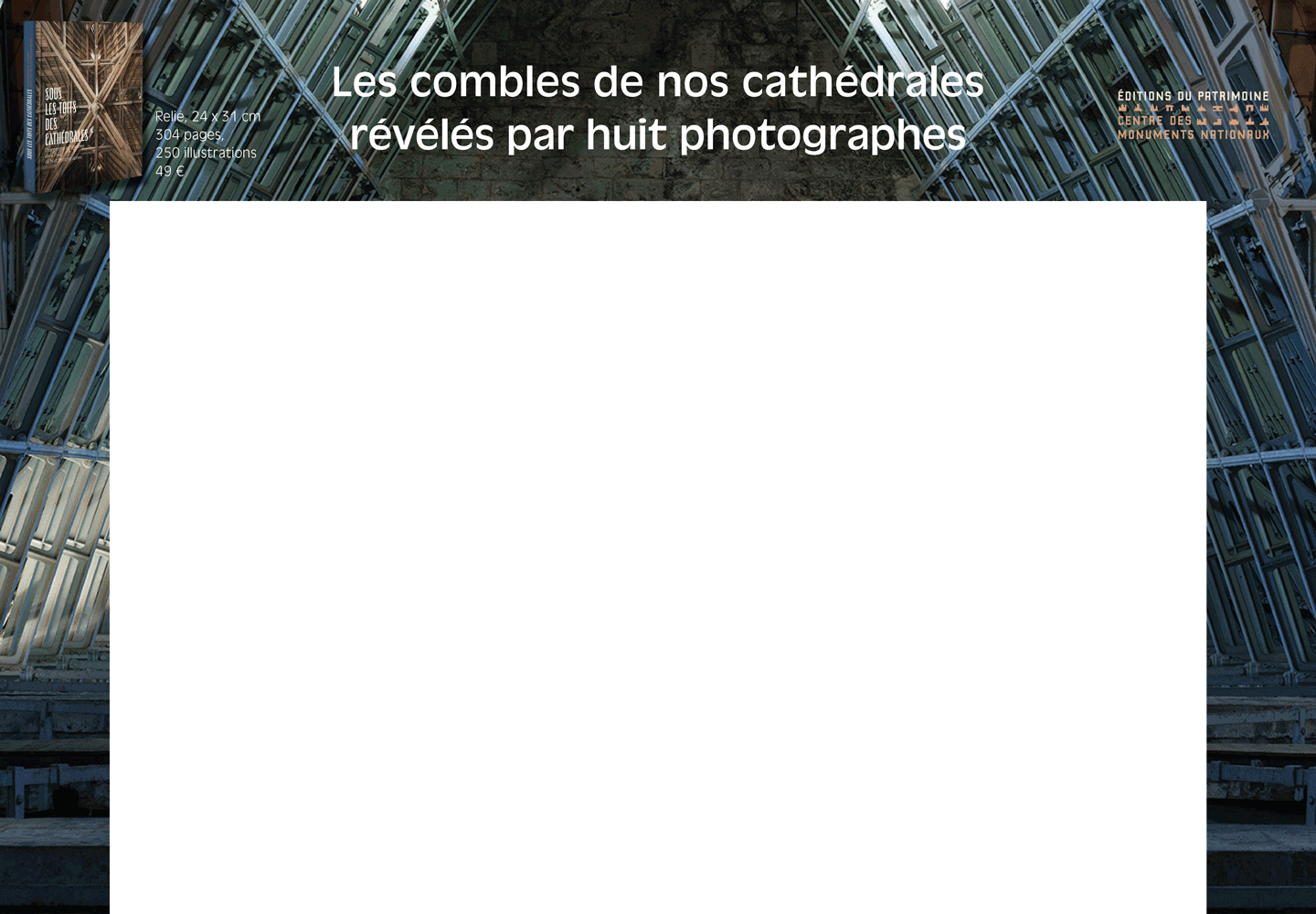Elle était jeune, belle, talentueuse, en colère, extrême. « Une grenade vivante, dégoupillée », dit d’elle César, son mari, le narrateur, qui l’a passionnément aimée. O ironie, elle se prénommait Paz. Elle était originaire de Gijon, dans les Asturies, cité ouvrière martyrisée par les nazis, durant la guerre d’Espagne, avec les bombes « économisées » à Guernica. Elle parlait français avec un accent espagnol prononcé. Elle était une photographe célèbre, rendant compte d’un monde barbare, celui des hommes, à qui elle préférait de loin la compagnie des requins, avec qui elle nageait en secret dans le Golfe. Et justement, c’est sur une plage de cette Arabie qu’on appelait autrefois « heureuse », que vient d’être retrouvé son corps sans vie, nu. Le mari est invité à se rendre sur place, afin de l’identifier. Une fois le choc passé, il entreprend, en mémorialiste, le récit de leur histoire, s’adressant à leur fils, Hector, conçu un soir d’orage à Venise, dans le ventre d’une baleine, œuvre du sculpteur Loris Gréaud, et à l’insu de Paz. Elle ne voulait pas d’enfant, leur préférant les squales, et avait dit cruellement à César : « Tu seras un mauvais père. » C’était faux, et il est passé outre. Mais c’est à partir de là que leur couple a pris l’eau, qu’est venu le temps du désamour, et que Paz, au moment même où son travail recevait une reconnaissance internationale, s’est sentie étouffer. Elle a pris la tangente, rejoignant à Abu Nawas le requin Nour, qu’elle avait « adopté », ainsi qu’un certain Marin, moniteur de plongée, dont César sera férocement jaloux.
Tout ceci, il le découvrira après coup, au cours de l’enquête minutieuse qu’il mène sur Paz, sa femme, mais aussi une femme qu’il ne connaissait pas réellement, et les circonstances de sa mort. Auparavant, ils ont vécu deux ans de bonheur, à sillonner la planète, de festival en hôtel de rêve et haut lieu culturel - César est responsable culture dans un grand hebdomadaire parisien -, préparant un ouvrage commun consacré au déclin de l’Occident, qui devait s’appeler Le livre de ce qui va disparaître.
Cela faisait six ans, depuis Birmane et son prix Interallié (Plon, 2007), que Christophe Ono-dit-Biot n’avait pas publié de roman. Il a pris son temps, vécu des expériences fondamentales, comme la paternité, et acquis de la maturité. Plonger est un livre plus maîtrisé que ses précédents, plus grave. Plus ambitieux aussi. Par-delà l’intrigue et les personnages, nourris d’éléments autobiographiques, le projet est plus global : tenter de décrire le monde contemporain, dans toute sa violence. César, par exemple, est hanté par les catastrophes, le tsunami de 2004 en Asie, le terrorisme islamiste, la guerre civile qui fait rage en Syrie depuis plus de deux ans. En dépit de sa brillante réussite professionnelle, c’est un bobo occidental mal dans sa peau, mal dans son époque et totalement pessimiste quant à l’avenir. Comme Paz, le lecteur étouffe parfois en cours de route, débordé sous les voyages, les références, le name-dropping. Il apprécie la performance de l’écrivain adulte, tout en conservant une pointe de nostalgie pour ses « royaumes farfelus » d’avant.
J.-C. P.