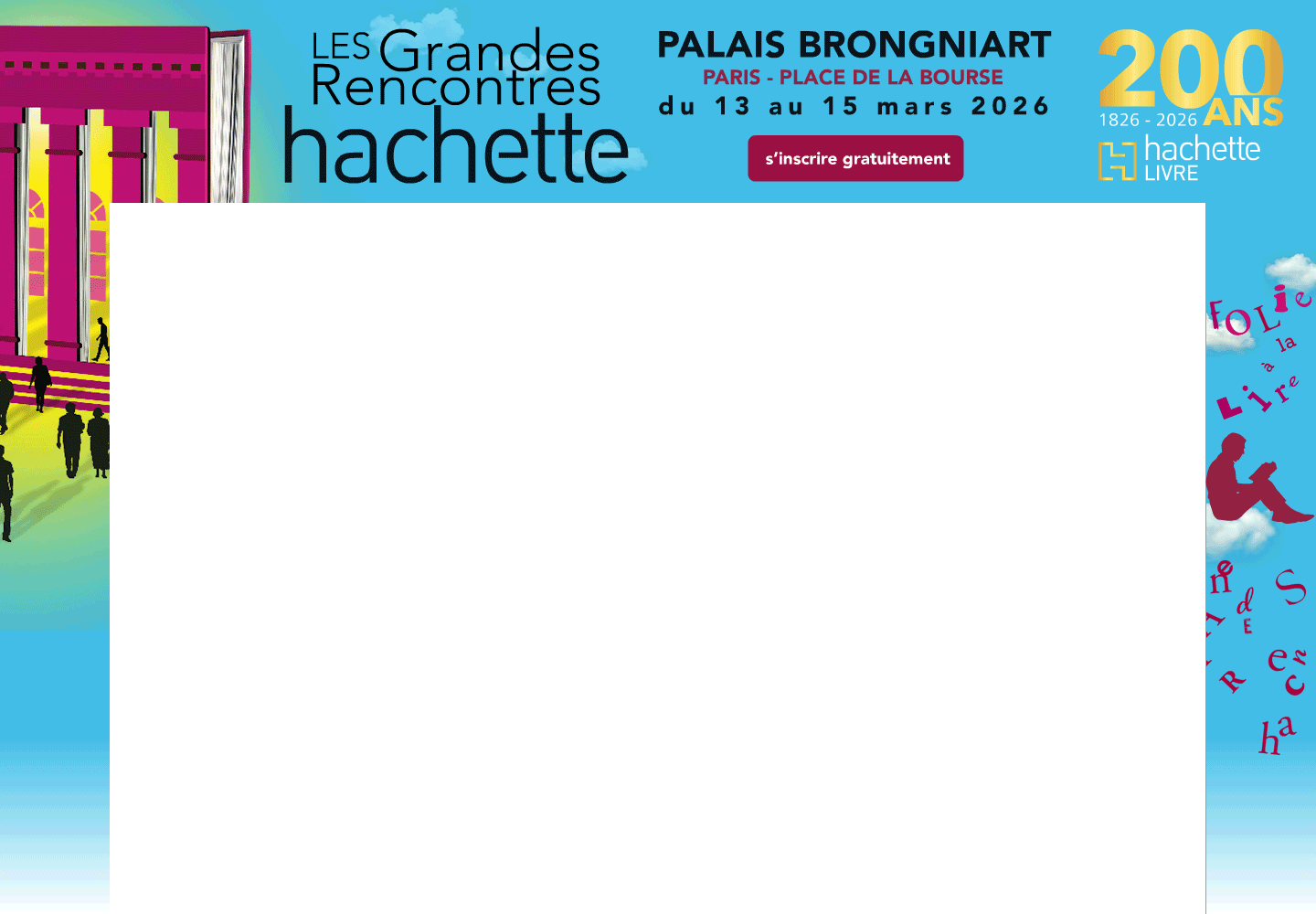Livres Hebdo : Comment êtes-vous venue à l'édition ?
Anne-Marie Métailié : Je suis devenue éditeur grâce à Jérôme Lindon. Il me terrifiait mais quand il parlait de son travail, il était intarissable et évoquait ses auteurs avec passion. J'avais fait de la sociologie et je me disais que son métier avait l'air merveilleux. J'ai foncé. Cela n'a pas été facile, mais c'était exaltant.
Je me suis formée sur le tas. Cela m'a pris une dizaine d'années. Au début des années 1980, les sciences humaines déclinant rapidement, j'ai trouvé plus drôle de publier de la littérature. Faire lire des auteurs d'horizons, de sensibilités et d'imaginaires différents est essentiel.
Quarante ans après la création de votre maison, quel bilan faites-vous ?
A.-M. M. :Je me suis amusée. Quand j'ai commencé il y a quarante ans, il n'y avait que deux femmes, Régine Deforges et moi. L'édition est un secteur qui connaît une grande mortalité infantile. Quand j'ai commencé, Jérôme Lindon m'avait dit : « Si vous passez la sixième année, ça ira. »
Au bout de dix ans, le Seuil est entré dans le capital. Vous traversiez votre première tempête ?
A.-M. M. : En quarante ans, je n'ai jamais déposé le bilan. Le Seuil est entré au capital en 1990, et en possède 85 % - j'ai les 15 % restants. En contrepartie, je lui ai confié ma diffusion.
Comment avez-vous constitué le catalogue ?
A.-M. M. : Je parle portugais et espagnol. Dans les années 1980, de grands auteurs lusophones avec des points de vue politiques différents ont émergé comme António Lobo Antunes, José Saramago, Lídia Jorge. Le même mouvement a eu lieu dans les années 1990 avec une nouvelle génération d'écrivains latino-américains, dont Luis Sepúlveda, qui réalise nos plus grosses ventes (4 millions de volumes, poches compris). Nos auteurs étrangers ont l'âge de la maturité littéraire : ils produisent beaucoup, et de grandes œuvres.
L'intérêt de ce travail est aussi de dénicher des inconnus, qu'on contribue à faire découvrir et qu'on suit pour qu'ils puissent grandir. Depuis 2010, l'éditrice Lise Belperron m'assiste. C'est une lectrice formidable, qui parle plusieurs langues, une dénicheuse de talents qui a découvert le Nigérian Leye Adenle et l'Indienne Shubhangi Swarup.
Si la littérature étrangère a acquis une certaine reconnaissance, elle se vend moins bien en librairie depuis deux ou trois ans. Qu'en pensez-vous ?
A.-M. M. : Je n'en suis pas convaincue. Depuis 1979, j'entends mes confrères se plaindre, évoquer la crise. Mais quand je discute avec mes confrères d'Amérique du Sud, ils trouvent que la France est un paradis grâce au prix unique et à la TVA à 5,5 %.
Après une année 2017 formidable avec le succès de La daronne d'Hannelore Cayre, le début de 2018 a été un cauchemar, mais le deuxième semestre a été bon. 2019 est l'année des 40 ans et nous espérons que les retombées médiatiques vont nous permettre de vendre davantage de livres.
Le problème est que le fonds baisse, même s'il reste autour de 20 à 25 %, et n'est plus travaillé en librairie. Désormais, on obtient une bonne mise en place pour un premier roman d'un inconnu, mais c'est la croix et la bannière pour un auteur confirmé. On souhaite une meilleure mise en place pour le dernier roman de Leonardo Padura, par exemple, que celle de son livre précédent, qui était un recueil de contes. Scintillation de John Burnside est un livre formidable : on pouvait espérer 10 000 ventes et on en a eu 2 000.
Comment affrontez-vous la concurrence pour obtenir les droits étrangers ?
A.-M. M. : Le marché français est dominé par les Anglo-Saxons, mais nous restons à la marge avec les Ecossais ou les Africains de langue anglaise. Je ne participe jamais à des enchères, je n'en ai pas les moyens. Si on achète le texte trop cher, on ne s'en sort pas car il faut ajouter les frais de traduction, qui sont élevés.
Je suis paranoïaque et je ne traduis que les langues que je peux lire. Pour le reste, je m'appuie sur les directeurs de collection : Nicole Bary pour la langue allemande, Keith Dixon pour l'Ecosse et Serge Quadruppani pour l'Italie, et Pierre Léglise-Costa pour le Portugal. Mais le Brésil, c'est moi.
Les contrats se signent aussi pour des périodes plus courtes.
A.-M. M. : Ils portent sur huit ans à partir de la signature, or il faut compter deux ans pour la traduction. Il faut donc les renouveler. Avant tout, je publie des auteurs, et j'ai le syndrome des œuvres complètes. Je suis l'éditeur de Luis Sepúlveda depuis 1992, de Christoph Hein depuis 1997, de Leonardo Padura depuis 1998, de James Kelman depuis 1999, et d'Arnaldur Indridason depuis 2005.
Quels sont vos liens avec les auteurs et les traducteurs ?
A.-M. M. : Nous formons une famille avec nos auteurs. En déplacement, on reste ensemble, on mange ensemble, on danse ensemble. Parallèlement, nous essayons de faire des mariages, de trouver le traducteur qui a « l'oreille du texte », qui soit le plus près possible de la musique de l'auteur. Je me vois comme la Célestine du théâtre espagnol, l'entremetteuse, qui se place entre l'auteur et le lecteur qui vont s'aimer. Je les mets en rapport et je touche de l'argent au passage.
Quelle reconnaissance la maison a-t-elle acquise ?
A.-M. M. : La littérature étrangère suscite davantage d'intérêt de la part des médias qu'autrefois. Avec l'âge, nous avons acquis un certain statut, nous sommes connus des journalistes et des libraires. Mais c'est un travail sans cesse renouvelé. Lise Detrigne, qui travaille dans la maison depuis vingt ans, est chargée des relations libraires et des réseaux sociaux, organise des rencontres avec les youtubeurs et les lecteurs Babelio. Nous essayons de faire tout ce qu'il faut faire.
Quels sont vos rapports avec les prix littéraires ?
A.-M. M. : Nous ne sommes pas encore une maison institutionnalisée. Nous nous appuyons beaucoup sur les libraires et nous avons tenu le coup grâce à eux.
En quarante ans, nos livres ont reçu de nombreux prix des lecteurs. Ils sont souvent sélectionnés par les grands prix mais ils arrivent toujours en deuxième position, la pire qui soit. En même temps,nous ne publions que des métèques et des langues qui ne sont pas à la mode. On m'a dit qu'il fallait des livres consensuels, or nous pratiquons un certain mauvais esprit. Le jour où j'ai réussi à être copine avec deux jurées du Femina, elles ont démissionné.
Vous reconnaissez-vous des affinités avec vos confrères ?
A.-M. M. : En France, j'aimais bien Paul Otchakovski-Laurens et je m'entends bien avec Joëlle Losfeld et Liana Levi. C'est à la fois une question de génération, de date de naissance de la maison et de taille. Nous avons aussi constitué une famille avec les éditeurs étrangers, autour des auteurs que nous avons en commun comme Luis Sepúlveda. Ses éditeurs figurent sur la photo que j'ai collée sur le mur : il y a, entre autres, Luigi Brioschi de Guanda (groupe Mauri Spagnol), Manuel Valente des éditions Porto, Beatriz de Moura de Tusquets, Michael Krüger de Carl Hanser.