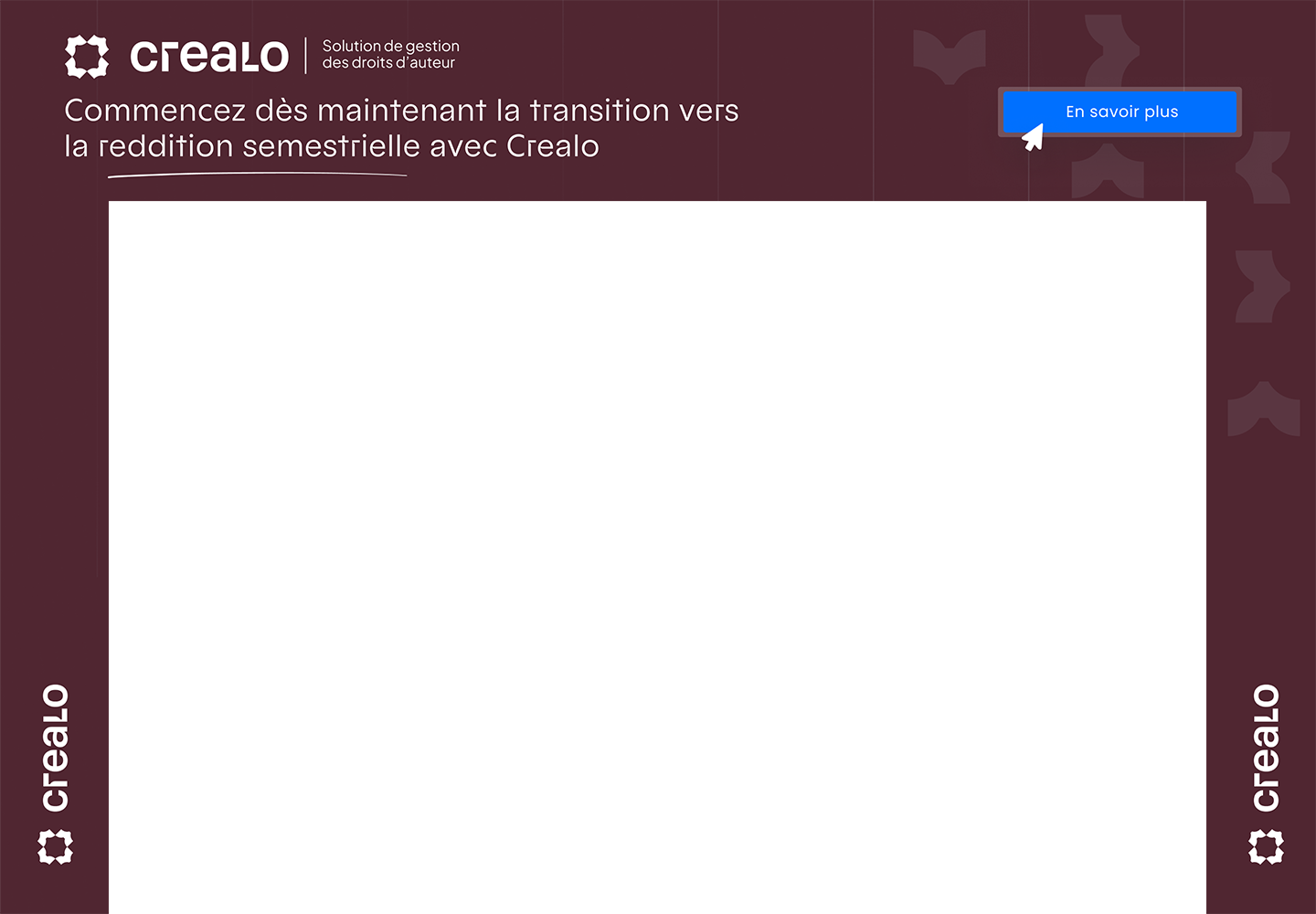Il va falloir se le dire : il se passe quelque chose en Islande. Non content d’être le seul Etat au monde à avoir eu le culot salvateur de se mettre en faillite en 2008 et de traîner en justice les banquiers qui avaient vidé la banque, et non content d’être capable de paralyser d’un coup l’ensemble du trafic aérien avec un poisson d’avril en forme de nuage de cendres en 2010, il semblerait que la grosse île ait décidé d’avoir en plus une littérature florissante. Et l’on ne parle pas ici des trépidantes enquêtes d’Arnaldur Indridason, ni du vénérable Gudbergur Bergsson dont Métaillié a traduit l’excellent Deuil il y a quelques mois. Non, il s’agit du premier roman d’un jeune thésard répondant au nom sonore de Bergsveinn Birgisson. Un court texte de 130 pages. Un roman épistolaire. Une lettre d’amour. Rien que ça.
Un vieil homme prend la plume pour écrire à Helga, avec qui il a partagé du temps de leur jeunesse un adultère foudroyant. Dans leur petit hameau perdu loin de toute civilisation (car ils sont l’un et l’autre éleveurs de moutons, en 1939, alors que les premiers tracteurs viennent de faire leur apparition), ils s’aimeront sur la paille de l’étable, juste assez fort pour qu’elle tombe enceinte et qu’il ne s’en remette jamais. Elle lui propose de partir pour Reykjavik, il refuse, trop attaché à sa terre ancestrale. Elle part sans lui. Il est malheureux. Il ne le lui avouera que quarante ans plus tard, une fois son épouse descendue dans la tombe : ce sera La lettre à Helga.
Et c’est à lire : pour la langue fleurie du vieillard, volontiers lyrique, à qui Helga répond : « Ne viens pas me servir tes foutus vers de mirliton sur la putain de terre natale » ; pour la narration enlevée et drôle, qui nous entraîne dans les fjords mystérieux et nous raconte des histoires de béliers difformes et de cadavres fumés en attendant le dégel. Il faut lire ce roman parce que le désir y est dit avec des mots vrais, et que c’est autre chose que cent cinquante nuances de graisse. Et parce que Birgisson nous offre un tableau fin des métamorphoses de l’Islande, dans laquelle l’immense nature palpite partout. La force de l’écrivain se révèle à chacune des phrases rythmées, à chaque considération sur le temps ou la ville, aussi bien lorsque le vieillard décrit son amour pour son tracteur et son bélier que quand il convoque à mots couverts, pour justifier ses décisions douloureuses, Kierkegaard et Le mythe de Sisyphe(« C’est de la pure connerie. […] C’était dans la nature humaine de transbahuter des pierres sur les hauteurs […] en un beau cairn qui servirait de point de repère »). On est ému, on rit, on réfléchit. On découvre un monde en dix-huit courts chapitres, dans une traduction virtuose. Il se passe quelque chose de neuf en terre islandaise. Fanny Taillandier