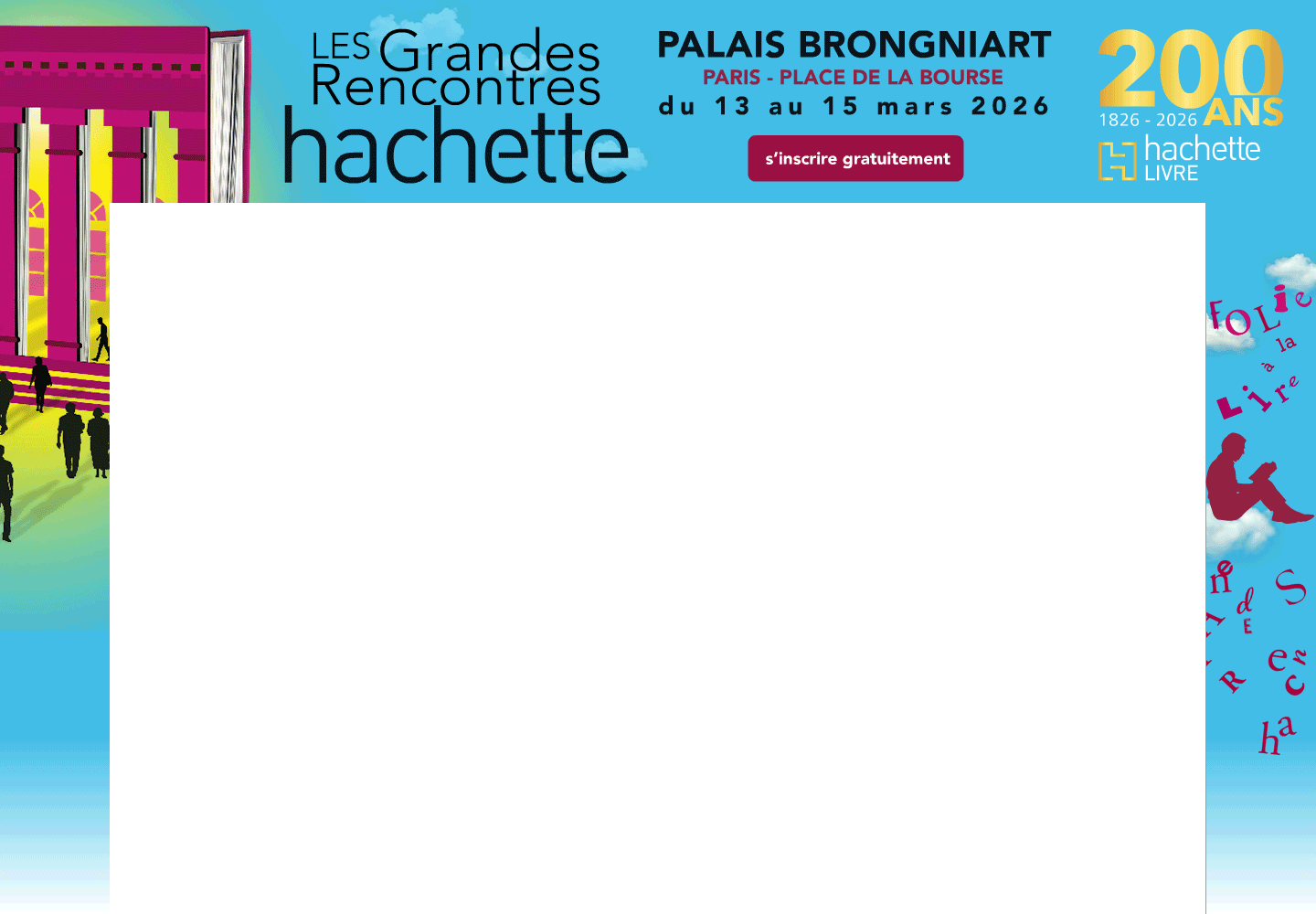Le problème avec le mal, c’est que personne ne reconnaît jamais vraiment en être l’architecte. Ce fut vrai de Barbie, ce fut vrai d’Eichmann, de tant d’autres. Pas de regrets, mais une minoration du rôle, une posture de soldat n’ayant fait que son devoir et dont le seul tort serait d’avoir obéi à des ordres dévoyés. En ce sens, Josef Mengele, la figure peut-être la plus terrifiante surgie de cette nuit et de ces années de cendre, est un cas d’école. Ce médecin, s’étant servi d’Auschwitz pour y mener sur les déportés des "expérimentations" aussi hasardeuses qu’atroces, était et demeura sa vie durant un nazi. Pas le plus idéologiquement fervent, toutefois. Ecrivons que le IIIe Reich, puis l’espérance d’un quatrième, correspondait chez lui à une conviction sans faille, mais qui lui permettait de donner libre cours, en parallèle, à ses supposés "talents" scientifiques et plus tard à son goût des affaires. Considéré dans l’immédiat après-guerre par les libérateurs comme quantité à peu près négligeable au sein de la nomenclature nazie, virtuose tout de même des alias et des vies réinventées, Mengele s’embarque à Gênes en 1949 pour Buenos Aires afin d’y rejoindre la petite colonie vipérine allemande qui s’établit alors sur le sous-continent avec l’assentiment plus ou moins tacite du général Perón d’abord, puis de toutes les juntes militaires qui ne tardèrent pas à y prospérer. Durant trente ans, "l’ange de la mort d’Auschwitz", d’abord anonyme, puis sous une théorie d’identités d’emprunt, poursuivi par Simon Wiesenthal et bientôt Israël et la République fédérale allemande (avec un zèle inégal, il est vrai), échappera à son destin, à la justice, jusqu’à trouver la mort, libre et noyé dans un fleuve brésilien…
C’est cette histoire, ces trois décennies où, si Mengele fuit, c’est moins sa mémoire, le souvenir des suppliciés, que ses poursuivants, que nous narre dans un récit qui s’autorise les armes du romanesque Olivier Guez. Journaliste, romancier (le merveilleux Les révolutions de Jacques Koskas, Belfond, 2014), essayiste (L’impossible retour, une histoire des juifs en Allemagne depuis 1945, Flammarion, 2007), scénariste, voyageur impénitent, passeur, entre le monde juif, l’Allemagne et le Brésil notamment, Guez mène son affaire tambour battant. Ce livre est en quelque sorte "embedded" au cœur (et au sexe, et dans l’esprit) de la bête. Ce genre de licence n’est acceptable que si elle s’accompagne d’une enquête au sérieux irréprochable ; ce qui est évidemment le cas. Il s’agit moins ici de montrer. Montrer un homme (car c’en était un, c’est bien le hic) dont ce qui doit être retenu est moins la cruauté, ou l’affligeante banalité du mal, que la médiocrité. Une médiocrité en quelque sorte, flamboyante. Avec, en "motif caché dans le tapis" de cette fable véridique et plus morale qu’elle n’en a l’air, un satané désir de justice qui ne veut pas s’éteindre. Au fond, La disparition de Josef Mengele est un roman de genre, un récit gothique où des vampires, surgis du fond des âges, font un dernier tour de piste dans les décors splendides de la modernité latine des années 1960-1970. C’est très beau. Cela fait très peur. O. M.