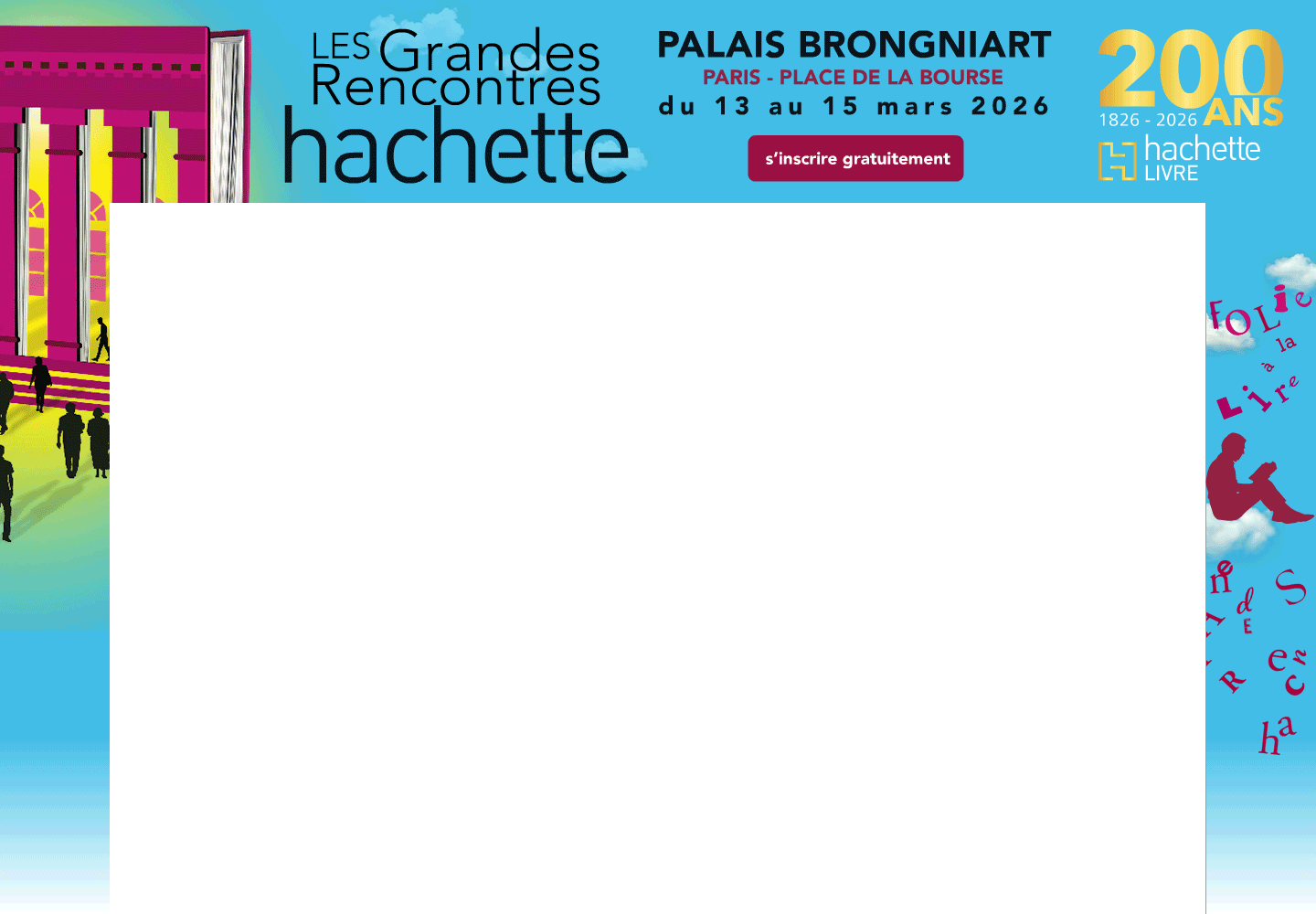Pour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.
Simon Sagalovitsch, troisième. Avec Un juif en cavale, Laurent Sagalovitsch clôt la trilogie délicieusement foutraque entamée du côté de Vancouver (Loin de quoi ?, Actes Sud, 2005) et poursuivie dans les rues d'un Paris honni (La métaphysique du hors-jeu, Actes Sud, 2011). Cette fois-ci, on retrouve le presque homonyme de l'auteur sur sa terre fallacieusement promise, dans un Tel-Aviv qui tient assez d'un pandémonium fascinant et qui serait à Israël ce que Los Angeles est à l'Amérique, ou Biarritz au Pays basque : une exagération. Simon n'a pas changé ("C'est bien simple, je connaissais deux choses dans la vie : le football et les différences de composition et de durée d'action du Xanax, du Valium, du Lexomil et du Témesta"), peut-être juste un peu vieilli. En douce. Flanqué de la belle Batave et joliment érotomane Monika, il finira, malgré sa propension naturelle au désastre, par se laisser prendre dans les rets de la dolce vita de "la ville qui ne dort jamais". Installé dans le quartier arabe de Jaffa, veillé par un logeur sarcastique et volontiers attendri nommé Moncef, embauché par Juan, mauvais garçon et bon génie, pour entraîner une modeste mais ambitieuse équipe de football, Simon, sans rien renier de son instabilité fondatrice, fait enfin l'expérience d'une "judéité au quotidien", inscrite dans la vie, et cela lui va bien au teint, plages et soleil de Tel Aviv obligent... Ce Juif en cavale a fini de courir.
Comment Sagalovitsch, à l'avenir, pourra-t-il se passer de Sagalovitsch, l'auteur de son alter ego romanesque ? Même s'il n'est pas nécessaire d'en avoir lu les deux premiers volets pour en apprécier toute la verve comique et désespérée, ce tome tient bien du bouquet final. Dans une langue comme emballée, ivre d'elle-même, qui dans ses meilleurs moments rappelle la démesure d'un Mordecai Richler, le romancier offre en contrebande une réflexion âpre et douloureuse sur la fortune et l'infortune qu'il y aurait à être né juif. La difficulté, aussi, de le rester.