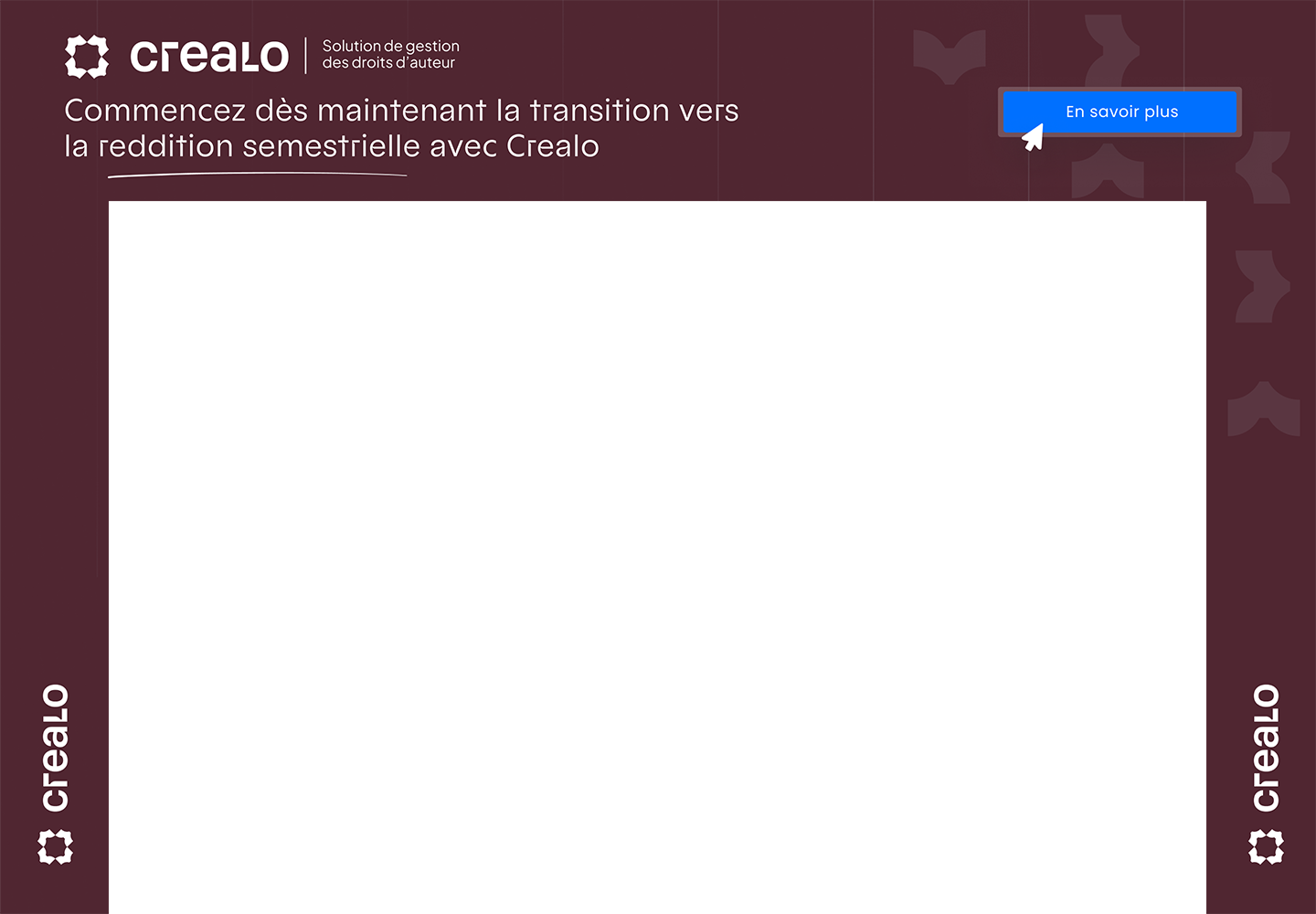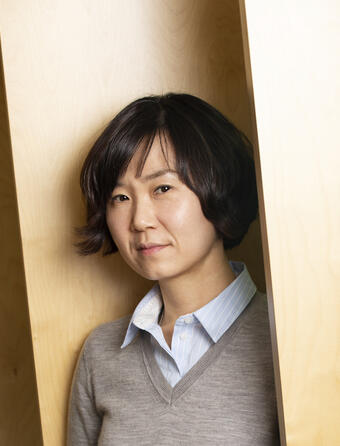Livres Hebdo : Votre nouveau roman raconte le retour d’un homme après trente ans d’absence vers le lieu de son enfance, le bastion familial qu’il honnit, mais votre personnage est l’inverse du fils prodigue…
Stéphanie Chaillou : C’est une bonne image. Jean-Noël ne revient pas pour se faire pardonner. Ni demander réparation, encore faudrait-il savoir quelle faute a été commise afin qu’elle puisse être réparée. Ce roman explore les différentes raisons pour lesquelles le personnage retourne dans sa famille à Bazas, en Gironde, alors qu’il l’avait quittée à l’âge de 18 ans. Revient-il pour recouvrir cette histoire par une nouvelle histoire qui commencerait ? Ou au contraire vérifier ce qui a été, c’est-à-dire affronter la réalité de ce qui s’est passé ?
Ce que le protagoniste a quitté il y a trente ans, c’est surtout un milieu social à l’opposé de ce qu’il est.
Un jour, son frère aîné appelle Jean-Noël pour lui dire que leur père est très malade. Alors qu’il avait coupé les ponts, sans réellement comprendre ce qui le pousse à retourner sur les lieux de son enfance, il prend la route. Dans son milieu d’origine il s’est toujours senti différent, à l’école, chez lui… Ce livre traite de la singularité – de la différence qui entraîne l’exclusion.
C’est que Jean-Noël par rapport aux autres apparaît comme fragile, on le traite d’efféminé, il se révélera homosexuel…
Nous sommes dans les années 1970, en province, avec un poids de la norme sociale écrasant, des typologies genrées très marquées – les hommes doivent ressembler à des hommes des « vrais », les femmes à des femmes, cantonnées à des rôles d’épouse et de mère. Jean-Noël quant à lui ne trouve pas sa place, son identité ne correspond pas au milieu où il évolue. Mais il ne s’agissait pas pour moi de parler d’homosexualité en milieu rural dans ses années-là mais bien de parler d’aliénation et également de ce mystère d’avoir quelqu’un qui n’a rien à voir avec le reste de sa famille.
« C'est dans les brisures que se dessine une personnalité »
Jean-Noël est un esthète, il ne s’inscrit pas dans les valeurs matérialistes de ses parents qui sont des commerçants attachés aux signes extérieurs de réussite sociale. C’est curieux la structure psychique des individus qui se distinguent malgré le contexte familial, leur environnement culturel. J’ai cette image d’un objet en verre qui se casse mais dont on ne sait pas quelles formes prendront ses éclats. C'est dans les brisures que se dessine une personnalité.
Il y a dans ce roman un drame jamais nommé, irrésolu, mais qui a eu lieu. Est-ce à partir de cet événement que vous avez imaginé construire votre intrigue ?
Au départ, j’avais une situation présente, très concrète : un homme dans une chambre d’hôtel, indécis, entre immobilité et envie de fuir. Pourquoi est-il revenu ? Que s’est-il passé trente ans plus tôt ? J’invente tout au fur et à mesure. Mes chapitres sont courts, ce sont des scènes, des unités de temps et de lieu, qui tour à tour font avancer l’action, ou, sans être de pure atmosphère, étoffent la matière des personnages. Tout s’élabore à partir d’impressions. Par exemple, Bazas où se déroule le roman, je n’y suis allée qu’une seule fois mais j’ai eu un coup de cœur inexpliqué pour l’endroit, j’ai adoré cette ville – sa minéralité, sa cathédrale. Contrairement à mon roman précédent qui se passe en partie à Noirmoutier que je connais bien et dont je voulais restituer des souvenirs précis, ici le pari a été de traduire toutes les impressions de cette mémoire flash.
Votre écriture, à la fois très exacte et elliptique, est ourlée de mystère. Pourquoi cette bête qui observe Jean-Noël ?
La bête est une contrainte formelle que je me suis donnée. Dans Le goût de la trahison (Notabilia, 2024), j’avais des intertitres, dans Revenir à Marimbault, j’ai voulu que la contrainte s’incarne dans le récit même. L’animal sauvage qui regarde Jean-Noël est à la fois la figure de l’intrus, tel le double de Jean-Noël qui a été un intrus dans sa propre famille, et la figure du témoin : seule la bête atteste l’existence du héros. Regarder quelqu’un c’est le reconnaître. Jean-Noël a grandi sans un regard. Comment se construit-on quand on n’a pas été vu ?
Finalement, ce retour n’a été que le constat de ce que ce fils et frère mal aimé savait déjà, un peu comme dans la pièce de Jean-Luc Lagarce, Juste la fin du monde.
Oui, c’est le redoublement d’un constat, une dernière vérification. Un consentement à ce qui a été. C’est difficile comme l’énonce bien le philosophe Clément Rosset que je cite en exergue du livre : « Ce qui est cruel dans le réel est en quelque sorte double : d’une part d’être cruel et d’autre part d’être réel. »