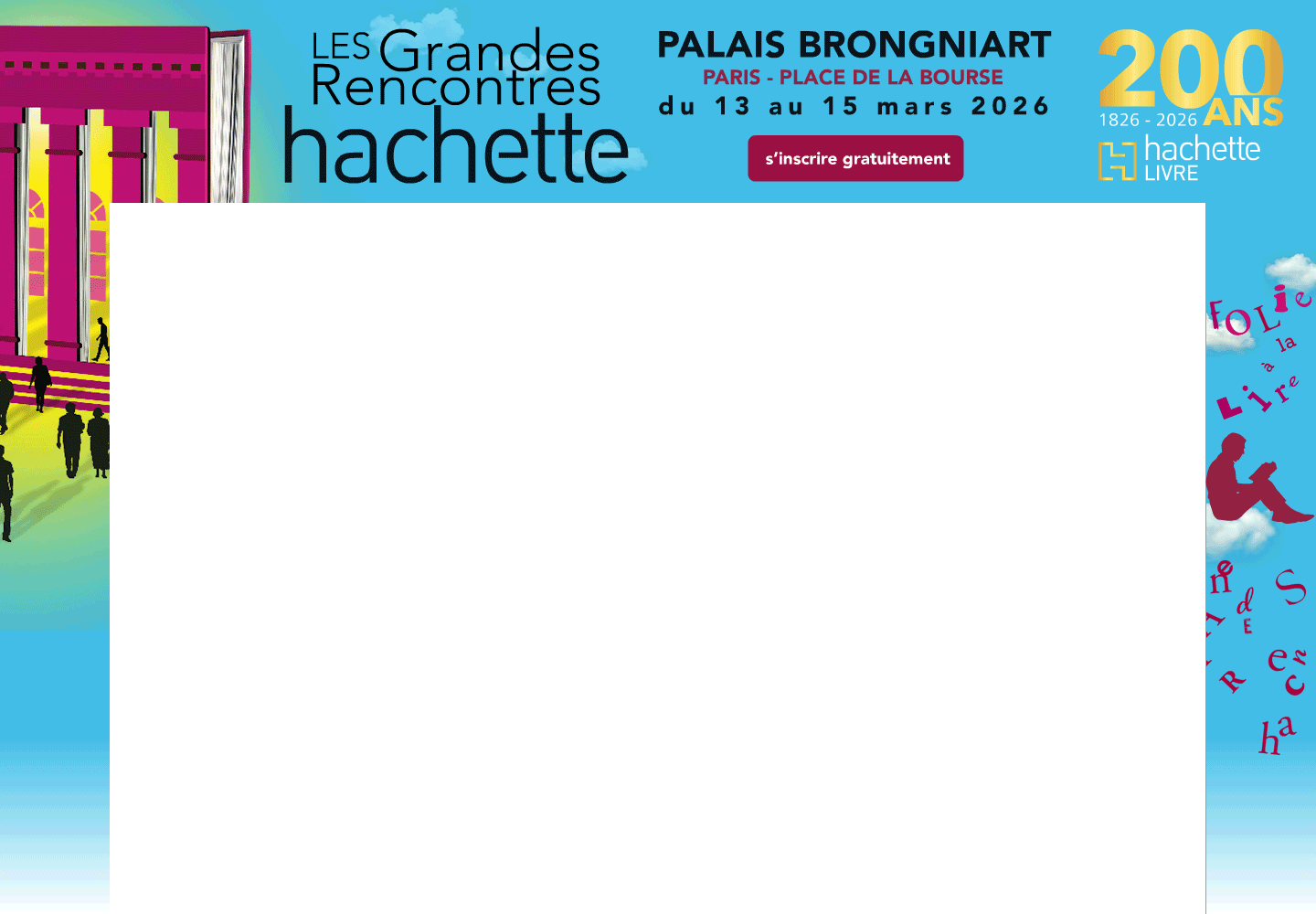Edvard Munch (1863-1944) c’est pour beaucoup l’iconique Cri – une tête hurlante sur fond de ciel rouge, crépusculaire, aux nuages ondoyants. Mais l’art du Norvégien auquel le musée d’Orsay dédie sa grande exposition d’automne ne saurait se résumer à ce seul tableau. Aussi l’exposition « Munch : Un poème de vie, d’amour et de mort », au-delà d’un simple parcours chronologique, fait-elle miroiter les subtiles facettes d’une œuvre aux variations multiples et aux motifs obsédants.
Réalisme dans sa jeunesse bohème à Kristiania (ancien nom de la capitale, aujourd’hui Oslo) sous influence du géant de la littérature moderne norvégienne Ibsen, symbolisme notamment à la suite de ses séjours parisiens au tournant des années 1880-1890, expressionnisme lorsqu’il fréquente le Zum schwartzen Ferkel (« Au Porcelet noir »), café de Berlin où se réunissaient nombre d’écrivains et d’artistes nordiques à la fin du XIXe siècle, dont le dramaturge suédois August Strindberg… Aplats de couleurs franches, touches à l’énergie fauve, ténèbres profondes de l’encre, quelque manière qu’il adopte pour décliner les thèmes qui le hantent depuis l’enfance, Munch peint avec ce même style tendu, trompeusement hiératique, mélange de fiévreuse inquiétude et de froide angoisse. Orphelin de mère à cinq ans, ce fils d’un médecin militaire à la foi rigoriste, fréquente depuis son plus jeune âge la maladie et la mort, il perd sa sœur âgée de quinze des suites de la tuberculose. Un événement que figure un tableau, L’enfant malade (1896).
Jeunes filles sur le pontPour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.
Trois publications
Ses lectures de Nietzsche comme sa vie amoureuse, sa mélancolie ont nourri sa palette et innervé son pinceau. Reviennent dans l’œuvre peinte ou gravée tels des spectres la figure qui crie son mal être (Tête du « Cri » et mains levées, crayon sur papier vélin, 1898) ; la femme au baiser cannibale (Vampire, 1895), l’homme rongé par la jalousie, le couple aliéné (Deux êtres humains. Les solitaires, 1906-1907), des Jeunes filles sur le pont (1927), son autoportrait fumant une cigarette ou au bras de squelette (1895) ou après une nuit blanche (1920). Paysage de fjords rougeoyants, rue grouillante d’anxiété urbaine ou huis-clos asphyxiant, campagne imbue d’une nostalgie d’un au-delà du réel… les toiles dégagent une lumière mystérieuse. L’un des premiers critiques du travail de Munch et ami, l’écrivain polonais Stanislas Przybyszewski, qualifie son art de « naturalisme mental ». Car il s’agit bien pour le peintre de la Frise de la vie, cycle composé de 22 tableaux et présenté à la Sécession de Berlin en 1902, d’exprimer la vérité des choses de l’intérieur : « Nous voulons autre chose que la simple photographie de la nature. Nous ne voulons pas non plus peindre de jolis tableaux à accrocher aux murs du salon. Nous voudrions un art qui nous prend et nous émeut, un art qui naîtrait du cœur. »
Outre le catalogue publié sous la direction de Claire Bernardi, paraissent aux éditions Denoël un essai de son compatriote Karl Ove Knausgaard, Tant de désir pour si peu d’espace. L’art d’Edvard Munch (Lire : Notre avant-critique) et un florilège des écrits du plus littéraire des peintres scandinaves, Mots de Munch (coédition Musée d’Orsay et de l’Orangerie / RMN – GP).
- Catalogue, sous la direction de Claire Bernardi, coédition Musée d’Orsay et de l’Orangerie / RMN – GP, 246 p., 45 €
- Mots de Munch, coédition Musée d’Orsay et de l’Orangerie / RMN – GP, 128 p., 14,90 €
- Karl Ove Knausgaard, Tant de désir pour si peu d’espace. L’art d’Edvard Munch, traduit du norvégien par Hélène Hervieux, Denoël, 272 p., 23 €