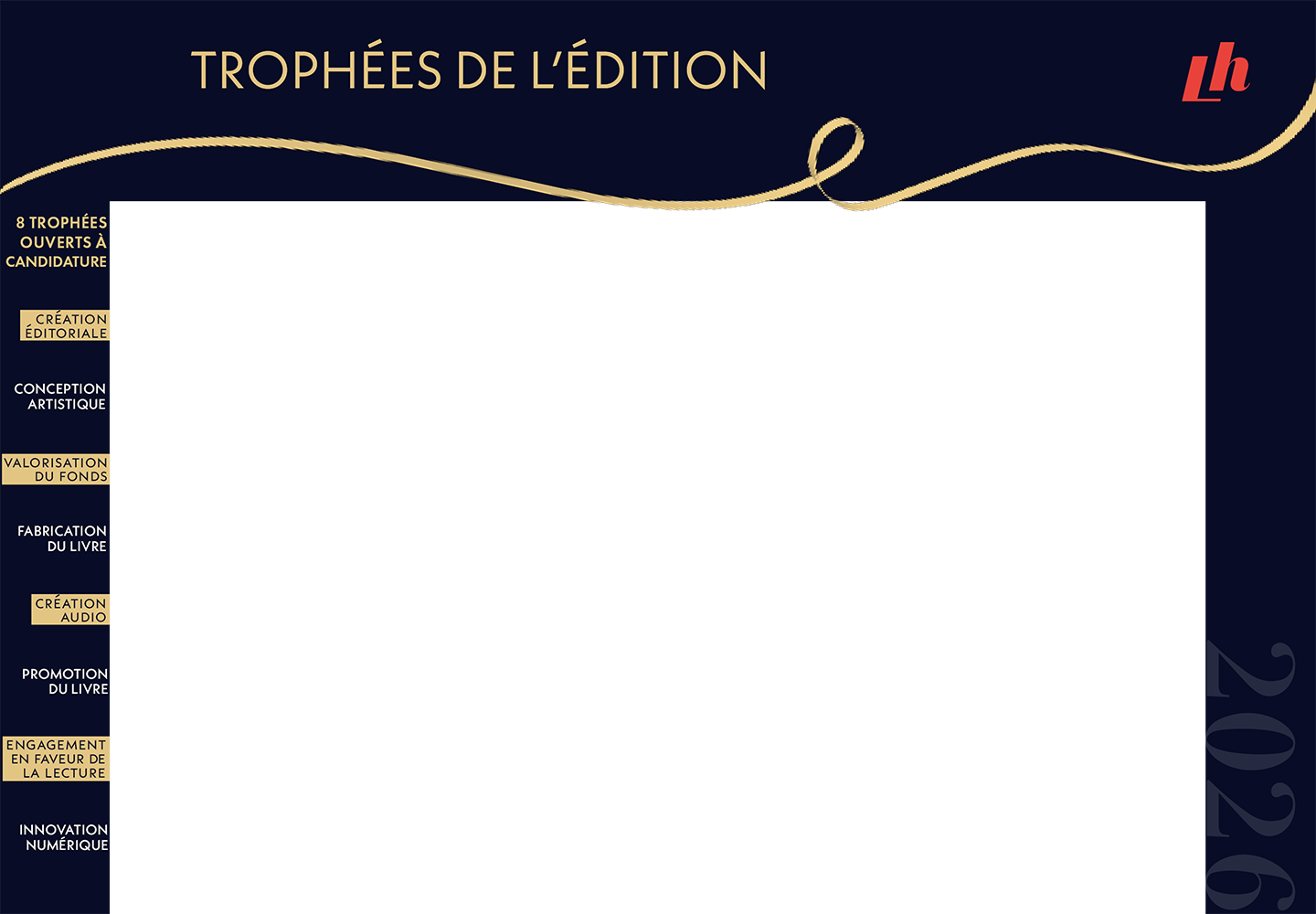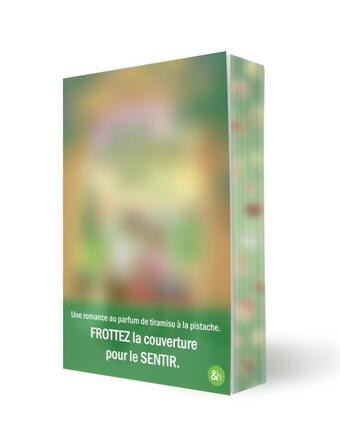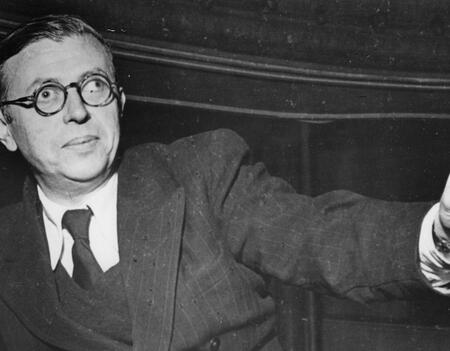Le mot « absolutisme » apparaît à la fin du XVIIIe siècle, notamment chez Chateaubriand, pour désigner le régime du pouvoir absolu. Mais pourquoi demeure-t-il une singularité française ? Qu’est-ce qui explique son émergence ? Et que met-on derrière cette épithète « absolu » ? C’est tout l’enjeu de l’enquête fouillée d’Arlette Jouanna. Professeure émérite à l’université de Montpellier-3, auteure de plusieurs ouvrages sur la France du XVIe siècle, son étude sur La Saint-Barthélemy (Gallimard, 2007) a particulièrement été remarquée. Or, ce massacre des protestants s’impose comme le point culminant de l’arbitraire autoritaire du roi.
Arlette Jouanna explique l’importance des guerres de religions dans l’installation de l’idée de pouvoir absolu. En 1527, devant le Parlement de Paris, Charles Guillart explique à François Ier qu’il est au-dessus des lois et que rien n’est susceptible de le contraindre. Pour autant, le roi n’est pas seul habilité à dire le droit. « Le pouvoir doit être reconnu par ceux qu’il domine. » Il faut donc qu’intervienne la liberté d’obéir, la servitude volontaire si bien exprimée par La Boétie. L’influence du christianisme, du droit romain et la redécouverte de la Politique d’Aristote vont y contribuer.
S’installe alors l’idée d’un temps ordinaire (la paix) et d’un temps extraordinaire (la guerre) qui justifie des conditions d’exception et donc un pouvoir exceptionnel. Le pouvoir absolu devient une sorte de garantie pour les théoriciens de la politique. La disparition de l’unité spirituelle au moment des guerres de religions va servir de déclencheur. Cette déchirure confessionnelle ouvre la voie au dogme absolutiste.
La sacralisation progressive du monarque à partir de Charles IX domine avec Henri IV, le roi choisi par Dieu qui détient un pouvoir suprême mais restant lié à la raison. La fonction monarchique est vue comme « une lieutenance confiée par Dieu » et la distance entre le vouloir et le pouvoir du roi s’amenuise.
Jouanna traque les différents usages du pouvoir absolu et la manière dont on l’entend, du Moyen Age à Henri IV. Elle ne cherche pas à savoir si cela a fonctionné mais comment une telle conception a pu s’imposer. Pourquoi des juristes s’y sont référés et pourquoi des monarques l’ont appliqué, avec tous les dangers que cela comporte. Etre seul contre tous, c’est d’abord être seul… Et comment savoir qu’on a raison quand on est seul ?
Arlette Jouanna montre aussi comment cette idée s’est installée comme un instrument de cohésion sociale, en dotant la volonté royale d’une sacralité supplémentaire qui s’accompagne d’une désacralisation du corps politique. Son travail très érudit constitue un remarquable travail sur les fondements théologiques, juridiques et philosophiques de la notion de souveraineté.
Laurent Lemire