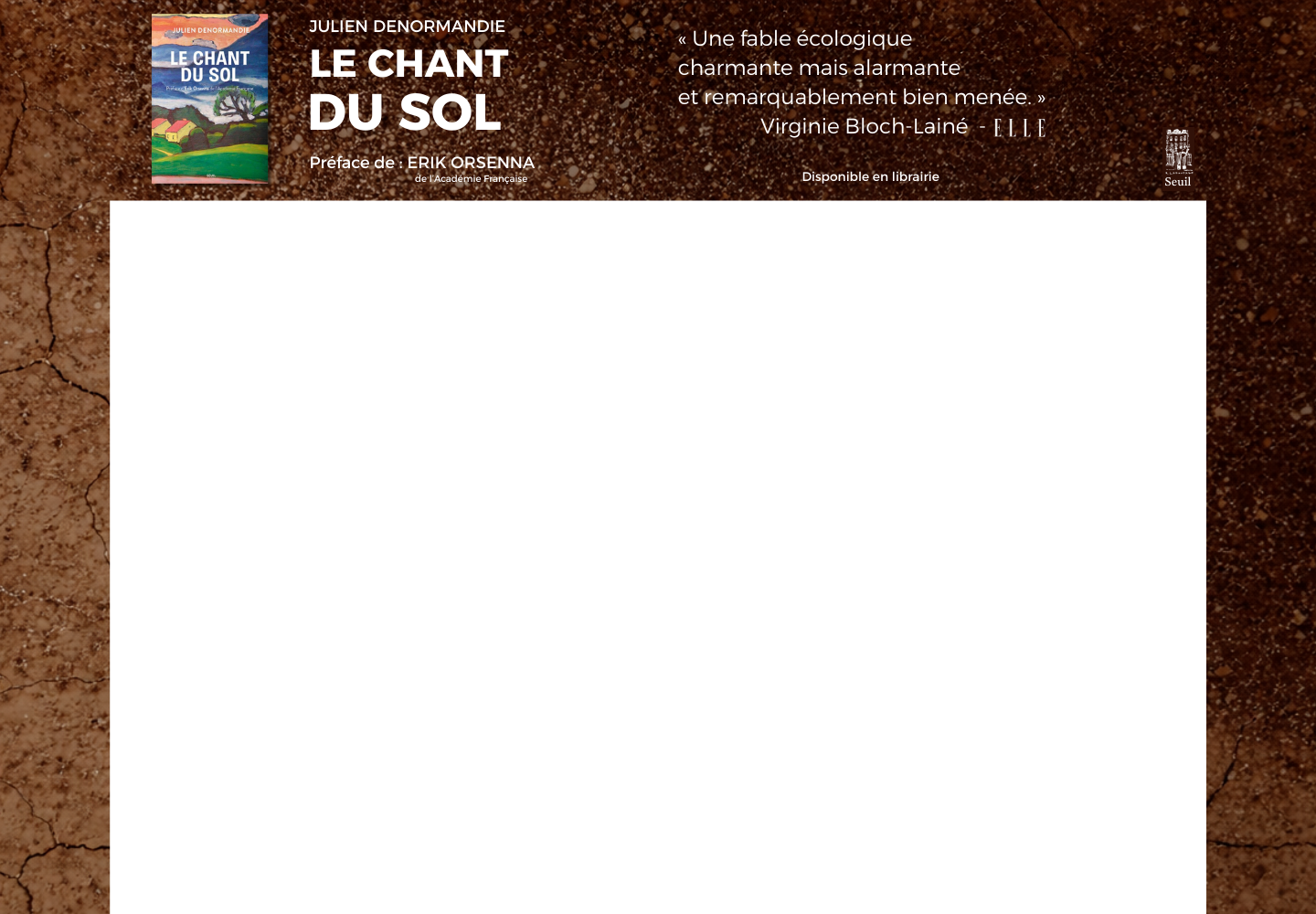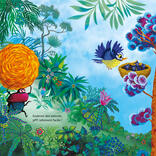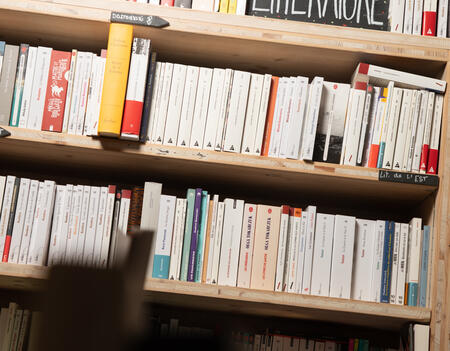Livres Hebdo : Le Musée de l’illustration jeunesse est le premier musée en France entièrement consacré à l’illustration jeunesse. Quelles sont ses missions principales et ont-elles évolué au fil du temps ?
Emmanuelle Martinat-Dupré : À l’origine de ce musée, il y a un illustrateur, Georges Lemoine, une galeriste, Marie-Thérèse Devèze et une éditrice, Nicole Meymat, fondatrice de la maison d’édition Ipomée. À l’époque, Georges Lemoine, qui avait travaillé pour de nombreuses maisons telles que Gallimard Jeunesse, s’interroge sur l’avenir de ses œuvres. Également sensibles à cette question, Nicole Meymat et Marie-Thérèse Devèze ont alors imaginé la création d’un lieu où conserver ce savoir-faire. Le projet a été soumis à des politiques qui ont choisi l’Hôtel de Mora, un hôtel particulier du XVIIIe siècle, pour accueillir les futures collections du musée. Lors de sa création en 2005, il ne s’agissait pas encore d’un musée mais d’un Centre de l’illustration jeunesse, qui assumait déjà une double mission : conserver et mettre en valeur cet art.
Une vitrine pour les talents émergents
De quelle manière le musée cherche-t-il à mettre en valeur l’illustration jeunesse ?
Dès sa création, le centre s’est doté d’un service des publics, à travers lequel ont été développés des projets de médiation et de sensibilisation à l’illustration. Aujourd’hui, deux personnes sont pleinement mobilisées sur ce point, collaborant avec le ministère de l’Éducation nationale, mais aussi avec des partenaires associatifs et des publics empêchés. Portés par l’ambition de devenir un musée de société et d’art contemporain ancré à l’échelle locale et nationale, nous avons lancé en 2008 le Grand prix de l’illustration jeunesse, dispositif de soutien à la création qui fête aujourd’hui sa 18ᵉ édition. En 2010, nous avons également inauguré une première résidence d’auteur autour de Nicolas Bianco-Levrin. Depuis, nous avons accueilli de nombreux artistes – confirmés ou émergents –, plusieurs ayant été découverts et publiés au sortir de la résidence. Plus récemment, encouragés par la Drac, nous avons instauré une résidence d’arts visuels qui se tient de la mi-avril à la mi-juillet.
Créé en 2005, le MIJ se veut un espace de conservation et de valorisation de l'illustration jeunesse.- Photo MUSÉE DE L'ILLUSTRATION JEUNESSEPour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.
Si vous deviez retenir quelques temps forts, lesquels citeriez-vous ?
Nous avons évidemment été marqués par la toute première donation faite au musée par l’illustratrice florentine Letizia Galli, et que nous avons reçue comme une sorte de gage de confiance. Je pense aussi à la visite de Grégoire Solotareff pour son exposition en 2008, ainsi qu’aux passages de Philippe Dumas, Nathalie Lété, Michèle Daufresne, Roberto Innocenti ou encore Danièle Bour, la créatrice de Petit Ours Brun, l’an dernier. Nous avons aussi accueilli l’ancienne ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, dont la visite a souligné l’intérêt porté à notre travail. Autant de belles rencontres, qui nous ont permis d’échanger avec des créateurs qui font l’histoire contemporaine de cet art. C’est aussi cela qui fait la force sensible de ce musée : les créateurs y passent et y laissent une trace.
« L’intégration des artistes contemporains est toujours un pari »
Un autre tournant majeur est intervenu en 2011, lorsque le musée a intégré une collection d’originaux plus anciens.
Ce fût en effet un autre de nos temps forts, en particulier lorsque nous avons intégré à nos collections les 317 Bibliothèques roses, ouvrages suffisamment rares pour que nous ayons signé une convention avec Gallica, qui nous a proposé de les numériser. Nous avons également accueilli le bois gravé de Gustave Doré, ainsi que le Livre Joujou (1831), premier livre interactif français. Aujourd’hui, nos collections comptent donc des incontournables du XIXe siècle, mais aussi des figures plus récentes comme Danièle Bour, Pierre Probst ou encore Étienne Delessert, qui a participé au renouveau de l’illustration jeunesse dans les années 1960-1970. Quant aux artistes contemporains, leur intégration est toujours un pari. Je pense, par exemple, à l’acquisition des originaux de Alors ? de Kitty Crowther (Pastel), avant qu’elle ne soit distinguée du prix Astrid Lindgren, ou encore à Rebecca Dautremer, approchée il y a plusieurs années pour son adaptation d’Alice au pays des merveilles et qui aujourd’hui, nous a fait la promesse d’une donation.
Comment le musée collabore-t-il avec les éditeurs de livres jeunesse ?
Depuis la création du Grand prix, nous entretenons des liens réguliers avec les maisons d’édition, qui nous envoient leurs ouvrages ou nous sollicitent pour des expositions. Nous avons également mené des coéditions, notamment avec L’Atelier du poisson soluble pour un abécédaire de l’illustration jeunesse, ou avec les éditions Momo autour d’un imagier de Solotareff. Tous les deux ans, nous participons à la Biennale des illustrateurs organisée à Moulins et, l’an dernier, nous avons inauguré notre premier colloque. Ces événements offrent également l’occasion d’échanger avec les professionnels du secteur, qui, je l’espère, trouveront dans cet écosystème une inspiration et des ressources nouvelles.
Quels écueils rencontrent l’illustration jeunesse ? On sait que, de façon générale, l’un des principaux enjeux de l’édition jeunesse est de gagner en visibilité, tant auprès des médias que du grand public…
L’illustration jeunesse, justement parce qu’il y a cette épithète « jeunesse », reste encore relativement peu visible. Il faut dire que les émissions consacrées à l’édition jeunesse sont relativement rares. Cependant, je pense qu’il ne faut pas être négatif. Depuis quelques années, on voit tout de même des médias, comme La Grande Librairie ou Quotidien, s’emparer de l’album jeunesse de façon plutôt pertinente. Les festivals, les lieux, les rencontres avec les auteurs se sont également démultipliés. Les illustrateurs, par exemple, sont de plus en plus nombreux à aller dans les écoles, contribuant ainsi à éveiller une sensibilité artistique et culturelle auprès de publics parfois éloignés. Aujourd’hui, l’édition jeunesse vit dans une ère paradoxale : d’un côté, la société semble vouloir se passer des enfants, et de l’autre, elle valorise le caractère éducatif des productions jeunesse. Ce qui est passionnant, c’est d’observer comment ce secteur va relever le défi de s’imposer dans un tel contexte.
Pour ses 20 ans, le musée a organisé l'exposition rétrospective "On n'a pas toujours 20 ans"- Photo MUSÉE DE L'ILLUSTRATION JEUNESSEPour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.
Justement, quels projets le musée souhaite-t-il pour que l'illustration jeunesse gagne en reconnaissance ?
Un de nos objectifs est d’obtenir la labellisation « Musée de France ». Pour y parvenir, et avant de nous présenter devant le Haut conseil des musées de France, nous avons dû rédiger un projet scientifique et culturel, en imaginant l’évolution du musée dans cinq à dix ans. C’est assez difficile à dire, puisqu’en dépit de nos nombreuses ambitions et envies, nous restons un service du département. C’est donc la collectivité qui a le dernier mot. Cependant, parmi nos réflexions, nous avons envisagé la création d’une artothèque pour soutenir les missions du musée, notamment en facilitant la circulation des œuvres sur le territoire, et au-delà.
« On n’a pas toujours 20 ans », une exposition rétrospective
À l’occasion des 20 ans du Musée de l’illustration jeunesse (MIJ), une exposition-anniversaire, inaugurée le 12 juillet dernier, se tiendra jusqu'au 5 janvier 2026. L'occasion de retracer deux décennies d'acquisitions, d'expositions, d'animations et de rencontres au service de l'illustration jeunesse, mais aussi de présenter au grand public quelques-unes des 7000 planches originales qui composent la foisonnante collection de l'institution.
Pour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.