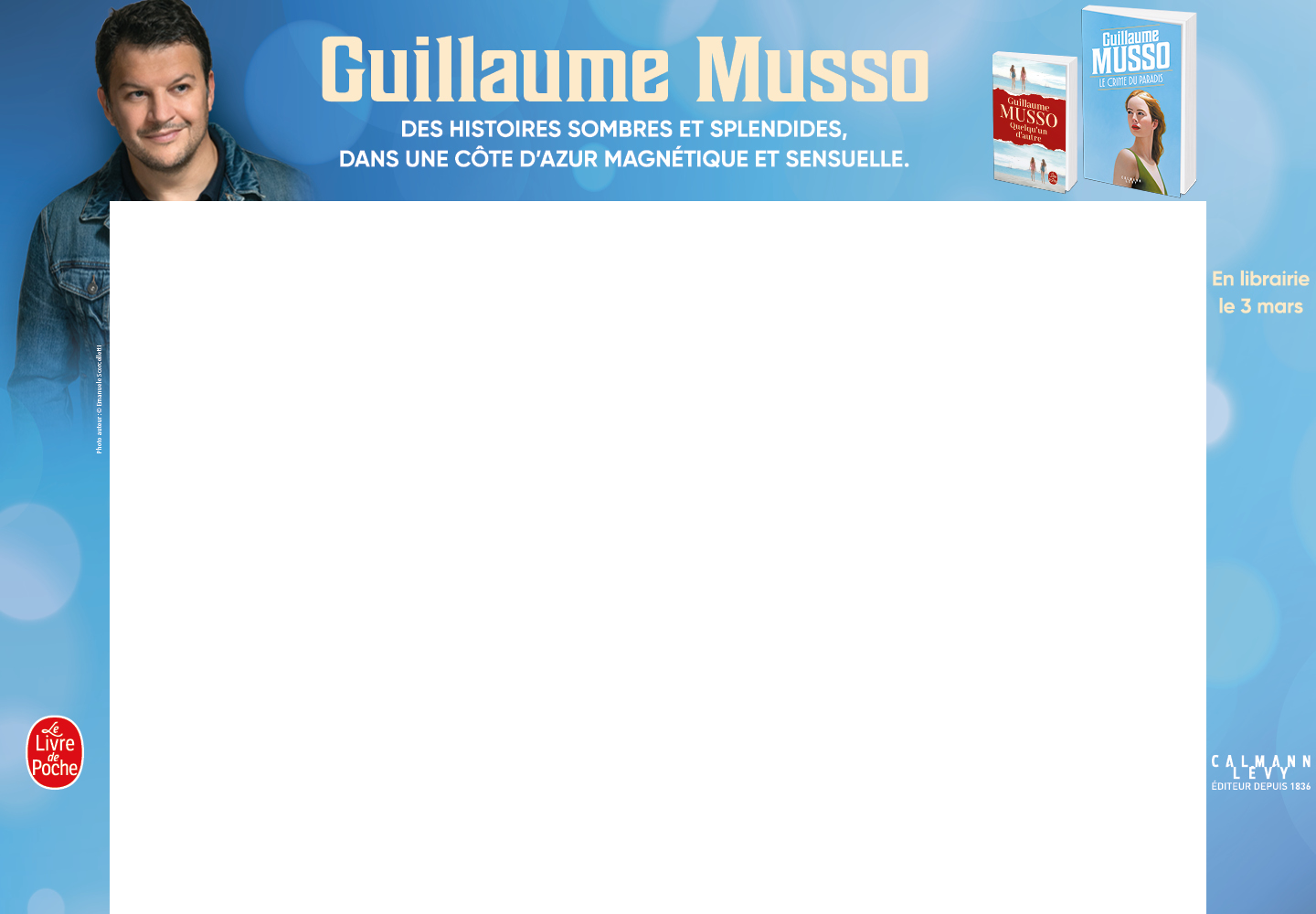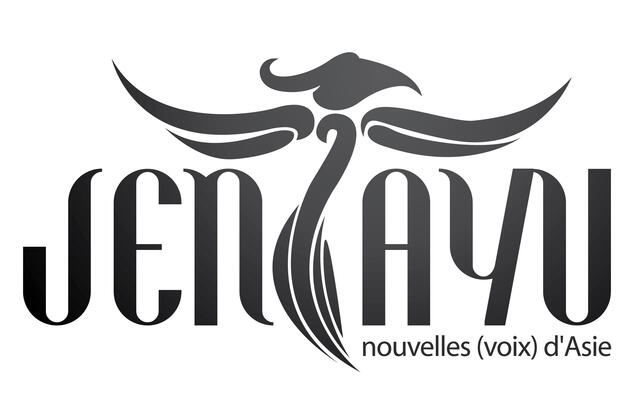Livres Hebdo : La littérature contemporaine en provenance de Chine, du Japon, de Corée du Sud et d'Inde nous parvient assez régulièrement. En revanche, la littérature de l'Asie du Sud-Est, une région vaste et diversifiée, n'est pas souvent traduite en français. Quels sont les défis pour faire vivre cette littérature en français ?
Jérôme Bouchaud : Déjà, il faut admettre que, si ces littératures ne sont certes pas beaucoup traduites, les lecteurs français ont malgré tout accès à un corpus de traductions publiées non négligeable, peut-être plus riche qu’en traduction anglaise et sûrement plus que pour toute autre langue européenne. C’est à mettre au crédit de nos traducteurs et de nos éditeurs. Cela étant dit, les défis pour une plus grande visibilité de ces littératures sont multiples.
L’Asie du Sud-Est continue de souffrir d’un relatif manque d’identification et d'intérêt de la part de certains éditeurs : on situe le Vietnam, la Thaïlande, mais pour le reste, c'est un peu flou et mystérieux, contrairement aux masses géographiques que sont la Chine et l’Inde et aux poids lourds du soft power que sont le Japon et la Corée du Sud. La question de la langue est aussi un défi. Les traducteurs de langues vernaculaires ne sont pas nombreux, mais ils existent. La réalisation de projets dépend de leur proximité avec le monde éditorial français (on se souvient des liens forts noués entre Marcel Barang, regretté traducteur du thaï, et les éditions du Seuil), c’est une distance qu’il faut chercher à réduire. Enfin, le financement des traductions joue aussi un rôle évident : pour les éditeurs étrangers, ces bourses sont un apport financier important pour amortir le risque pris avec des traductions coûteuses.
À ce jour, il n’existe pas en Asie du Sud-Est de programme d’aide à la traduction équivalent à celui de la Corée du Sud, programme qui aura été un instrument essentiel dans l’émergence, puis la consolidation, du rayonnement culturel sud-coréen au niveau mondial. Malheureusement, pour diverses raisons, les états d’Asie du Sud-Est n’ont pas de vision politique de long terme sur ce plan-là.
Vous êtes basé entre la France et la Malaisie et dirigez une maison d'édition, Jentayu, qui publie des livres traduits de langues asiatiques vers le français. Quels changements avez-vous observés dans votre lectorat depuis la fondation de la maison, il y a onze ans ?
Le lectorat est de plus en plus jeune, de plus en plus ouvert et connaisseur des réalités de l'Asie contemporaine, et de plus en plus demandeur de diversité dans les productions éditoriales. Les littératures de l’imaginaire et queer venues d’Asie, y compris sous forme de romans graphiques, suscitent aujourd’hui un intérêt très fort, dans le sillage des contenus disponibles sur des plateformes de type Netflix ou Mubi, qui ont une longueur d’avance sur la production littéraire disponible en traduction.
On observe des dynamiques très diverses autour de certaines de ces littératures : la Corée du Sud a le vent en poupe bien sûr, Taïwan aussi. La Chine, par contre, semble dans le creux de la vague et en cours de réinvention. Quant à l'Asie du Sud-Est, elle est peut-être en passe de connaître son « moment », comme d’autres régions du monde en ont connu avant elle. L’effet de mode est perceptible outre-Atlantique quand on voit la production éditoriale faisant de plus en plus la part belle aux récits de jeunes générations issues des diasporas d’Asie du Sud-Est.
Photo DRPour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.
Vous êtes également agent littéraire chez l'agence Astier-Pécher. De quels pays viennent les auteurs que vous représentez, et quels livres seront bientôt publiés sur le marché français ?
Nous représentons des auteurs venus de toute l’Asie : de Chine et de l’Inde, mais aussi du Vietnam, de Malaisie, de Thaïlande, d'Indonésie, des Philippines, de Mongolie... En 2025, est déjà paru Femme pour moitié, le phénoménal roman de l’auteur indien Perumal Murugan, traduit du tamoul par Léticia Ibanez, dans la collection Du Monde Entier chez Gallimard. En mars sortira chez Actes Sud le bouleversant B-52 ou celle qui aimait Tolstoï, le nouveau roman de l’immense écrivaine vietnamienne Thuân, son tout premier écrit directement en français et très attendu en cette année de commémoration des 50 ans de la libération du Vietnam.
En mai paraîtra chez Zulma le kaléidoscopique recueil de nouvelles Le poids des os, de la Malaisienne Shih-Li Kow (trad. Dominique Vitalyos), dont le roman La somme de nos folies avait remporté le Prix du Premier roman étranger 2018 et séduit un nombre incroyable de lecteurs pour qui la Malaisie contemporaine était un Ailleurs très, très lointain. À l’automne sortira chez Actes Sud un grand roman historique : Le jour où tu m’as touchée, de l'autrice chinoise Yan Geling (trad. Mélie Chen), devenue persona non grata dans son pays pour avoir critiqué la politique du Parti communiste aux temps de la covid. D'autres projets de traduction sont en cours et trouveront le chemin des librairies l’an prochain.
En 2023, l'Université de Chicago a lancé un programme de traduction, SALT, avec l'aide d'un donateur, pour traduire la littérature d'Asie du Sud. Y a-t-il un intérêt de la part des traducteurs, universitaires ou acteurs du domaine du livre pour ce type d'initiative en France ?
La question du financement est cruciale pour la démultiplication des projets. On l’a bien vu avec l’essor de la Corée du Sud sur la scène culturelle mondiale depuis une quinzaine d’années et qui a mené à l’apothéose du prix Nobel de littérature de Han Kang : sans la manne financière constante accordée par l’État coréen au Literary Translation Institute of Korea, tout cela n’aurait pas été possible. On le voit aussi avec Taïwan, qui a mis en place un système très proche et très proactif, impliquant fortement les traducteurs. Toute initiative, qu’elle émane du privé ou du public, est donc la bienvenue pour contribuer à plus de traductions.
Je n’ai pas d’échos concernant la possible mise en place d’une initiative de type SALT en France. Le Centre National du Livre (CNL) apporte déjà sa pierre à l’édifice, et il faut se tenir informé des initiatives disponibles localement. Par exemple, pour les traductions depuis la langue tamoule, un programme d’aide encore méconnu est ouvert aux éditeurs étrangers par la Foire du livre de Chennai. Le National Arts Council de Singapour a son propre dispositif, mais tout n’est pas encore clairement accessible en ligne. Les Philippines se sont aussi attelées à la tâche en raison de leur statut de pays invité d’honneur de la Foire de Francfort cette année. Toutes ces initiatives doivent être encouragées, relayées et rendues aussi pérennes que possible.