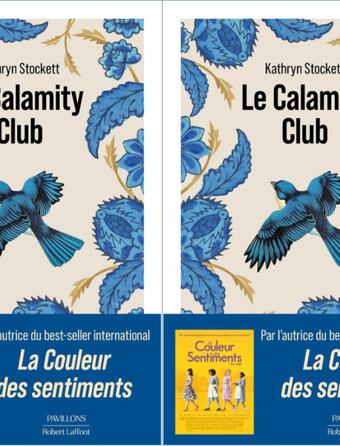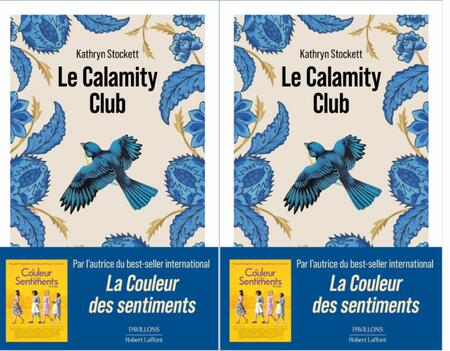Il y aura des avions, des taxis, des chambres d’hôtel. Et un homme, un écrivain, la cinquantaine, qui se résout à ne plus prendre les bêtabloquants que lui prescrit son médecin et qui jugule en lui le désir, l’irruption désordonnée des souvenirs. Il s’appelle Juan Diego, il est mexicain. Malgré son infirmité (il ne peut se servir d’un pied, écrasé dans son jeune âge par une voiture), il a quitté New York pour les Philippines. Tout au long de son voyage surgiront comme des anges ou des démons gardiens, une mère et une fille qui seraient assez son genre s’il en avait encore un. Rien chez lui ne vient adoucir son mal de vivre et surtout pas la célébrité, ce miroir aux alouettes des "gringos" et des êtres sans chagrin. Juan Diego est plein de larmes, et cette cargaison lui est précieuse. Voici que revient comme un remords, comme une chanson douce, l’enfance. C’était dans une décharge près d’Oaxaca (plus tard à Mexico City, dans un orphelinat tenu par des pères jésuites aux motivations charitables douteuses), auprès d’une mère un peu femme de ménage, pas mal prostituée, qui mourra en nettoyant une statue de la Vierge. Il y avait là le chef de la décharge qui aurait pu (dû) être son père, un chien errant trop aimé, les livres qui offriront le monde à cet enfant surdoué et, surtout, Lupe, sa petite sœur qu’il est le seul à comprendre et qui, faute de savoir vraiment parler, lit dans les pensées d’autrui. L’atroce se conjugue au merveilleux, le baroque à la fange, comme dans ce cirque où Juan Diego trouvera un temps refuge.
Le cirque est la métaphore première du conteur exceptionnel que demeure John Irving. Fable picaresque, Avenue des mystères offre à ses lecteurs comme un condensé de son art. Quel cirque que la vie d’un homme comme ce Juan Diego, qui, entre onirisme et souvenir de la douceur, s’ingénie ainsi à congédier le réel. John Irving, on le sait, est un raconteur d’histoires hors pair. Cette fois-ci, se situant résolument du côté des marges, adversaire du puritanisme, aimant la foi et détestant les dévots, ce Dickens contemporain s’amuse avec le réalisme magique d’un García Márquez. Il fouaille sans cesse les mêmes obsessions, décline à l’infini deux ou trois scènes primitives (l’absence des pères, les maîtresses femmes, les corps martyrisés…), il déroule son implacable machinerie romanesque, sa petite boutique des horreurs merveilleuses, avec une maestria qui n’appartient qu’à lui. Le passé vient sans cesse percuter le futur, et de ce crash il ne reste rien qu’un homme, dans la vérité première de sa solitude. Il pourrait s’exclamer bien sûr "Juan Diego, c’est moi", tant ce romancier congédié de lui-même, au fond, lui ressemble. C’est énorme, trop beau pour être vrai et pourtant… Pourtant, plus que jamais maître de ses prodiges romanesques, magicien à l’humeur noire, John Irving nous rappelle que parfois l’art et les sentiments peuvent faire bon ménage.
Olivier Mony