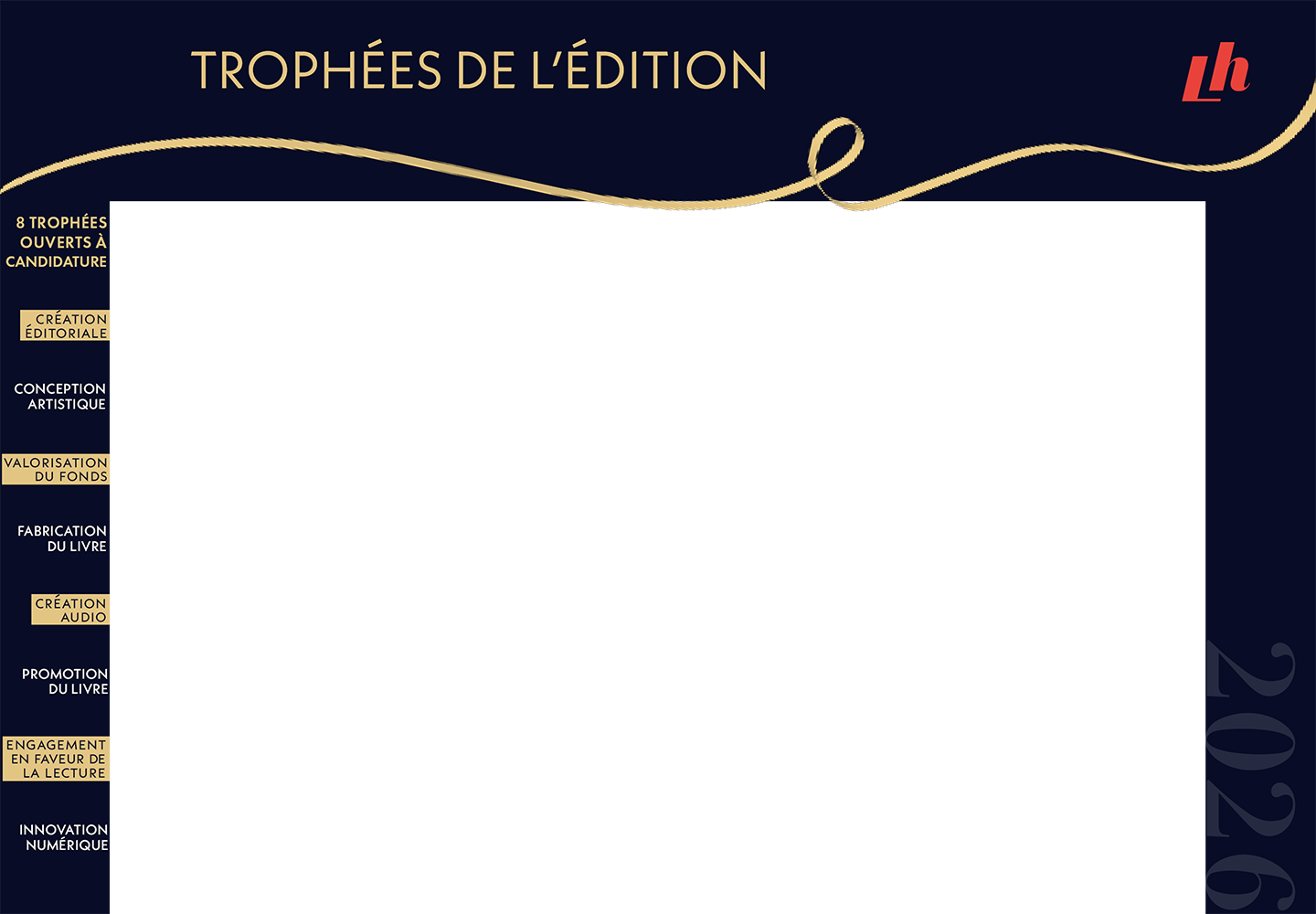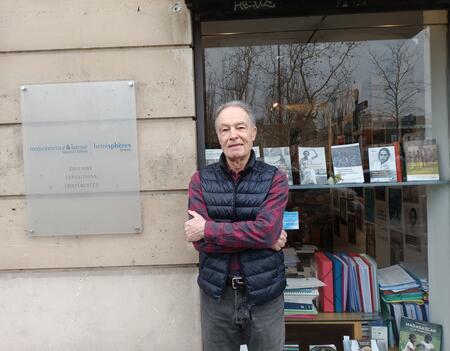Un long chemin. Dans ce livre remarquable qui deviendra sans doute une référence au sein de la recherche sur les féminismes, Camille Froidevaux-Metterie a réuni une centaine d'autrices et auteurs, chercheuses et chercheurs en sociologie, en linguistique, en études de genre, en psychanalyse, en philosophie, en histoire ou encore en littérature, pour appréhender les théories féministes « dans leur profondeur historique et leur diversité intrinsèque ». En quelque sept cents pages, quatre parties, dix-neuf chapitres et une riche bibliographie, des « pionnières médiévales de l'autonomie intellectuelle » aux réflexions contemporaines autour des masculinités et des façons de réinventer la famille, le livre retrace des millénaires de combats menés par les femmes pour sensibiliser les pouvoirs et la société à leurs conditions afin de les améliorer.
S'il s'est d'abord agi de revendiquer les droits civiques et politiques des femmes et de souligner des inégalités fondamentales, puis de sortir des assignations strictement hétérosexuelles et maternelles qui leur sont réservées, la lutte féministe s'est ensuite ouverte à l'intersectionnalité, dénonçant des systèmes d'oppression hérités du capitalisme et du colonialisme. L'historienne Fanny Gallot analyse ainsi les liens entre les féministes et le syndicalisme mais aussi la spécificité des grèves menées par les femmes au tournant du xxe siècle. La philosophe Marion Bernard aborde les « expériences de l'oppression » sous le prisme de la phénoménologie, convoquant Simone de Beauvoir et Frantz Fanon mais aussi Sara Ahmed et Elsa Dorlin comme des penseuses de l'« être au monde » structurellement réifié par les pouvoirs normatifs et patriarcaux en place. La sociologue Isabelle Clair revient sur la construction de la notion de « point de vue situé » si précieuse aux réflexions féministes notamment parce qu'elle a permis de penser l'androcentrisme du savoir scientifique, de révéler l'effacement des femmes dans le champ intellectuel et de souligner l'apport des femmes dans l'élaboration d'une science plus juste, en rupture avec les discours d'autorité. La philosophe Hourya Bentouhami explore le féminisme noir et la critique de la blanchité dans les cercles féministes. L'enseignant et chercheur Bruno Perreau analyse le « tournant queer » de la théorie féministe, qui a mis en résonance différentes expériences minoritaires et invité à déconstruire les mécanismes de binarité, d'exclusivité, d'individualisme. La doctorante en philosophie politique Pamina Guyot-Sionnest développe la notion d'enfantisme née dans les années 1970 et replacée au cœur de la pensée féministe contemporaine.
Les questions liées à la santé mentale, à la justice reproductive, mais aussi à d'autres formes de dominations récemment dénoncées comme l'âgisme ou le validisme y sont aussi appréhendées. Si bien que l'ensemble de cet ouvrage mène à penser « la pluralité des formes de l'oppression et la manière dont elles se renforcent et se soutiennent mutuellement ». Dans la conclusion de cette grande traversée de l'élaboration et de l'évolution des théories féministes, Marie Garrau, maîtresse de conférences en philosophie sociale et politique, explique que si l'autonomie est une étape nécessaire, l'heure est à l'alliance et aux coalitions pour l'abolition de toutes les oppressions.
Théories féministes
Seuil
Tirage: 7 000 ex.
Prix: 27 € ; 768 p.
ISBN: 9782021567595