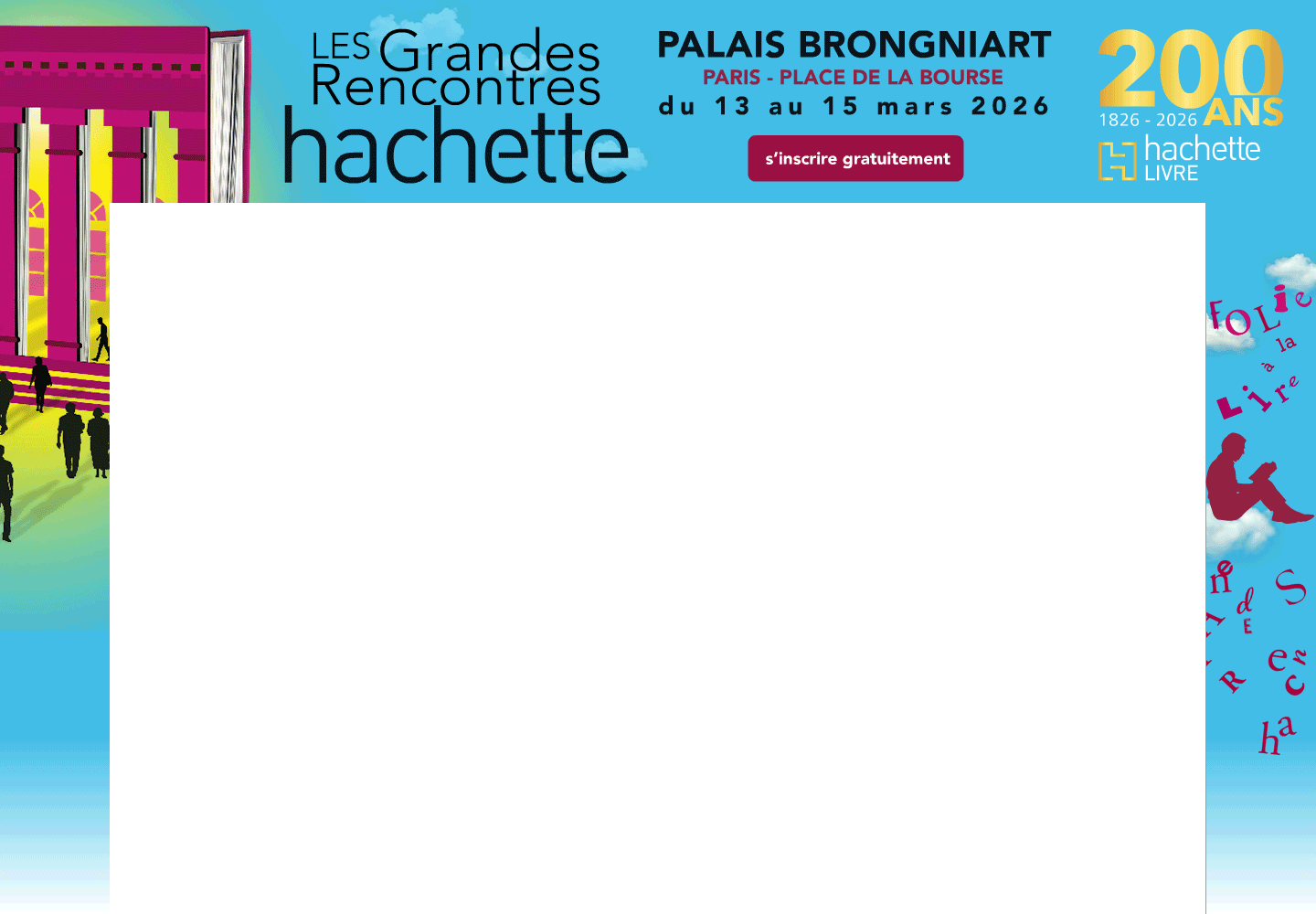Clovis Goux a évoqué l’anorexie d’une pop-star dans La disparition de Karen Carpenter (Actes Sud, 2017), la pédophilie du cinéma d’auteur américain des années 1970 dans Chère Jodie (Stock, 2020) et la « nazisploitation » (ce type de films de série B – ou pas – où il est question de nazis et de sexe) dans Les poupées (Stock, 2022) … Dressant de livre en livre, il a dessiné une cartographie saisissante de la face sombre de la pop culture. « S’il y a un fil conducteur qui court entre mes livres précédents, c’est peut-être celui de l’exploitation comme mécanisme mortifère de la pop culture des années 1970 : exploitation du corps des femmes, exploitation de l’image des adolescentes, exploitation des sévices subis par les victimes de la Shoah. Si Karen et Jodie traitaient plus spécifiquement des ravages causés par l’essor de la culture de la célébrité après-guerre, Les poupées s’interrogeait sur les limites de l’art, sur l’échec des artistes à traiter de l’holocauste sous forme romanesque : je ne pourrais pas citer un seul film réussi sur le sujet, pour moi ils sont systématiquement balayés par le moindre témoignage de survivant », explique-t-il alors que sort son nouveau roman, Extrême paradis. Une dystopie qui semble, a priori, moins liée à l’exploration de la pop culture. Explications.
Livres Hebdo : Votre nouveau roman, Extrême paradis, s’inscrit-il dans la critique de la pop culture qui caractérisait vos livres précédents ?
Clovis Goux : Ce roman met en scène la génération des baby-boomers, qui a grandi en même temps que la pop culture partait à l’assaut du monde, s’en est gavée jusqu’à l’écœurement et la regarde aujourd’hui avec nostalgie et fierté, comme s’ils avaient gagné la guerre.
Est-ce le signe chez vous d’une ambivalence vis-à-vis de la musique ou du cinéma que vous aimez ?
Je suis avant tout assez effrayé par la consommation culturelle. J’ai souvent l’impression que l’on ne fait que cocher des cases, que les œuvres d’art dépassent rarement le statut de produit et qu’elles n’ont aucune incidence sur nos sentiments ou nos idées. Elles nous rassasient juste durant un laps de temps. Les bornes d’achat dans les cinémas et les musées sont d’ailleurs les mêmes que dans les fast-foods. L’arrivée du mp3 puis du streaming a totalement tué ma curiosité pour la musique, par exemple. Si tout est disponible dans l’instant, alors il n’y a plus de désir et l’on ne peut plus construire d’imaginaire sur un groupe ou sur un album. C’est la même chose pour le cinéma, avec le téléchargement et les plateformes : j’ai rêvé durant des années de voir des films que je peux désormais regarder à tout moment. Et je ne parle même pas des séries télé, dont le but est de rendre le spectateur captif, addict à un flot d’images regardées en accéléré. S’il y a une expérience du vide, c’est bien celle du binge-watching. Restent les livres qui résistent par je ne sais quel miracle à ce phénomène.
À travers les villages fermés de Floride que vous mettez en scène, vous présentez les baby-boomers qui refusent de vieillir et vivent dans un éternel présent, une éternelle jeunesse… Mais pourquoi le leur reprocher ?
Parce qu’il faut accepter l’idée que l’on va mourir, que la dégradation physique et morale est inévitable. J’ai l’impression que la génération des baby-boomers est la première qui s’est vécue comme éternelle parce qu’elle a été hyperprivilégiée à tous les niveaux (salaires, santé, retraites...), et qu’elle a tendance à considérer ces privilèges comme des dus. Ce sont vraiment les enfants gâtés du XXe siècle, et tant mieux pour eux. Après, je constate juste une situation et ne fais pas leur procès comme les millenials, plus jeunes que moi, ont pu le faire en les rendant responsables de tous les maux contemporains. Ce sont plus les conflits de générations qui m’intéressent car ils sont l’un des moteurs de l’Histoire. Je ne cherche pas à désigner des coupables et des victimes, mais plutôt à dépeindre une société gangrenée par la culture de la haine.
C’est aussi l’occasion d’évoquer une sorte de nostalgie « standard » de la musique, de la mode, du cinéma des années 1960 à 1980. Comme si, pour eux – pour nous tous, même –, tout ce qui était venu après était moins bien.
Oui, c’est ce que racontait Simon Reynolds dans Rétromania (Le Mot et le Reste, 2012), un monde figé dans ses certitudes, obsédé par le passé, qui pense qu’on ne fera jamais mieux que les Rolling Stones, qui pensaient eux-mêmes qu’on ne pouvait pas faire mieux que Chuck Berry et ainsi de suite. J’ai vécu les années 1980 adolescent et je peux témoigner que, musicalement, cette décennie était atroce : tous les lycéens écoutaient Duran Duran, il n’y a pas de nostalgie à avoir de ces années-là ! Heureusement, à la fin des 80’s, The Jesus and Mary Chain et The Smiths sont arrivés pour sauver l’honneur. Puis il y a eu Madchester, les raves et la techno. Qui aurait pu anticiper une telle révolution ? En regardant vers l’avenir, j’ai envie de dire comme Jean-Paul II : « N’ayez pas peur. »
Finalement, dans votre roman, le paradoxe de cette génération semble être d’aspirer à une éternelle jeunesse tout en détestant les plus jeunes qu’eux.
Oui, les jeunes sont leurs ennemis car ils symbolisent une mort qu’ils n’acceptent plus. Le pays imaginaire que je décris, les Villages-Unis de Floride, a rejeté les moins de 55 ans hors de ses frontières (comme aujourd’hui les communautés fermées de retraités qui essaiment au sud des États-Unis), a effacé les cimetières de son paysage, a réduit la criminalité à néant pour créer un paradis artificiel. C’était aussi une façon de parler des replis communautaristes de notre époque, que je trouve assez angoissants. J’ai grandi avec un idéal universaliste qui semble aujourd’hui totalement obsolète.
Extrême paradis est à la fois un roman de genre, une dystopie avec une trame policière, et un roman très personnel dans lequel vous évoquez des souvenirs d’un père qui semble être le vôtre. Comment avez-vous tressé les deux, décidé de mêler ces registres très différents ?
Après Chère Jodie et Les poupées, qui étaient ce qu’on nomme des « exofictions », je voulais tenter autre chose, me rapprocher d’une forme romanesque hybride. En lisant le livre de Houellebecq sur Lovecraft, j’ai appris que de nombreux écrivains comme Robert Bloch avaient continué l’œuvre du maître en écrivant des romans perpétuant ses mythes, ses motifs et ses obsessions. Je me suis alors demandé avec quel écrivain je pourrais faire la même chose et J. G. Ballard s’est imposé comme une évidence. C’est dans son dernier cycle (Super-Cannes, Millenium people, Que notre règne arrive...) qu’il faut donc chercher l’origine d’Extrême paradis. Mais aussi dans Le massacre de Pangbourne, qui a pour cadre une communauté fermée, et dans La bonté des femmes, où Ballard raconte sa vie comme s’il s’agissait d’une fiction. Quand j’ai découvert que pour Empire du soleil, il avait supprimé ses parents de l’histoire alors qu’en réalité, il avait été interné avec eux dans un camp tenu par des Japonais durant la guerre, tout devenait possible ; un espace s’ouvrait à moi où l’on pouvait entremêler réalité et fiction. C’est ainsi que j’ai imaginé transposer une histoire intime, la mort violente de mon père, dans le cadre d’une dystopie ballardienne, et conçu Extrême paradis comme une sorte d’« auto-science-fiction ».