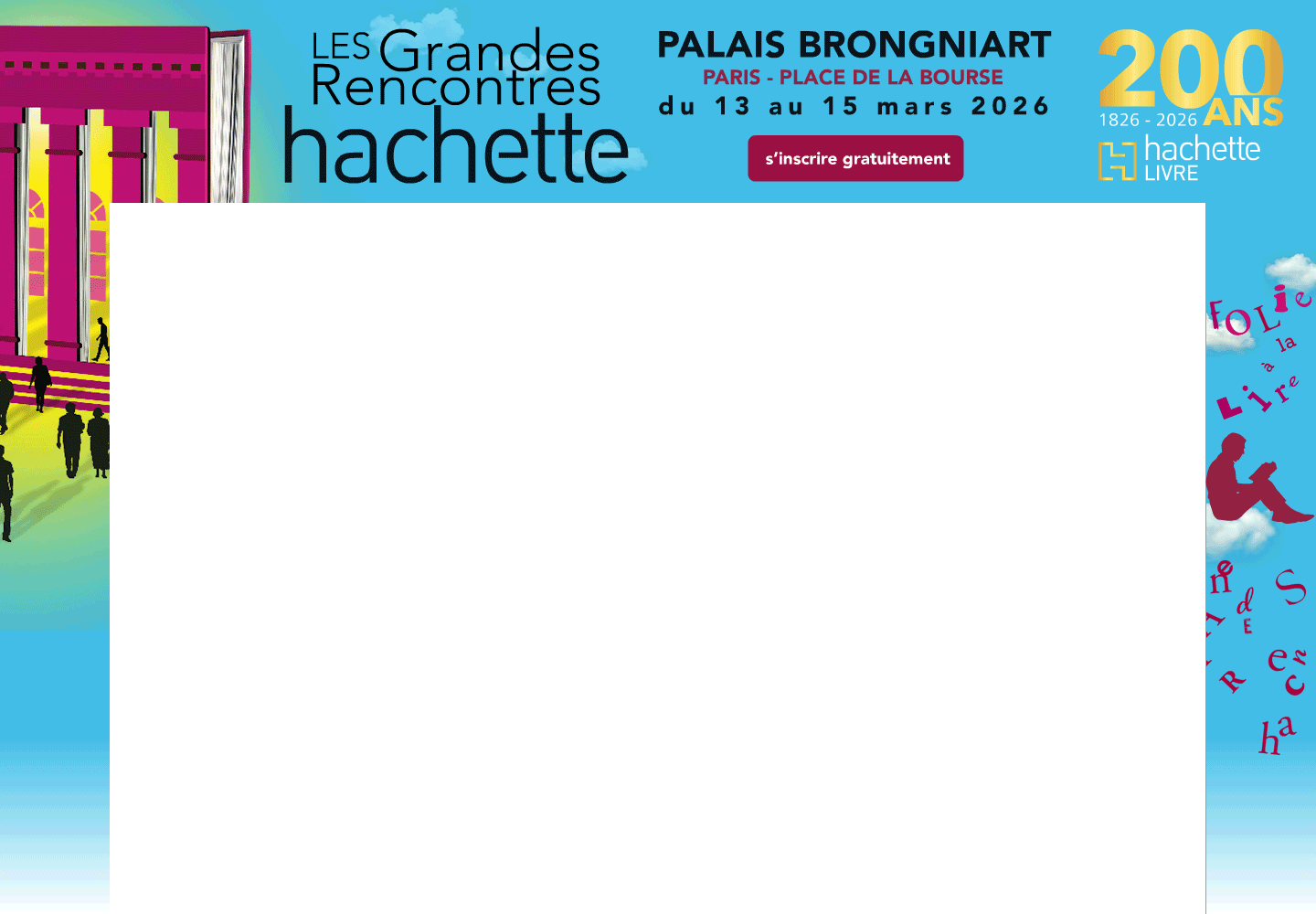En quarante-cinq ans d’édition, Vladimir Dimitrijevic a bâti avec sa maison, L’Age d’homme, un catalogue exigeant et faisant autorité dans le domaine slave. Disparu en 2011, son parcours fut peu banal : adulé dans les années 1980, il fut voué aux gémonies la décennie suivante, mais à chaque fois pour des raisons plus politiques que littéraires. Sa mort brutale, dans un accident de la circulation, l’a empêché de laisser des Mémoires et peut-être, du reste, n’aurait-il jamais songé à se livrer à cet exercice narcissique, lui qui aimait dire que son catalogue lui servait de "portrait-robot". Le livre d’entretiens avec Gérard Conio qui paraît aujourd’hui aux éditions des Syrtes, en coédition avec L’Age d’homme, à défaut de combler cette lacune, nous offre de très belles pages sur la conception que Dimitrijevic avait du métier d’éditeur, en même temps qu’il nous éclaire un peu plus sur le personnage.
Réfugié en Suisse
Né en 1934, Vladimir Dimitrijevic décide, à 20 ans, de fuir la Yougoslavie communiste. Il se réfugie en Suisse, où il travaille quelque temps dans l’industrie horlogère, avant de trouver à s’employer dans une librairie, d’abord à Neuchâtel, puis à Lausanne. C’est dans cette dernière ville qu’il fonde, en 1966, sa maison d’édition. C’est aussi à Lausanne qu’il rencontre, en 1972, l’universitaire Gérard Conio, alors en poste à l’université de Bratislava. Gérard Conio traduira, pour lui, des auteurs russes et polonais mais les deux hommes vont surtout se livrer à des échanges qu’ils décident, en 1996, d’enregistrer au magnétophone. Ces échanges, qui s’interrompront à la mort de l’éditeur, étaient destinés à devenir un livre dont Vladimir Dimitrijevic avait lui-même choisi le titre, Béni soit l’exil ! : "C’est paradoxal, mais l’exil m’a donné cette possibilité de me sentir chez moi partout", expliquait-il, précisant toutefois que cette sensation se limitait à l’Europe chrétienne. Ailleurs, il avait l’impression d’être "dans un décor" : "Ça m’intéresse, ça me passionne, mais ce n’est pas pareil."
Anticommuniste
Catalogué à ses débuts comme un éditeur "viscéralement" anticommuniste, il devient, à partir du milieu des années 1970, et notamment après la publication des Hauteurs béantes d’Alexandre Zinoviev, un héraut de la dissidence, dès lors qu’il ne se trouvait plus guère de figures intellectuelles pour défendre le communisme. L’écroulement du bloc de l’Est marqué, pour ce qui le concerne, par l’explosion sanglante de l’ex-Yougoslavie, va faire de lui un paria, en raison de son attachement à ses racines serbes et chrétiennes orthodoxes. Cette partie de son parcours constitue, à travers plusieurs chapitres, l’un des points forts de l’ouvrage. "Je suis serbe et j’ai le droit de défendre ma tradition et mon pays", se justifie Dimitrijevic.
Il n’est pas sûr qu’une pirouette ("On m’a reproché d’être un éditeur "proserbe", mais c’est ridicule. Reprocherait-on à un Suisse d’être "prosuisse" ?") et un développement intéressant sur les pratiques de "chiens de garde" des intellectuels tout au long du XXe siècle ne suffisent à son retour en grâce chez ceux qui lui ont tourné le dos. Car Dimitrijevic use de formulations ("nouvel ordre mondial", "politiquement correct", "roquets de l’information"…) qu’on retrouve ad nauseam chez les tenants de la "pensée unique", la vraie, celle qui s’insinue aujourd’hui partout comme un cancer, et qui est à la fois raciste, misogyne et profondément réactionnaire. "Les Serbes sont trop marqués par une vision virile du monde, avance-t-il par exemple. Et la vision virile, héroïque du monde, est complètement bannie. L’héroïsme, le côté épique de la vie, est complètement démoli par la recherche de la sécurité. Et la recherche de la sécurité, c’est un réflexe féminin. Nous entrons probablement dans une société matriarcale qui interdit les exploits." Sauf à considérer que le massacre de Srebrenica, dont il ne dit pas un mot, fut un exploit.