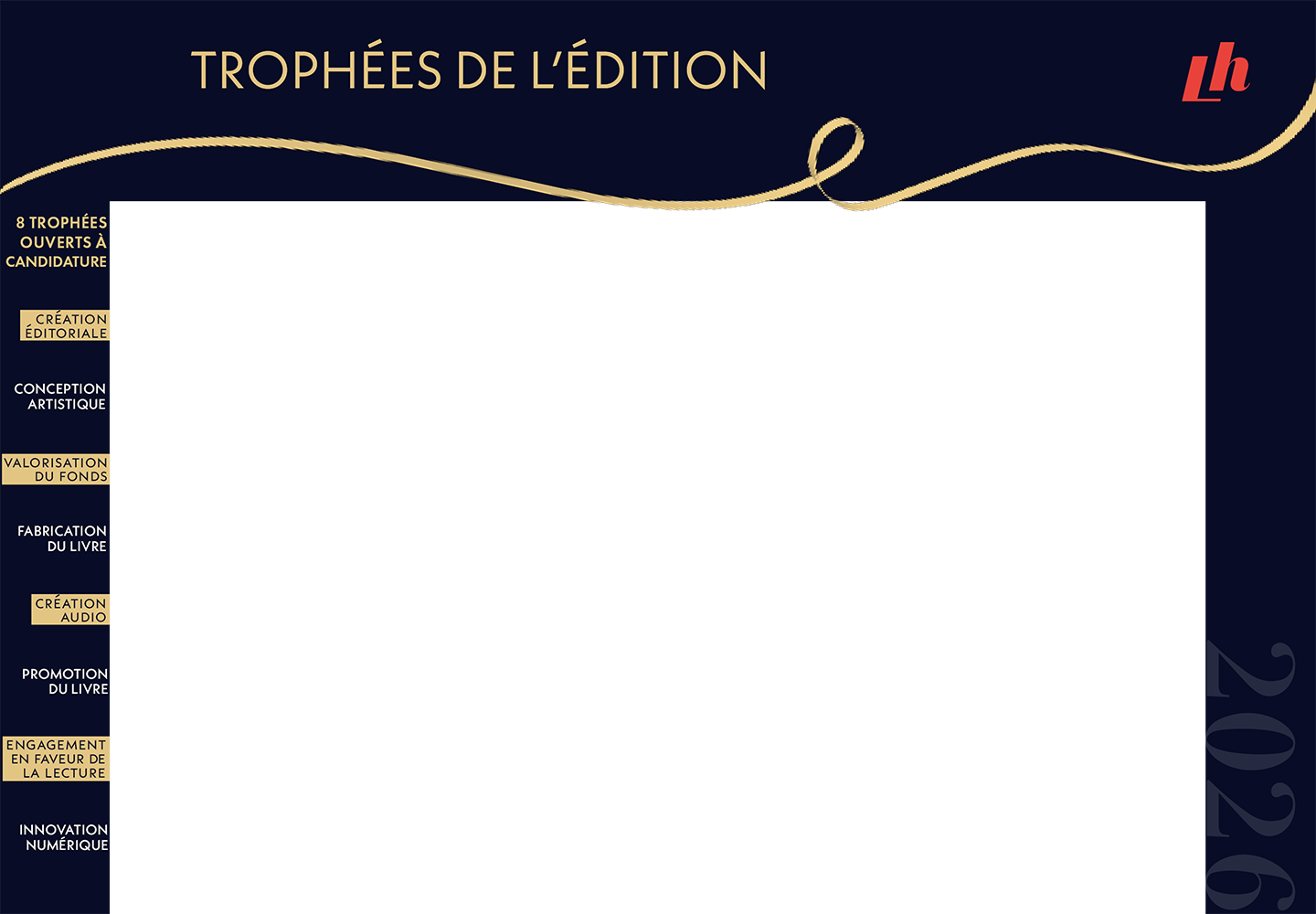Ceux qui s'en vont…
Il en va ainsi de David Diop, Rachid Benzine et Sarah Chiche, qui débarquent tous chez Julliard, suivant le mouvement de leurs éditeurs Adrien Bosc et Frédéric Mora partis du Seuil il y a un an et demi. Prix Inter 2023 pour Attaquer la terre et le soleil (Le Tripode, 2022), Mathieu Belezi revient sous les couleurs de Robert Laffont, où officie son éditeur Frédéric Martin depuis le début de l'année, avec Cantique du chaos. Dans ce roman, un desperado moderne s'engage dans un périple pour préserver sa liberté alors même que le monde vrille entre cataclysmes et régimes totalitaires. C'est aussi la débâcle qui sert de toile de fond à De l'autre côté de la vie, de Fabrice Humbert, passé de Gallimard à Calmann-Lévy. Fuyant un Paris en proie à la guerre civile avec ses deux enfants, un homme raconte son chemin vers une société utopique.
Dans les pas de l'éditrice Juliette Joste, deux vedettes quittent Grasset pour rejoindre L'Iconoclaste. Avec Marcher dans tes pas, Léonor de Récondo remonte le fil de son histoire familiale, marquée par la fuite de son aïeule en 1936, sous la menace des franquistes. Un roman qui prend sa source dans l'écriture d'un autre livre, Goya de père en fille, à paraître chez Verdier, qui explore la mémoire des réfugiés de la guerre civile. Quant à Gaëlle Nohant, après le succès du Bureau d'éclaircissement des destins (2023), elle nous embarque en 1917, dans un huis clos auprès d'une jeune fille et d'un déserteur.
Rachid Benzine sort L'homme qui lisait des livres chez Julliard le 21 août.- Photo ASTRID DI CROLLALANZAPour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.
Une météo similaire se joue aux Léonides, la jeune maison fondée par Dana Burlac, ex-directrice -littéraire des éditions de L'Observatoire. Elle est en effet suivie dans cette nouvelle aventure par Marie Charrel avec Nous sommes faits d'orage, une fresque sur l'Albanie des années 1970 à nos jours, et sur les destins tragiques de femmes révoltées.
... Et ceux qui restent
Mais que les allergiques au changement se rassurent, certains repères demeurent. Ainsi, Amélie Nothomb revient chez Albin Michel avec Tant mieux, une évocation romancée du lien unissant l'écrivaine à sa mère, tirée à 200 000 exemplaires. Parmi les poids lourds, Michel Bussi reste fidèle aux Presses de la Cité avec Les ombres du monde (180 000 ex.) où il explore l'histoire du Rwanda et du génocide des Tutsi. Deux ans après Western, Prix de Flore 2023, Maria Pourchet est de retour chez Stock avec Tressaillir, de même que Cédric Sapin-Defour, auteur du best-seller Son odeur après la pluie.
Guillaume Poix sort Perpétuité chez Verticales le 21 août.- Photo FRANCESCA MANTOVANI©GALLIMARDPour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.
Chez Grasset, Adélaïde de Clermont-Tonnerre confirme son goût pour les fresques romanesques avec Je voulais vivre, soit l'histoire de Milady, le personnage des Trois mousquetaires d'Alexandre Dumas. Alain Mabanckou demeure quant à lui au Seuil, dépeignant dans Ramsès de Paris une capitale bariolée et populaire où se croisent des destins marqués par la dureté de l'exil. Chez Gallimard, la collection « Sygne » accueille un sixième roman de Fabrice Caro, Les derniers jours de l'apesanteur (50 000 ex.), qui fait revivre les grandes heures du bac. Soupçon de nostalgie aussi Aux forges de Vulcain, où Gilles Marchand, Prix des libraires 2023, revient avec Les promesses orphelines, une traversée poétique des Trente Glorieuses par un jeune idéaliste. Agnès Desarthe délivre, elle, son quinzième roman aux éditions de L'Olivier avec L'oreille absolue. Parmi les habitués de ce rendez-vous d'automne, Olivier Adam signe, toujours chez Flammarion, Et toute la vie devant nous, un roman sur l'amitié.
Amitiés et marginalités
Décortiquée par de nombreux auteurs, jusqu'à ses aspects les plus sociaux et politiques, l'amitié est en effet l'un des thèmes forts de cette rentrée, aux côtés des liens familiaux. Avec les deux personnages de Comme en amour (Actes Sud, 25 000 ex.), Alice Ferney interroge l'amitié homme-femme, signant une vibrante conversation amicale. Dans Le fou de Bourdieu (Cherche-midi, 4 000 ex), Fabrice Pliskin crée une comédie humaine ironique où se noue une relation entre un ex-détenu initié aux principes du célèbre sociologue et un jeune homme en qui il voit un « dominé ». Dans L'Enseveli (16 000 ex.), Valérie Paturaud revient aux Escales avec une histoire d'amitié pendant la Première Guerre mondiale entre deux hommes que tout sépare.
Alain Mabanckou sort Ramsès de Paris au Seuil, chez Fictions et Cie le 22 août.- Photo OLIVIER DIONPour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.
Amitié féminine cette fois-ci, chez Chloé Delaume. Dans Ils appellent ça l'amour (Seuil), l'alter ego de la romancière, Clotilde, continue d'ausculter son passé lors d'un week-end entre amies, notamment le souvenir d'une relation abusive et d'un viol conjugal. Une ode à l'amitié est aussi à lire sous la plume de Jean Michelin, finaliste du Grand Prix du roman de l'Académie française en 2022, qui suit dans Nous les moches (Héloïse d'Ormesson) quatre amis ayant décidé de réaliser leur rêve d'ados en faisant une tournée avec leur groupe de musique à travers l'Amérique des déclassés. Chez Calmann-Lévy, Emmanuel Flesch construit avec Quitter Berlioz une intrigue sociale dans la France des années 1990, suivant l'amitié entre Serge et Younes, un jeune en réinsertion.
Une fibre sociale qui sous-tend nombre de textes. Le lecteur est ainsi invité à pénétrer dans l'univers carcéral, notamment par Guillaume Poix qui plonge avec Perpétuité (Verticales) dans le quotidien de surveillants pénitentiaires. Forte de son expérience dans les prisons de France en tant que volontaire, Karine Silla livre avec Vingt ans (L'observatoire) un roman sur la rédemption et la culpabilité, analysant le parcours d'une étudiante de 20 ans qui bifurque, sous emprise amoureuse, jusqu'à un braquage fatidique. Inspiré d'expériences carcérales, L'application des peines de Didier Castino (Les Avrils), est le récit d'Édouard, un ex-détenu de 40 ans qui espère que cette sortie sera la dernière.
Dictatures
Comme un écho à la montée des extrêmes droites et à la lame de fond autoritaire partout dans le monde, cette rentrée sonde les arcanes politiques de bien des manières. Dans Parthenia (Les Léonides), Pauline Gonthier brosse le tableau d'une France fracturée entre montée des extrêmes et guerre des sexes. Chez Anne Carrière, la victoire de Giorgia Meloni sert de décor à Si Rome meurt, de Renaud Rodier qui nous embarque aux côtés d'un aspirant cinéaste parti à la recherche de son père, disparu dans le monde des laissés-pour-compte. D'autres plongent carrément en dictature, à l'instar d'Hélène Frappat qui dévoile dans Nerona (Actes Sud) les coulisses d'une dictature féminine, inventant une sorte de « sitcom fasciste » incluant matricide, astrologie et combats de migrants télévisés. Avec Nous n'avons rien à envier au reste du monde (L'Observatoire), Nicolas Gaudemet propose quant à lui une réécriture du mythe de Roméo et Juliette en Corée du Nord.
Jetant des ponts entre passé et présent, cette rentrée lève le voile sur des pages méconnues de l'Histoire, notamment de la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, L'équation avant la nuit de Blaise Ndala (JC Lattès) raconte la course entre les Alliés et l'Allemagne nazie pour fabriquer la bombe atomique grâce à l'uranium du Congo belge. La forêt de flammes et d'ombres (Gallimard) d'Akira Mizubayashi, Prix des Libraires 2020, s'intéresse aux conséquences des guerres en suivant le destin d'un artiste japonais défiguré dans les combats.
Entre précision historique et tension romanesque, Alfred de Montesquiou ressuscite dans Le crépuscule des hommes (Robert Laffont) les témoins du procès de Nuremberg, parmi lesquels Joseph Kessel, Elsa Triolet, ou encore Marlene Dietrich. Second roman de Laurent Saulnier, Le diable dans l'assiette (Buchet-Chastel) offre un monologue envoûtant, celui d'Heinrich Uffen (personnage fictif), cuisinier d'Hitler. Enfin, avec Le bonheur (La peuplade), Paul Kawczak revisite la période de l'Occupation dans le style du réalisme magique avec un officier nazi sans visage et des enfants aux pouvoirs supposés.
Voies de l'intime
Mais dans une rentrée où les récits autobiographiques et les autofictions ont la cote, l'Histoire et les fractures sociétales s'apprivoisent aussi par les chemins de l'intime. La mémoire et la transmission obsèdent particulièrement les romanciers en cette rentrée (lire par ailleurs), à l'instar d'Anne Berest qui revient avec Finistère chez Albin Michel, et d'Emmanuel Carrère de retour chez P.O.L avec Kolkhoze. Chez Gallimard, Natacha Appanah, hantée par le meurtre de sa cousine, scrute l'énigme insupportable du féminicide conjugal dans La nuit au cœur. À l'Olivier, David Thomas, Prix Goncourt de la nouvelle en 2023, relate dans Un frère le combat de celui-ci contre la schizophrénie. Deux récits autobiographiques marquent aussi la rentrée de Stock : Le nom des rois, de Charif Majdalani, récit du passage à l'âge adulte de l'auteur, témoin du basculement du Liban dans la guerre, ainsi qu'Une drôle de peine, de Justine Lévy, qui raconte la perte soudaine de sa mère alors qu'elle est elle-même enceinte.
Dans cette écriture de l'intime, la maternité continue en effet d'être explorée sous tous les angles. Ainsi, Rebecca Benhamou raconte dans Ce que je vole à la nuit (Harper Collins) comment les mots lui sont revenus après sa grossesse, en se remémorant ses années d'étudiante à Londres et brossant par là même un portrait de Virginia Woolf. Mêlant récit, réflexions et poésie, Tambora d'Hélène Laurain (Verdier) évoque des grossesses compliquées, des désirs empêchés, et d'autres temporalités, comme celle du Tambora, ce volcan entré en éruption en 1815 qui plongea une partie du monde dans le froid et l'obscurité.
Jusqu'où peut-on aller pour comprendre nos mères ? interroge pour sa part Sophie Pointurier dans Notre part féroce (Phébus). Deux ans après Femme portant un fusil, elle poursuit son exploration de la vengeance en y ajoutant une touche d'étrange, son personnage enquêtant sur un phénomène paranormal survenu quarante ans plus tôt en embarquant avec elle sa mère, sa fille, et une vieille amie.
Romans démiurgiques
Corps féminin et procréation, relations femmes-hommes, au vivant, à la magie… Autant de sujets abordés par la dystopie préhistorique -d'Antoinette Rychner, Ma forêt (Fugue), qui met en scène un néolithique fantasmé. Tout aussi démiurgique, Tovaangar de Céline Minard (Rivages) livre une fable philosophique et écologique qui prend place dans une version possible du monde d'après, autour de ce qui reste de Los Angeles. Dans une interaction totale, les êtres vivants s'y regroupent par goûts et par compétences, créant des liens inédits avec leur environnement. Les normes sociales et de genre sont aussi pulvérisées par Grégory Le Floch dans Peau d'ourse (Seuil) qui revisite un mythe des Pyrénées à la sauce queer en racontant la transformation d'une jeune fille en ourse.
Retour à l'intime, sans renoncer au fantasque avec Anne Serre qui dessine son autoportrait en narratrice dans Vertu et Rosalinde (Mercure de France). Comme dans une galerie de miroirs, on y découvre 30 diffractions d'elle-même, puisque d'un récit à l'autre son identité fluctue. Avec son Autoportrait à l'encre noire (Robert Laffont), Lydie Salvayre interroge son goût de la solitude et son allergie aux codes sociaux, tout en déclarant son amour à la littérature.
Car dans les cahots de l'Histoire et les embrasements du monde, la littérature apparaît pour nombre d'auteurs et autrices comme l'ultime recours, la seule issue possible. Aussi le personnage de L'enfant à la tête baissée, d'Alexis Salatko (Denoël), trouve-t-il refuge dans la lecture et l'écriture. Et Les dernières écritures (P.O.L), à quoi pourraient-elles ressembler ? questionne Hélène Zimmer à travers le personnage de Cassandre Mercier, professeure de français qui en ouvrant Le bilan, un livre-somme sur le dérèglement climatique, croit tenir entre ses mains la « dernière œuvre ». Sous la plume de Rachid Benzine, un photographe français en mission dans la bande de Gaza écoute un vieux libraire lui raconter son histoire. Il est L'homme qui lisait des livres (Julliard, 25 000 ex.), comme nous le sommes aussi, tout particulièrement à l'aune de cette rentrée foisonnante.
Il était 73 premières fois
La rentrée littéraire des premiers romans 2025 reste similaire à l'année passée : 73 paraîtront cette saison, contre 68en 2024 parmi les 344romans français attendus entre août et octobre. Une tendance qui se confirme également côté parité : les femmes demeurent majoritaires avec 41 primo-romancières, contre 32 auteurs masculins.
Côté éditeurs, la plupart ne publient qu'un seul premier roman cette année. Robert Laffont, Fayard et Flammarion font figure d'exception, en lançant chacun deux primo-romanciers, et Gallimard trois. Parmi les indépendants, les éditions La Tête en l'air se distinguent également avec deux premiers romans au programme : Le jour où mon père ne m'a pas tué et ce qui s'ensuivit de Ludovic Le Gall, et L'Îlet. Histoire d'une redescente de Franck Adani. De leurs côtés, les éditions Le Soir venu et Marchialy font leur début dans la littérature blanche avec Puisque l'eau monte d'Adélaïde Bon et L'adieu au visage de David Deneufgermain.
Maladie et disparition
Plusieurs récits de cette rentrée littéraire abordent des thèmes profonds tels que la maladie ou le deuil. Dans Avant que tu ne t'en ailles (La Part commune), Amélie Cadier- Loriaud explore la relation entre deux sœurs, dont une est condamnée par un cancer. L'autrice y interroge notre rapport au temps et à l'inéluctable. Le même fil conducteur traverse Une écorchure (Les Éditions du Canoë) de Marianne Gokalp, dans lequel une jeune femme de 25 ans, diagnostiquée d'un cancer, est contrainte de se réinventer.
La question de la santé mentale irrigue également cette rentrée. Dans Folie entre mes doigts (Mercure de France), Alice Botelho livre le témoignage d'une jeune femme de 20 ans, internée en hôpital psychiatrique. Intime, ce premier roman éclaire les zones de fragilité psychique tout en mettant en avant la sororité.
Secrets de famille
La cellule familiale demeure également un thème de prédilection chez les primo-romanciers. Dans La hideuse (Christian Bourgois), Reine Bellivier entraîne son héroïne sur les traces d'une mère qui, des décennies plus tôt, a quitté le domicile familial sans explication. Ramsès Kefi, dans Quatre jours sans ma mère (Philippe Rey), suit un chemin similaire, explorant les réactions intra-familiales face à un départ inexpliqué. Il est aussi question de filiation dans Un nègre qui parle yiddish (Fayard), où l'auteur Benny Malapa retrace le parcours de ses parents entre le Cameroun, l'Allemagne et la Pologne, sur fond de guerre et de racisme.
Pur soi
Les primo-romanciers célèbrent enfin la quête de soi à travers les identités de genre et les relations amoureuses libérées. D, personnage principal du roman Physiquement de Sasha Georges (Julliard), quitte sa ville bretonne du jour au lendemain pour Paris, où il se redécouvre à travers la culture queer, la sexualité joyeuse et les nuits électrisantes. Camille Corcéjoli, dans Transatlantique (La Contre-allée), envoie son personnage Alex en road trip aux États-Unis : un voyage initiatique alors qu'il choisit d'entamer une transition de genre. Enfin, dans Une pieuvre au plafond (Rivages), Melvin Mélissa imagine un trio queer et punk - Sibylle, Simon, Haroun -, qui repense l'amour et les liens affectifs à travers une existence libre et affranchie des normes. A. B.
In memoriam
La littérature comme remède à l'oubli, qu'il soit intime, familial, ou collectif. C'est l'énergie qui traverse nombre de fictions et récits en cette rentrée d'automne. Et dans bien des cas, ce surgissement de la mémoire est provoqué par un objet.
par souen léger
Quand les objets parlent
Chez Laurent Mauvignier, aux éditions de Minuit qui en tirent 45 000 exemplaires, il s'agit de La maison vide. Une demeure familiale peuplée de récits où subsistent les traces de ses aïeules que l'auteur tente de ramener à la lumière. Au Seuil, Adrien Genoudet, lui, comble les trous de son histoire familiale dans Nancy-Saïgon à partir de la tunique traditionnelle indochinoise que portait sa grand-mère dans son cercueil, avant d'être déterrée en vue d'une réduction de corps pour faire de la place dans le caveau. Le narrateur hérite alors du vêtement et d'un carton contenant la correspondance de ses grands--parents, point de départ d'une enquête mêlant fiction et archives personnelles. Au Seuil toujours, dans Le bel obscur, -Caroline Lamarche tente, à partir d'une photographie énigmatique, d'élucider le destin d'Edmond, un ancêtre effacé du roman familial.

Chez Albin, Franck Bouysse retricote dans Entre toutes (40 000 ex.) la vie de son aïeule Marie, née en 1912 dans une ferme de Corrèze qu'elle n'a jamais quittée. Fatou Diome, elle, évoque dans Aucune nuit ne sera noire sa relation avec son grand-père et les leçons de sagesse qu'il lui a apprises.
Ce sont aussi des pères et des mères dont on essaie de dissoudre les silences ou de recoller les morceaux qui apparaissent dans plusieurs titres de cette rentrée. Jusqu'ici publiée par Grasset, Vanessa Schneider arrive chez Flammarion avec La peau dure (10 000 ex.). Elle y dresse le portrait de son père, l'écrivain et psychanalyste Michel Schneider mort en 2022, dépeignant la génération des baby-boomers. Pour Catherine Millet, également chez Flammarion, ce sont des photographies qui ont déclenché l'acte d'écrire Simone Émonet, du nom de sa mère, dont elle évoque le suicide. Régis Jauffret, lui, explore à travers Maman (Récamier) la figure maternelle disparue, se livrant sur sa vie entière. Dans L'Albatros de Raphaël Enthoven (L'Observatoire, 30 000 ex.), l'écrivain relate l'histoire d'un fils qui accompagne sa mère sur le chemin d'une maladie incurable.
Suivre les traces
Il s'agit, chaque fois, de combattre l'effacement. Alors que la grand-mère de Raphaël Sigal, atteinte de la maladie d'Alzheimer, a traversé la Shoah -lorsqu'elle était enfant, il décide d'écrire son histoire en se limitant à ce qu'elle lui a transmis, composant une Géographie de l'oubli (Robert Laffont). Deux romans s'emparent aussi de la question de la mémoire de l'Holocauste et de la Seconde Guerre mondiale. Le Québécois Jean-François Beauchemin, auteur du Roitelet, livre avec Mémoires de Mayron Schwartz une saga familiale où le narrateur, un écrivain juif athée néodarwinien, navigue parmi les souvenirs de ses grands-parents sur lesquels plane l'ombre des camps d'extermination. Avec La bibliothèque retrouvée (Zoé) Vanessa de Senarclens mène l'enquête autour de la bibliothèque « disparue » de Karl von Bismarck-Osten, de la période des Lumières à l'horreur nazie.
Mais comment transmettre quand tout ou presque a disparu ? En suivant les traces, pardi. C'est ce à quoi s'ingénie Marie Richeux dans Officier radio (Sabine Wespieser). L'autrice se penche sur la disparition en mer de son oncle qu'elle n'a pas connu, nous entraînant dans une reconstitution de la tragédie, de compilations d'articles de presse, en correspondances et télégrammes diplomatiques, jusqu'aux voyages en Italie, sur les lieux du drame, et en Bretagne. Entre documentaire et fiction, Camille de Toledo poursuit sa quête d'une autre vision du passé et de l'avenir dans Au temps de ma colère, chez Verdier.
Jusqu'ici publié par la maison aux couvertures jaunes, Antoine Wauters débarque dans la « Blanche » de -Gallimard avec Haute-Folie, qui raconte la vie de Josef, un homme dont la famille a été frappée par une série de drames qui ne lui ont jamais été rapportés. Un livre sur la marginalité et les conséquences d'une histoire enfouie sous le silence. Dans la même collection, Jakuta Alikavazovic signe avec Au grand jamais un roman sur les non-dits familiaux. C'est encore le silence qui entoure le père de Maxine, protagoniste de Fermer l'œil de la nuit, de Manon Fargetton (Héloïse d'Ormesson), qui entreprend un voyage en Écosse pour remonter le fil du temps et découvrir une vérité. Chez Denoël, Simon -Johannin exhume quant à lui, dans Le fin chemin des anges, l'histoire des bagnes pour enfants. On y suit un homme qui, hanté par des voix de fantômes, prend un train pour l'île du Levant, au large d'Hyères. Il y reçoit le récit d'un jeune garçon condamné pour vol et harcelé pour son homosexualité. L