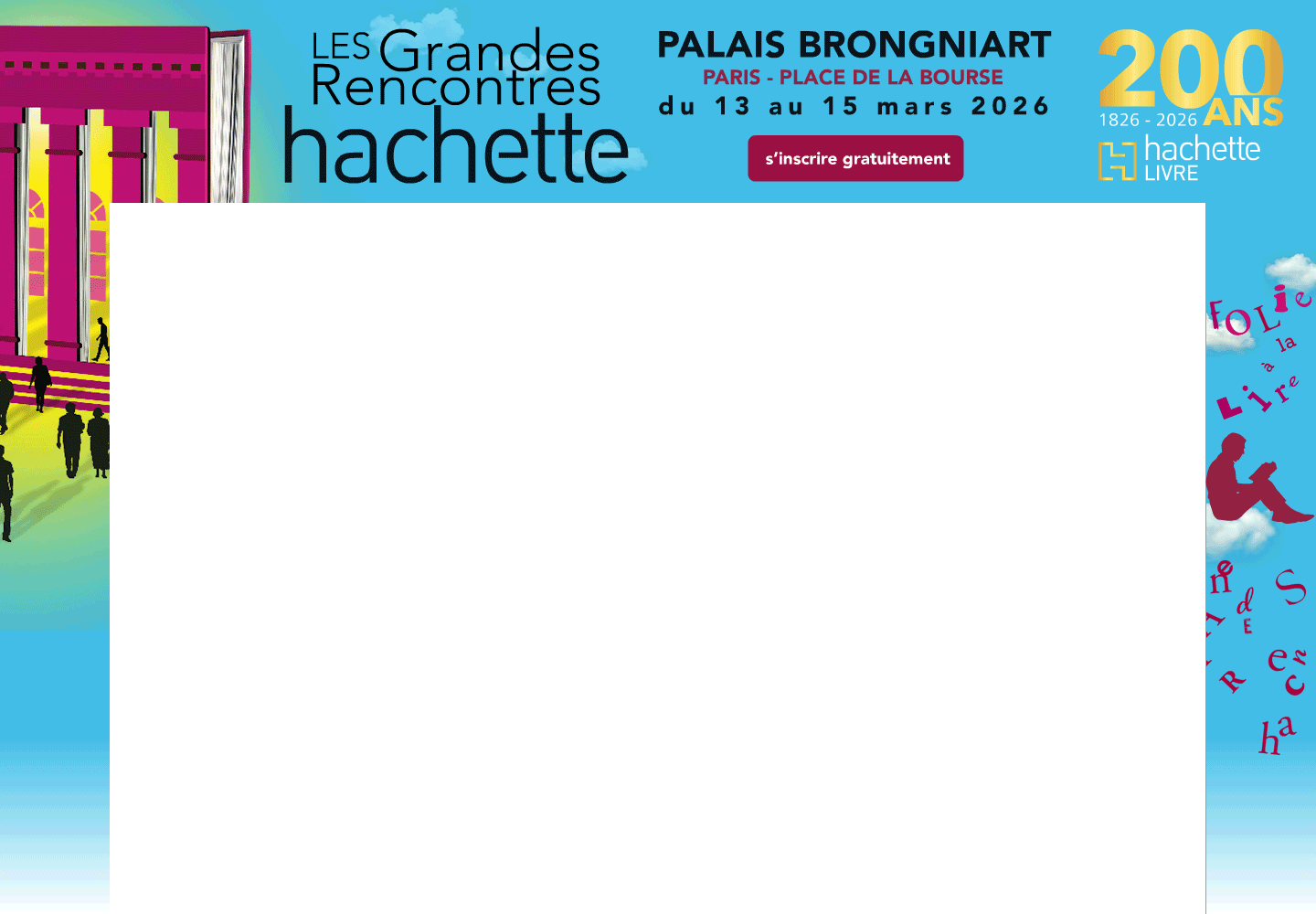Il y a dans l’esprit piquant de Rosa Montero quelque chose qui tient à la fois du sage et du lutin, qui combine l’expérience d’une âme aguerrie et le goût du jeu d’une petite fille. Dans La folle du logis (Métailié, 2003, et qui reparaît dans la collection "Suites"), dont le titre est emprunté à une définition de l’imagination par sainte Thérèse d’Avila, l’écrivaine espagnole livre sa profession de foi littéraire, rendant hommage à l’invention plutôt qu’à la mémoire qui est toujours selon elle une construction artificielle.
Ses propres souvenirs sont, assure-t-elle, peu fiables, faits de rêves et de fantasmes, et toute son œuvre fictionnelle est marquée par cette volonté d’abolir les frontières entre imagination et réalité avérée.
Journaliste célébrée dans son pays, Rosa Montero écrit des chroniques dans le supplément dominical d’El País, quotidien dans lequel, depuis près de quarante ans, elle a occupé à peu près tous les postes. Comme romancière, elle s’est aventurée dans tous les genres, du roman historique à la science-fiction - inventant une héroïne androïde dans Des larmes sous la pluie (2013) et Le poids du cœur (2016) -, intérêt qu’elle estime influencé par des lectures de son enfance marquée par l’immobilité puisque, atteinte de la tuberculose à l’âge de 5 ans, elle n’a pas pu être scolarisée pendant plusieurs années. Mais ce qu’elle cherche plus que tout, c’est écrire des "livres ouverts et hybrides".
La chair remplit avec brio ce contrat. Derrière une comédie dramatique sur les préjudices de l’âge, où l’auteure a assurément saupoudré quelques ingrédients autobiographiques, se cache aussi un thriller érotico-sentimental, tendu par un efficace suspense. Avec l’histoire de Soledad, une Madrilène de 60 ans commissaire d’exposition, une femme à hommes qui engage un jeune gigolo dans le but de rendre jaloux l’amant qui vient de la laisser tomber et qui se retrouve embarquée dans les affres d’une passion ambiguë, la romancière manie ironie et humour noir pour évoquer le passage amer du temps, l’éternelle jeunesse du désir, la maternité, la solitude, le vieillissement…
Tatouée
On trouve aussi, mêlés une nouvelle fois à la fiction, les portraits de quelques "écrivains maudits", thème sur lequel son héroïne prépare une exposition. Ce tissage entre réel et invention, qui est sa marque de fabrique, était déjà présent dans L’idée ridicule de ne plus jamais te revoir (2015) où le Journal de Marie Curie, que la romancière avait découvert deux ans après la mort de son compagnon, servait de point d’ancrage à une réflexion déliée sur la perte, la mort mais surtout la vie.
Rosa Montero dit que l’écriture est pour elle un "squelette exogène qui [lui] permet de [se] tenir debout". Elle l’a dans la peau, littéralement. Il y a quelques mois, elle s’est fait faire un nouveau tatouage : sur sa nuque s’imprime désormais un vers du poète chilien Raúl Zurita, gravé lui-même en lettres géantes sur le sol du désert d’Atacama, "Ni pena, ni miedo". Ni tristesse, ni peur : un énergique programme vital.
Véronique Rossignol
Rosa Montero, La chair, Métailié, traduit de l'espagnol par Myriam Chirousse. 18 euros, 192 p. Sortie le 19 janvier. ISBN : 979-10-226-0540-3