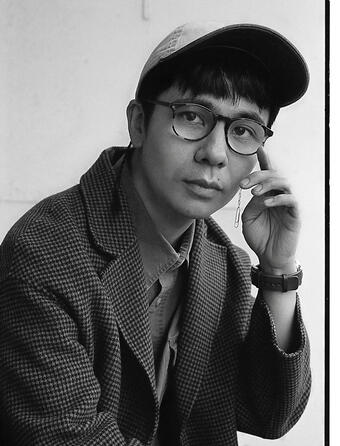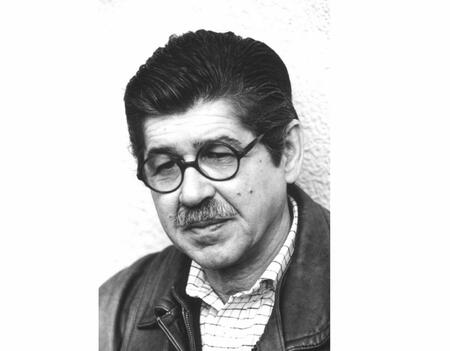Il me semble qu’il y a à cette persistance deux causes majeures. La première est une idée empoisonnée : l’art et la création n’ont pas de prix, ne doivent pas frayer avec le sale argent. Encore récemment, l’éminent membre de l’Académie Suédoise et du comité Nobel, Horace Endgahl, déplorait, dans un entretien accordé au journal La Croix, la professionnalisation de l’écrivain (comprendre : le fait que l’écrivain entende gagner décemment sa vie grâce à l’écriture et soit contraint, pour cela, puisque les fameux pourcentages sont si faibles et les ventes de livres en chute libre, d’enchaîner résidences, interventions scolaires, lectures). Son inquiétude : que, n’ayant plus à être, je cite, « taxis, commis, secrétaires, serveurs », les écrivains ramollissent, se coupent des dures réalités du « vrai » monde, bref, deviennent mauvais.
C’est aussi au nom de cette vision romantique et souvent véhiculée par ceux qui n’ont pas eu à transpirer devant des classes fières de ne jamais ouvrir un livre (un quoi ?) ni à surmonter leur phobie administrative pour remplir d’ingrats dossiers de demande de bourses ou autres, que nombre de nos éditeurs enfoncent encore le clou dans nos têtes pleines de mots mais pas toujours à l’aise avec les chiffres. Publier, c’est merveilleux, c’est un privilège. Nous, écrivains publiés, serait-ce pour trois francs six sous, voire des nèfles, sommes élus. On, c'est-à-dire l’humanité entière, en rêve (ce qui est un peu vrai et n’arrange pas nos affaires). On en fait même une telle question d’honneur, de reconnaissance, de vie et de mort qu’on est prêt – en tant que secrétaire générale de la SGDL en charge de traiter les demandes d’adhésion et donc de vérifier les contrats, je peux en témoigner – à payer pour ça ! Et cher…
Nous, auteurs, sommes tombés dans cette soupe culpabilisante là, y baignons depuis toujours. Il s’en trouve même beaucoup pour non seulement l’avaler mais la resservir (je n’écris pas pour gagner de l’argent, allons, quelle horreur ! Les droits d’auteur ? Ce n’est pas important pour moi. Etc, etc.)
Comment, dès lors, aborder la question avec sérénité ? Comment ne pas avoir le sentiment, dès qu’on revendique, même modestement, une meilleure rémunération, d’être d’un pragmatisme incompatible avec l’Art, le Grand, avec le talent véritable qui, personne ne l’ignore, se nourrit d’air et grandit dans la privation et la douleur ?
Nous souffrons en quelque sorte d’un complexe de trivialité et l’engagement dans une démarche collective me paraît être le moyen idéal pour le surmonter.
L’autre cause est, ou a été longtemps, économique et difficile à remettre en question. Dans la chaîne du livre, on le sait, les intermédiaires sont nombreux et les coûts, importants, répartis entre eux. L’auteur, lui, n’en assume aucun. Son temps de travail n’entre pas en compte quand, dans tous les autres domaines, il est plus ou moins bien rémunéré mais sans discussion. A cette réponse toute trouvée, cet ordre établi, l’ère du numérique offre enfin l’occasion d’un état des lieux et, on l’espère, d’une redistribution plus équitable.