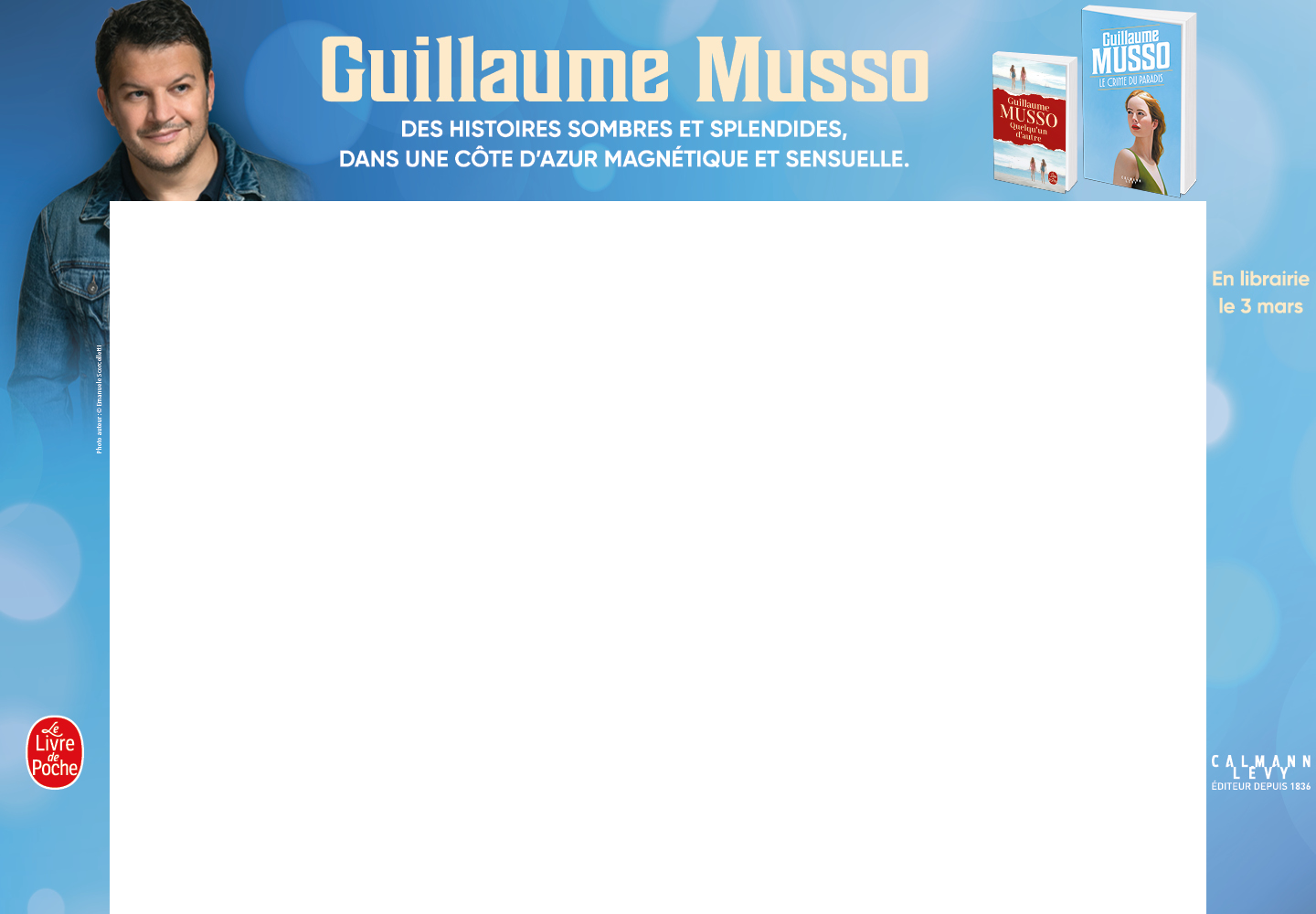Alcool rectifié. L'interdiction d'un produit ne supprime pas le problème, elle en ajoute un. C'est ce qui ressort de l'étude rondement menée d'Annick Foucrier, professeure émérite d'histoire de l'Amérique du Nord à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Son ouvrage sur la Prohibition n'a pas la prétention de défendre ou de condamner cette loi qui a proscrit le commerce des boissons alcoolisées aux États-Unis de 1919 à 1933. Il s'agit avant tout d'expliquer cette période de quatorze ans en sortant des clichés hollywoodiens et en revenant sur ses origines.
Après la guerre d'Indépendance, on boit du matin au soir dans le Nouveau Monde, pour se réveiller, se donner un coup de fouet et s'endormir. Annick Foucrier raconte tout cela avec force détails. Les Américains consomment surtout des alcools distillés, et la nourriture, alors à base de viande salée ou fumée, donne soif. Dans cette « jeune république alcoolique », l'ivresse est condamnée mais pas réprimée. L'eau, la plupart du temps polluée, est considérée comme malsaine, et le whisky moins cher que l'eau gazéifiée au début du XIXe siècle. Les médecins puis les pasteurs partent donc en guerre contre ce fléau qui fait des ravages dans la société, chez les Indiens, les immigrés, dans les classes populaires et les familles.
Dans un récit très fluide, Annick Foucrier déroule l'histoire et les mécanismes qui ont conduit, après plusieurs tentatives de régulation, à l'interdiction pure et simple. La lutte pour cette tempérance est associée en 1850 à celles pour l'abolition de l'esclavage et pour l'obtention du droit de vote pour les femmes. Après la guerre de Sécession, l'industrialisation a entraîné le retour de l'alcool et l'inquiétude à son égard. Les machines étant plus rapides, les accidents sont plus vite arrivés, surtout avec des ouvriers ivres. Des figures féminines prennent une part déterminante contre le commerce des boissons alcoolisées. En 1915, la Géorgie ouvre la voie au 18e amendement instituant la prohibition. Il est ratifié en 1919 après l'entrée en guerre des États-Unis.
La question est désormais non pas comment se passer d'alcool mais comment s'en procurer. L'émergence des Années folles, notamment dans grandes villes, est marquée par une soif de liberté qui s'oppose à ce puritanisme. Les gangsters, à commencer par le plus célèbre d'entre eux, Al Capone, vont se charger d'alimenter les speakeasies, les bars clandestins. Car la loi interdit la production, le transport, l'importation et la vente de boissons alcoolisées mais pas la production pour la consommation personnelle. Ainsi la surface des vignobles en Californie double pendant la Prohibition. Annick Foucrier montre l'imbroglio du système juridique américain, certains États appliquant mieux la loi que d'autres. En 1933, le 21e amendement abroge le 18e, tout en évitant le retour du saloon. Dans une période de transformations économiques, sociales et culturelles rapides s'installe l'idée qu'une grande nation doit être sobre. La notion mérite qu'on s'y attarde.
La Prohibition. Interdire pour une Amérique meilleure ?
Armand Colin
Tirage: 5 000 ex.
Prix: 23,90 € ; 272 p.
ISBN: 9782200632595